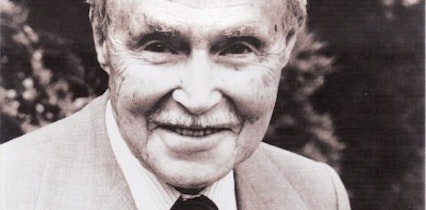C’est la première croisière d’une vie qui refuse l’ancrage. Le « vagabond », l’« ange déchu », les titres de biographes ont tous retenu l’esseulement romantique qui pousse ce nomade sur les routes, toujours en exil de quelque chose, les poings dans les poches crevées – Mourmansk, puis Liverpool, puis Londres. La schizophrénie, aussi, qui lui évite d’être enrôlé en 1943, dans l’U.S. Navy.
Il n’a pas réussi à être footballeur, et c’est une bonne raison d’embrasser la Muse : Kerouac se lance dans l’écriture d’une saga semi-autobiographique, largement inspirée de cette enfance en Nouvelle-Angleterre. The Town and the City sera traduit en français par Daniel Poliquin et publié une première fois aux éditions de la Table Ronde sous le titre Avant la route, en 1990.
Famille nombreuse
Histoire d’une famille nombreuse dont Kerouac suit tous les membres à travers le monde, du début du siècle à la fin des années 1940 : le père – il mène cent vies et cinq métiers – accompagné de son épouse qui prédit maux et bonheurs dans un marc de thé ou la couleur du ciel ; le fils aîné Joe, qui se croit le fils raté, et dont l’ambition est d’acheter une motocyclette ornée de queues de lapin, avant de devenir aviateur ; Francis, l’intellectuel, dont les brillantes études le mèneront à Harvard puis à La Sorbonne, où il réalise son rêve d’érudition ; le plus jeune enfin, Peter, alter ego de Kerouac, « aiguillonné par les triomphes fantastiques et fabuleux qu’il croit possibles dans le monde » et qui veut devenir une étoile du football. Ils se réuniront tous lors de l’enterrement du père, moment décisif où le destin de chacun est enfin composé, et accepté par tous. Par tous, sauf Peter, l’émerveillé pensif et idéaliste, pétri d’ambitions intelligentes et têtues, « toujours enveloppé de […] pensées profondes vouées à l’avenir, à la joie et au triomphe », et que le passage du village à la ville n’a pas réussi à éteindre.
«The town », c’est en fait Galloway (Massachusetts), petite ville de tisserands où s’écoule une existence mi-rurale, mi-citadine, celle de la famille Martin, unie par l’affection mais surtout soucieuse de faire durer les bonheurs fragiles – le cidre qu’on boit au gallon, le chahut des polkas et l’émoi des premières tendresses sous les feuillées tremblantes. «The city », la New York des années 1940, en est la figure d’opposition, où le jeune Peter entamera sa carrière de footballeur tout en découvrant l’ébullition de la vie urbaine, mais aussi la fureur poétique – le roman retrace l’émergence prometteuse de la Beat Generation, chacun des personnages de la « city » incarnant un adepte du mouvement : Leon Levinsky est Allen Ginsberg, Kenneth Wood est Lucien Carr, Will Dennison campe William Burroughs.
Il faut relire The Town and the City, ce roman sur lequel Kerouac a planché de 1946 à 1948, qui dépeint avec une gaieté triste, comme s’il s’agissait d’une civilisation vouée à disparaître, la beauté brute des cols bleus, la force de leurs traditions et de leur musique folk. Tous ces personnages sont des Kerouac à leur façon parce qu’ils sont des contemplateurs de lumière et des saisons, dont on reconnaît les révolutions à la couleur nouvelle d’un champ ou d’une ramée, derrière le cabanon familial – avant de découvrir la ville. L’écriture s’en fait le reflet, grande narratrice des solstices, s’ajustant à la hauteur du soleil au-dessus de l’horizon lors de son passage au méridien. Et « soudain, c’est la fraîcheur ».
Il faut relire The Town and the City, ce roman sur lequel Kerouac a planché de 1946 à 1948, qui dépeint avec une gaieté triste, comme s’il s’agissait d’une civilisation vouée à disparaître, la beauté brute des cols bleus, la force de leurs traditions et de leur musique folk.
Pour être du voyage, le lecteur doit consentir au vœu de Kerouac, pour qui l’on devait courir le monde avec des yeux d’enfant. The Town and the City déploie cette rhétorique de l’émerveillement, et parvient à concentrer sans déperdition la poésie précise du quotidien – pour reprendre les mots de Kerouac, à « décrire simultanément la miette sur l’assiette, l’assiette sur la table, la table dans la maison et la maison dans le monde ». Le roman relate la fraîcheur et la beauté des expériences brutes : mais il s’agit moins de les décrire que de les régénérer dans leur sublime occurrence, et leur pureté première.
- The Town and the City, Jack Kerouac, La Table Ronde, 608 p., 15 euros, 10 mars 2016