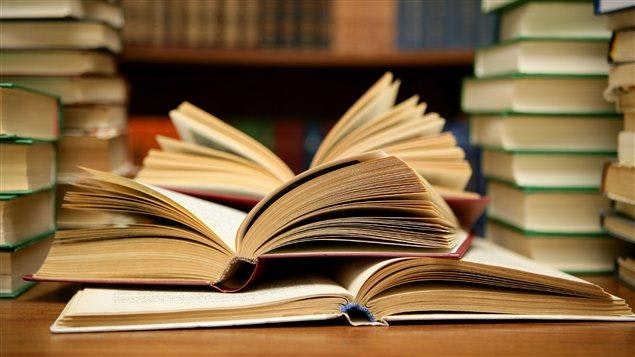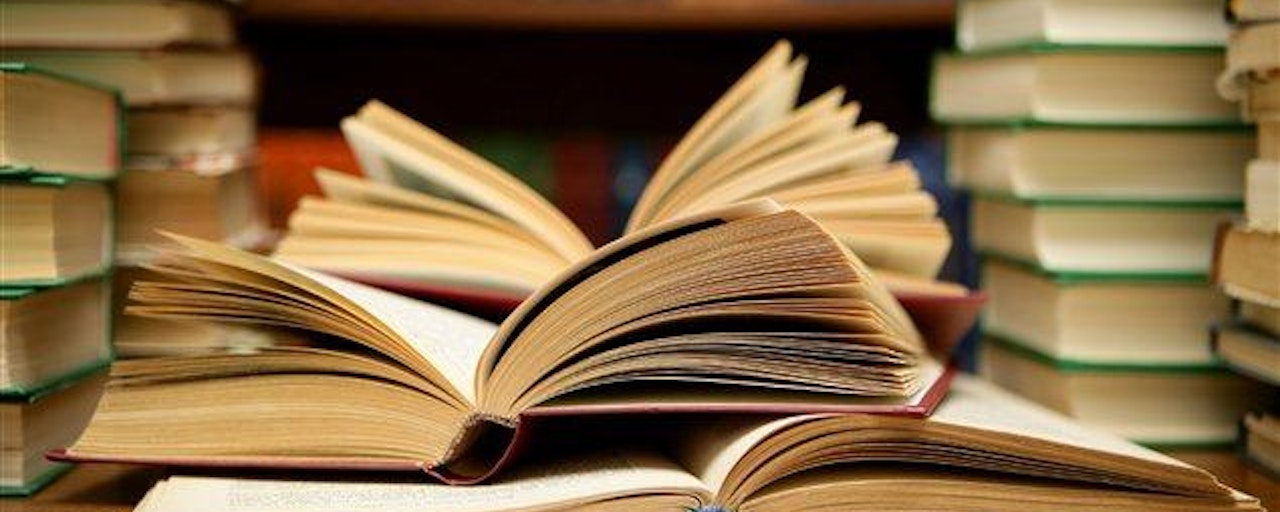4. Le roman historique (Les Malheurs d’Héloïse et Abélard)

« – Voici, maître Abélard, ma nièce Héloïse. Allons, toi, viens-t’en donc saluer notre hôte ».
La jeune fille, de haute taille, vêtue d’une cotte-hardie bleue aux manches brodées d’or, s’avança dans la pièce et fit, devant le célèbre artien, une discrète révérence. Puis elle alla sagement se tenir, toute droite, dans l’ombre de son gros oncle. C’était donc elle, cette grande jeune pucelotte timide, dont tout le Paris universitaire vantait la science, et dont même les plus chopineurs des goliards reprenaient certaines chansons, aux heures de moindre ivresse. Ainsi, ce serait un jeu d’enfant… Car il venait, en quelques instants, de prendre la ferme décision de jouer à trousse-donzelle avec la nièce de l’un des chanoines les plus influents de la ville. Et, pour tout dire, cette perspective le réjouissait infiniment plus que, même, celle de pouvoir à nouveau professer à l’école cathédrale. Cependant, Fulbert pérorait, et il fallait faire mine d’y prendre le plus haut intérêt.
C’était donc elle, cette grande jeune pucelotte timide, dont tout le Paris universitaire vantait la science, et dont même les plus chopineurs des goliards reprenaient certaines chansons, aux heures de moindre ivresse.
« – Croyez bien, monsieur le chanoine, finit-il par l’interrompre, que c’est pour moi un immense honneur que d’être si bien logé. Une fois encore, je ne puis que vous être infiniment reconnaissant de porter ainsi attention à ma personne et à mon travail…
– C’est à lui, surtout, maître, que je suis attaché, répondit Fulbert. Vous avez, j’en suis certain, de hautes et nobles tâches à accomplir au sein de l’Université parisienne. Vous enloger est un honneur, autant qu’un plaisir. À présent, ma nièce – Héloïse, viens-t’en ! – va vous conduire à votre chambrelle. Je dois, pour ma part, me rendre sitretôt à l’Hôpital des Pauvres. À vous revoir, maître Pierre.
– À vous revoir, monsieur le chanoine ».
Et l’huis se referma sur le flasque Fulbert, laissant tête à tête l’écolâtre souditeur, tout de rouge vêtu, et la jeune Héloïse, dont il n’était pas encore le maître, et qui n’était point encore sa maîtresse. Ils se toisèrent longtemps, sans mot dire. À l’instant même où son oncle avait quitté les lieux, l’attitude de Héloïse, même silencieuse et immobile, avait été changée du tout au tout. Elle s’était imperceptiblement redressée, son regard était à présent intense et enflammé, sa bouche même paraissait moins boudeuse soudain. « Ventredieu, jura maître Abélard en son for intérieur, cette tendrette m’est bien plus agréable au second qu’au premier coup d’œil. Pour y voir de plus près, j’accepterais bien de donner raison à Guillaume de Champeaux… ». La transformation avait été telle, cependant, qu’il en perdait sa contenance légendaire. La jeune fille en profita, qui le remarqua immédiatement, pour s’avancer vers lui et, d’un geste d’une grâce infinie, désigner les lourds escaliers qui s’entassaient au fond de la Grand-Salle.
« – Ensuivez-moi, maître Pierre, dit-elle, je vous duis à votre chambre. »
C’était, de son entière vie, la première fois que Pierre Abélard se laissait mener par une pucelle de vingt-et-un ans. Il profita des escaliers pour se ressaisir. Ce n’était point, pourtant, chose facile. Tandis qu’elle montait les marches à quelques pas devant lui, Héloïse croisait la trajectoire de quelques rayons de soleil qui parvenaient à se frayer un chemin jusqu’ici, et le tissu de son vêtement, brodé d’or, prenait feu. Mais un feu souple et sinueux qui brûlait sans consumer, dont les flammes serpentaient le long de son corps comme si elles désiraient ardemment en souligner les contours, pourtant bien décelables sous l’étoffe serrée de l’habit. L’écolâtre hardi ne faisait plus le moindre effort de prudence, et pourgardait à présent sans verogne le crepon de la belle, tout en fulminant de n’être pas capable de conserver l’avantage. Arrivé au premier étage, il fut soulagé quelque peu de n’avoir plus, suspendu à sa lippe, les arrières appâts d’Héloïse. En un clin d’œil, il avait pris à nouveau le contrôle de ses basses parties, et faisait à présent dans sa tête des vers latins à la gloire alégorique de sa muse nouvelle. En l’entendant présentée par son oncle, il avait pensé tout de suite à Hélios, le dieu solaire de cette mythologie grecque qu’il aimait tant. Héloïse, Hélios, il y avait là de quoi nourrir son inspiration pour quelques longues pages de chansons qu’il laisserait, un jour ou l’autre, négligemment trainer sur le bord de sa table de travail afin que quelques-uns de ses admirateurs, comme à leur habitude, finissent par s’en emparer, les recopier, et se charger eux-mêmes d’en répandre moult copies en toute la ville. La jeune Héloïse serait alors dans toutes les bouches. Cette pensée ajouta encore à sa vigueur.
« – C’est ici, maître, indiqua soudain Héloïse, en ouvrant devant elle la porte d’une chambre d’où s’échappa un vent coulis. Votre chambre. Mon oncle l’a faite meubler, il n’y a pas un long temps, espécialement pour vous.
– Grâce lui soit rendue pour tant de bonté, répondit Abélard en pénétrant dans la pièce. Parfaite couche, fit-il en se laissant tomber, assis, dessus. Et il me fit même monter un pupitre, ajouta-t-il en avisant une table escriptoire, rangée proche une fenêtre ouverte.
– Mon oncle a affirmé qu’il était de la plus haute importance que vous puissiez mener vos travaux à bien dans les meilleures conditions.
– Grâce lui soit rendue, répéta l’écolâtre, assez peu inspiré.
– Je vais mander maintenant que l’on monte ici vos effets, conclut Héloïse en quittant la pièce où elle avait à peine fait deux ou trois pas. »
Elle se retourna pourtant, avant d’avoir franchi la porte, une main sur l’épais chambranle de chêne, l’autre dissimulée dans son dos, et ajouta, pleine d’un formidable aplomb :
« – Mon oncle vous a installé dans la meilleure chambre de la maison. Elle jouxte la mienne. »
(…)
***
5. La Science-Fiction (In Vitro)

Depuis la fenêtre de son grand salon aux murs infiniment blancs, Markus supposait que le soleil devait être en train de se lever. Il y avait bien longtemps qu’il ne pouvait plus le distinguer avec certitude, tant les multiples lueurs du centre-ville rendaient difficiles ce genre d’observation. Sur Basileopolis, la nuit ne tombait plus jamais. Et le jour n’était qu’un surcroît de clarté qui s’invitait, sans qu’ils n’y prennent plus garde, dans l’existence des gens, entre leur premier et leur dernier repas. Markus leva les yeux vers la plus haute construction des environs, la Tour de Garde, dont il ne pouvait entrevoir la cime qu’en collant son visage contre la vitre, bien qu’il vécût lui-même au soixante-deuxième étage de son bâtiment. Il songea que, peut-être, de là-haut, on devait pouvoir encore voir le jour se lever, au loin. Il chassa bien vite cette naïve pensée : l’horizon ne devait qu’être une constellation de lueurs humaines, puisqu’il n’y avait plus d’obscurité sur la Terre. Du moins en surface, si tant est que l’on pût appeler encore « surface » cet entrelacs serré de cités tentaculaires, construites sur plusieurs étages interminables, ayant toutes la tête dans les nuages, et les pieds vingt-mille lieues sous la terre. La planète portait à sa superficie une jungle de bâtiments qui se nouaient les uns aux autres avec plus de sinuosité encore que, jadis, ne devaient s’entremêler les branchages de ces forêts tropicales dont regorgeaient de photographies les livres d’histoire.
La planète portait à sa superficie une jungle de bâtiments qui se nouaient les uns aux autres avec plus de sinuosité encore que, jadis, ne devaient s’entremêler les branchages de ces forêts tropicales dont regorgeaient de photographies les livres d’histoire.
Markus jeta un œil à l’orchidée dont, depuis plus d’une année qu’elle se trouvait là, il ne parvenait pas à obtenir une seconde floraison, sans toutefois qu’elle ne se décidât à se dessécher pour autant. Somme toute, un organisme assez semblable au sien : ni fleur, ni fruit ; plutôt qu’une vie, une végétation qui paraissait n’être due qu’à une incapacité à se laisser mourir. Il détestait cette plante, mais il ne pouvait pas s’en débarasser pour autant : depuis de longues années désormais, depuis le mois de janvier 2110, pour être exact, la présence d’un tel végétal dans toute habitation avait été imposée par décision du Conseil des Régents, afin non pas de préserver un environnement qui n’existait plus depuis longtemps, mais d’éviter que ne disparaisse cette espèce, particulièrement fragile, qui avait été choisie comme symbole de la vie. Depuis que « l’environnement » n’était plus qu’un souvenir, le Conseil des Régents avait décidé d’une telle mesure, qui permettait au Ministère de l’Écologie de ne pas suivre, dans les poubelles de l’histoire, son propre objet. L’idée était simple : maintenir, de manière parfaitement artificielle, quoique bruyamment obligatoire, l’existence de quelques espèces végétales, parmi les plus fragiles, afin de pouvoir continuer à faire mine de lutter contre des effets dont le Gouvernement, depuis de longs siècles, encourageait goulûment les causes. L’orchidée était ainsi devenue, aux yeux de Markus, le symbole de la vie en phase terminale, prolongée sempiternellement par de si grossiers procédés que la plupart des gens avaient choisi, pour ne pas devenir fous, d’y accorder une créance absolue.
Markus consulta son multiphone et s’aperçut qu’à force de rêvasser, il allait finir par prendre du retard. Tous les matins, cinq jours par semaine, il quittait son appartement à la demie de huit heures. Trente minutes plus tard, très exactement, il se présentait à la porte principale l’Institut Supérieur d’Information Culturelle, où il occupait le poste, certes subalterne mais néanmoins fort important, d’Archiviste général. Sa mission était très simple, en théorie, mais d’une mise en pratique particulièrement complexe. Elle consistait à superviser, pour une section donnée des documentations d’État, le tri total des informations destinées à l’enseignement secondaire et supérieur des Arts écrits. Autrement dit, et du moins pour les XIXe, XXe et XXe siècle, c’était au service que dirigeait Markus qu’il incombait de sélectionner les œuvres étudiées, ainsi bien sûr que d’en construire une lecture adéquate, en accord avec les Protocoles pour la Saine Culture Nouvelle, dont les accords avaient été signés mondialement quelques années auparavant. L’ensemble des textes et des commentaires formait ce que l’on nommait l’Archive, réserve vaste, presque infinie, de documents où pouvaient puiser sans crainte les multiples filières de l’Institut Supérieur d’Information Culturelle, dont dépendait naturellement et sans exception tous les établissements d’enseignement. Le reste, bien sûr, n’était pas interdit – réflexe archaïque –, car fort peu de choses l’étaient. Le reste était simplement livré à lui-même, au gré des ondes et des réseaux, sans la moindre surveillance, ni la moindre possibilité de cristallisation, puisque les livres n’existaient plus depuis longtemps. Ces « informations » allaient et venaient, s’échangeaient, circulaient, mais n’avaient plus la moindre efficace. Elles n’appartenaient plus au domaine du vérifiable, du solide, elles n’étaient donc plus rien : on pouvait certes y accéder, s’y plonger même, les apprendre par cœur si l’on voulait, mais cela ne pouvait conduire à rien d’autre qu’un exercice stérile, car il n’y avait plus aucun moyen pour ces « informations » de regagner la moindre valeur objective. Et de fixer la valeur à ce qui le méritait, c’était précisément le travail de Markus. Du moins l’un des multiples aspects de son travail, dont il n’était d’ailleurs pas particulièrement fier, ni honteux particulièrement. C’était surtout, pour lui, l’un des derniers moyens d’avoir contact avec ce que l’on nommait, dans le jargon de sa profession, « l’ancien », à savoir tout ce qui appartenait au monde précédant la Grande Union. Sans bien savoir pourquoi, il éprouvait un certain soulagement à parcourir ces milliers de milliers de pages, rédigés par des hommes qui étaient, à la fois, d’une lenteur et d’une liberté qui l’émerveillait. Ils étaient si lourds, si opaques, comme s’ils avaient plus de chair que les hommes du XXIIe siècle ; et pourtant, parfois, il se surprenait à les croire infiniment plus subtils que ses contemporains les plus raffinés…
Une seconde fois, Markus jeta les yeux sur l’écran de son multiphone, pour constater qu’il était, cette fois-ci, bel et bien en retard. Ce qui était, d’ailleurs, une façon de parler ; car il était désormais impossible d’être en retard sur son lieu de travail, ce dernier étant connecté, dès l’engagement de l’employé, au système de centralisation informatique de son appartement, afin de pouvoir y programmer une alarme de rappel, dans le cas où ledit employé y serait encore localisé automatiquement (tous les multiphones étaient munis d’un système de positionnement par satellite sur lequel pouvaient, en toute légalité, se connecter les employeurs d’État), à l’heure où il devrait l’avoir quitté (le temps de trajet était calculé de manière automatique, en fonction de la circulation du moment). Markus n’était donc pas à proprement parler en retard, mais l’heure de son retard approchait. Il rangea d’un geste vif son multiphone dans la poche de son pantalon, s’empara des cartes de verrouillage de son appartement et de son automobile, jeta un dernier regard agressif à son orchidée puis sortit, quelques minutes avant que l’alarme professionnelle n’illumine l’écran-mur des lieux.
(…)
***
6. La poésie (Fragile impuissance)

I.
De l’ombre descendante,
Je recueille la voix,
Timide et pleine d’hésitations insaisissables.
Je l’entends, pourtant, ou plutôt la devine,
Qui chante dans une langue où l’ineffable s’éveille aux sens,
Je l’entends désigner l’instant de l’union
Du ciel et de la mer.
Tout ensemble vient à moi
Par l’ombre descendante.
Et tout ensemble remonte par moi
Vers le lieu où s’entremêlent
Le ciel et la mer.
III.
Vois-tu, au loin,
Contre le vieux mur plein de mousse qui
Se lézarde sous les arbres,
Vois-tu l’étincelle que porte jusqu’à lui
Le soleil de midi ?
Le vieux mur resplendit, et sa lézarde soudain
Darde,
Dirait-on,
Des rayons rouges et or,
Qui se prennent au jeu de la mousse,
Et grimpent.
Vois-tu, aussi,
Contre ce mur incertain, qui tremble
Dans la lueur chaude,
Vois-tu l’ombre qu’y porte mon
Front, penché ?
Je prends là, sais-tu,
Des leçons de lumière,
Comme un lézard dont l’âme est plus froide que le sang,
J’épouse l’éclatant soleil de
Midi.
Un souffle, infime,
Suffit
Pour souffrir.
Une flamme, infirme,
Suffit
Pour s’ouvrir
Au silence qui tourne et nous contourne,
Et cherche à faire en nous son lit.
V.
J’ai bu la lumière
Et j’ai recraché l’ombre.
C’est toi qui m’apprit
– Ô, si tôt… –
À ne pas rêver la bouche pleine
D’autre chose que du ciel.
VI.
Voici que s’avance l’homme tout de noir vêtu,
L’homme droit à moi venu.
Voici qu’il marche sur moi et me fixe de son œil
Sans regard.
Sa voix cependant,
Je la connais :
C’est la mienne, oui,
C’est la mienne, sa voix, mais à l’envers.
Car il parle au dedans
Et c’est en silence qu’il s’avance
Vers moi.
Devant l’homme tout de noir vêtu,
J’ai voulu
Reculer. Et puis crier.
Mais c’était en lui qu’était ma voix
Et je n’avais plus
Pour moi
Que le mutisme au-dehors.
Moi, j’étais noir au dedans.
Je n’ai pu échapper
À la chasse de l’homme tout de noir vêtu
Et qui m’a pris mon âme, après m’avoir pris ma
Voix.
Car c’était moi,
Tout à l’envers.
Bibliographie
Octave Loriot, Les Malheurs d’Héloïse et Abélard, Julliard, 2017.
Mik Ezdanitoff, In Vitro, par Actes Sud, coll. « Exofictions », 2017.
Alba Vadius, Fragile impuissance, Obsidiane, 2017.
Si vous avez lu ce papier jusqu’au bout, vous aurez sûrement remarqué la délicieuse ironie de notre contributeur qui a tenté de reproduire, dans ces quelques extraits, les habitudes de plume les plus répétitives des habituelles rentrées littéraires. Aussi, consolez-vous : si certains de ces extraits vous agréent, il vous suffira de vous rendre dans n’importe quelle librairie achalandée « Rentrée littéraire », d’y puiser un ouvrage au hasard, en ayant choisi au préalable le genre correspondant à vos espoirs, et vous y retrouverez, en substance, tout ce qu’Emmanuel Ganse, Octave Loriot, Alba Vadius ou Mik Ezdanitoff ont suscité en vous d’enthousiasme. C’est aussi une façon de célébrer tous ces écrivains inconnus qui, chaque année, essaient de trouver une place au sein d’un marché de plus en plus saturé par des productions calibrées. Lecteur, je compte sur toi pour sortir des sentiers battus et faire ainsi plaisir à tous les écrivains qui ont assez de talent pour n’être pas devinés sous ces multiples pseudonymes.