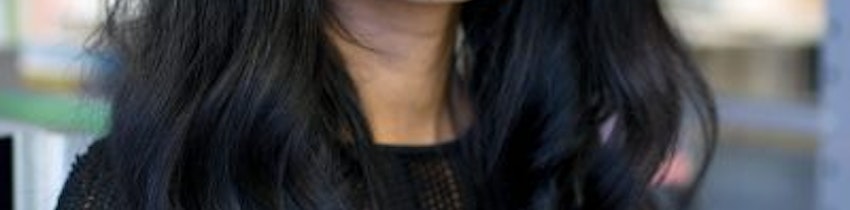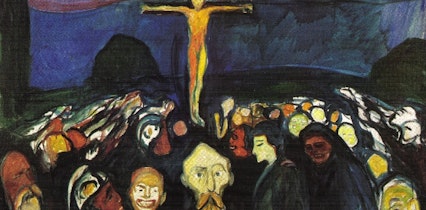Dans la première partie du roman, ces histoires entrelacées évoquent respectivement la composition d’un poème hérétique, l’étrange vision d’une fille se transformant en vieille femme, un homme qui mange de l’argent et un autre qui dévore des crocodiles. Au détour des pages surgit à plusieurs reprises la figure du dictateur ougandais Amin Dada, dont l’évocation récurrente sonne « comme un hommage macabre au perpétuel pourvoyeur de douleur qu’il fut ». Ávila Laurel fait de l’acte de la narration un facteur d’unité et de solidarité : « j’en viens presque à croire qu’on vivait tous au même endroit… », admet l’un des personnages en évoquant son passé. Entre visions fantastiques et anecdotes douloureuses, le récit oppose au dénuement et à l’attente des migrants les échos d’une fraternité africaine forgée dans la circulation de leurs paroles et la rencontre de leurs souvenirs.
Football, mythes et drames
Dans la deuxième partie du roman, cette fraternité est portée par le football, sport incarnant dans l’esprit collectif – à l’image du « chef des chefs » Samuel Eto’o – le rêve d’une réussite planétaire qui demeure néanmoins inaccessible pour les migrants. Sur le mont Gourougou, le ballon n’arrête pas de rouler, métaphore obstinée d’un mouvement salutaire au milieu de la stagnation et du désespoir : « C’était le seul moyen – bouger, continuer à bouger, jouer – pour retrouver la chaleur qui réconfortait quelques heures par jour ». Source avérée d’énergie physique et promesse suspendue d’une reconnaissance universelle, le football offre aux migrants un espace de liberté mais n’empêche ni l’éclosion des rivalités entre les différentes nationalités ni le retour du désespoir planant sur la montagne.
Sur le mont Gourougou, le ballon n’arrête pas de rouler, métaphore obstinée d’un mouvement salutaire au milieu de la stagnation et du désespoir
Ici, le récit superpose le mythe d’Omar Salanga, « homme désinhibé » connu aussi bien par ses faits de terreur que par ses baignades tout nu dans les rivières, au drame de deux femmes sur le point de perdre la vie faute de soins hygiéniques. Ávila Laurel décrit un huis clos à ciel ouvert où détresse, manipulation et violence donnent à lire des corps endoloris et des vies sans cesse menacées. Au fil des pages, il en vient à interroger l’identité africaine, objet d’une fierté minée par la soif et la quête du pouvoir: « C’est l’histoire de quelques Africains qui attrapent d’autres Africains par la gorge et leur frottent le visage dans la misère qu’ils ont créée ensemble, pendant que d’autres, stupéfaits, applaudissent ». Derrière le destin des habitants du mont fuse une critique sous-jacente des systèmes d’exploitation qui ne génèrent que chaos, misère et amertume sur le continent. Piégés entre les barbelés espagnols et les gardes-frontières marocains, les personnages s’accrochent à la charité des villages voisins et aux derniers signes de vie sur la montagne. Le roman résonne particulièrement avec l’actualité, notamment au nord du Maroc où les efforts d’intégration et d’accompagnement des migrants ont laissé place ces derniers mois à des opérations de ratissage, de transfert et de déplacement forcé.
Le souffle de la montagne
En optant pour un récit alambiqué et souvent confus, alternant les voix et variant les perspectives, Ávila Laurel cherche à dire l’éclatement inévitable du drame des migrants africains. En perturbant sans cesse la linéarité du récit et en jouant des interruptions et des reprises, l’auteur invite à penser l’insaisissable et l’indicible de la migration. L’intérêt porté à la montagne marocaine révèle un besoin d’ancrer le récit dans ces lieux d’attente et de transition où le sujet africain devient la proie facile d’une violence généralisée. Dans la troisième et dernière partie du roman, intitulée « Le Début et la Fin », un autre narrateur, témoin de la violence subie par les enfants albinos, ouvre une énième blessure dans le corps africain et éclaire le choix initial de l’auteur : « L’histoire d’un continent qui se vide pour en remplir un autre doit être racontée depuis là où elle se fait. Sinon, ce serait comme avoir un objet en deux morceaux, dont l’un serait perdu ; un tel objet, un tel outil ne servirait plus à rien ». Le mont Gourougou est le lieu d’une question ouverte : comment continuer à raconter la vie et les blessures de nos frères migrants ? Comment faire du récit un outil ancré dans le lieu même de la déchirure ?
En perturbant sans cesse la linéarité du récit et en jouant des interruptions et des reprises, l’auteur invite à penser l’insaisissable et l’indicible de la migration.
Si la structure complexe du récit et l’enchaînement vertigineux des dialogues et des séquences narratives risque de perdre le lecteur ou du moins de lui faire perdre par moments le contact avec le vécu des migrants, l’auteur se rattrape en livrant des scènes puissantes où la frontière entre le tragique et le poétique se trouve dépassée, à l’image de cette évocation de deux femmes se tenant sur la barrière barbelée de Melilla, « les jambes pendant de chaque côté, comme si elles avaient voulu chevaucher un mystérieux cheval, né pour n’être jamais monté, à la robe et à la crinière épineuses ». Par ailleurs, l’évocation régulière de proverbes africains reproduit au cœur du récit la voix d’une sagesse populaire qui résiste à la logique de la violence dominante : « ne juge pas à la hâte la qualité des dents de celui à qui ta bouche tout entière pourrait revenir un jour » ou encore : « le poisson fumé ne peut se remettre à nager dans le fleuve ». C’est dire si Sur le mont Gourougou est aussi un roman sur ces autres lieux de la parole africaine qui interrogent à leur manière le rêve du départ et l’espoir du retour. Prise en tenaille entre l’expression de ces deux désirs inassouvis, une montagne africaine raconte les blessures et les désillusions des hommes qu’elle accueille sur ses flancs. Il y a là la métaphore d’une littérature qui cherche aux côtés de Mère-Nature l’espoir d’une délivrance par le souffle combiné du récit et de la mémoire car, nous dit l’auteur, « le mont est comme une immense maison aux oreilles innombrables entraînées à tout retenir ».
- Juan Tomás Ávila Laurel, Sur le mont Gourougou. Traduction de Maïra Muchnik. Asphalte Editions, 180 p., 19€