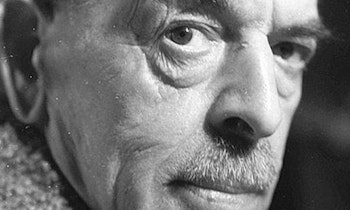Si intimidantes que fussent toujours pour moi les veilles de départ, celle-ci devait l’être tout particulièrement, puisqu’il s’agissait cette fois-ci de partager le séjour aux sports d’hiver de la famille Duchesne. Après d’interminables mises en gardes, Maman avait finalement consenti à me laisser accompagner mon ami Amaury en Suisse.
Cette nuit-là, alors qu’une pluie sale tombait avec acharnement contre la fenêtre de ma chambre, je m’endormis en songeant à d’infinies étendues opalines, poudroyantes au soleil des sommets,
Nous nous étions rencontrés l’an dernier, lors de mon entrée en sixième au Collège Saint-Dominique où, par le plus grand des hasards nous nous retrouvâmes assis côte à côte pour la leçon de latin dispensée par M. Turpin. Tandis que j’atteignais au comble de l’ahurissement devant cette langue mystérieuse, son sourire compatissant m’avait distrait pour un bref instant de l’étude du gérondif absolu. Cependant que son regard pétillant au travers de ses lunettes cerclées d’écailles se portait avec une amicale bienveillance sur mon visage confus, il glissa discrètement vers moi sa version admirablement rédigée ; et je vis alors sur ces deux pages piquetées d’une écriture régulière et penchée, scintiller comme autant d’astres sombres d’innombrables locutions dont les sonorités solennelles me rappelaient les longues litanies entendues chaque dimanche à la chapelle de Saint-Eustache, durant ces belles cérémonies auxquelles mes parents et moi-même ne manquions jamais de nous rendre, bien plutôt d’ailleurs par tradition familiale immémoriale que par dévotion véritable. Venait alors de se nouer une amitié longue et constante, qui devait m’amener, moins de deux ans plus tard, à partager pour mon plus vif bonheur la villégiature helvétique où Amaury allait chaque année passer des vacances « à la neige », selon l’expression consacrée, laquelle a pour avantage principal de désigner sans ambiguïté, par métonymie, l’objet premier des désirs de tous ceux dont, une fois par an, les automobiles allaient encombrer les chaussées d’altitude, se précipitant vers les cimes ainsi qu’un interminable cortège d’animaux mécaniques, pour l’accomplissement mystérieux mais aussi nécessaire que régulier d’une migration moderne dont les délassements sportifs étaient l’ultime motif. Cette nuit-là, alors qu’une pluie sale tombait avec acharnement contre la fenêtre de ma chambre, je m’endormis en songeant à d’infinies étendues opalines, poudroyantes au soleil des sommets, à la surface desquelles dansaient, entre mille étincelles splendides, de petits êtres comiques, qui lançaient vers l’azur les longs bâtons dont leurs bras étaient prolongés, et dessinaient sur la blancheur du sol d’interminables sillons spiralés, qui allaient s’entrecroisant au loin, derrière des sombres touffes de sapins dont les pointes altières, dodelinant au vent, semblaient caresser le ciel avec douceur.
Je sentis mon estomac se nouer peu à peu, cependant qu’un étau, timide encore, se refermait sur mes tempes
Bien que progressant à une vitesse excessivement prudente, la voiture serpentait avec obstination sur les sinuosités d’une étroite route de montagne, tandis qu’en contrebas le Rhône disparaissait peu à peu sous d’épaisses couches de nuages dans lesquelles nous nous enfoncions en espérant surgir bientôt dans l’éclatante lumière du blanc soleil helvétique. Tassé au fond des sièges molletonnées de la Mercedes familiale conduite d’une main hésitante par Monsieur Duchesne qui, semblables en cela à tant d’autres Français dès lors qu’ils outrepassent les frontières de leur propre pays, perdait conjointement sur les routes étrangères de sa superbe et de son assurance, je fus soudain saisi d’une insidieuse torpeur. Je sentis mon estomac se nouer peu à peu, cependant qu’un étau, timide encore, se refermait sur mes tempes. Amaury, profondément plongé dans la lecture des Bijoux de la Castafiore, paraissait bien loin de partager le croissant malaise qui m’envahissait. Tentant maladroitement de me redresser afin de fixer un point à l’horizon, mon regard découvrit dans le rétroviseur intérieur l’ovale harmonieux du visage soudainement livide de Madame Duchesne. Par une inexplicable coïncidence, ce fut cet instant qu’elle choisit pour presser anxieusement le bras de son mari ; et lui glisser d’une voix faible et distinguée : « Mon chéri, peux-tu arrêter la voiture ? Je ne me sens pas très bien ». Notre ascension fut prolongée de deux ou trois autres immobilisations nécessaires à l’équilibre des flux gastriques de la passagère fragile, qui me permirent, dans un silence que je bénissais longuement car il m’évitait le ridicule d’exposer à d’autres que moi-même les faiblesses de ma propre oreille interne, d’atteindre le village de Verbier, notre destination, sans autre désagrément qu’une persistante mais légère nausée. Le chalet où nous arrivâmes était somptueux ; mais je n’eus guère le temps d’en découvrir alors les charmes, car l’excitation de mon ami Amaury était si grande qu’il obtint sans peine de ses parents que, sans prendre même le temps de défaire nos valises, nous entreprenions immédiatement notre première conquête des pistes. Nul n’y trouva à redire, et une heure plus tard, nous étions installés, deux par deux, sur les inconfortables sièges d’une remontée mécanique dont les câbles disparaissaient, au-dessus de nos têtes, dans les étincellements incessants de la lumière de midi.
Madame Duchesne gardait, engoncée dans sa tenue bariolée, l’élégance si distinctive de ces femmes indolentes et oisives dont sont peuplés les beaux appartements du centre de Paris.
Malgré le ridicule que donnent aux corps et à la démarche cette pesanteur vestimentaire propre aux sportifs des sommets, pesanteur si semblables à celles des astronautes qui, de leur pas lent et lourd agitent leurs formes obèses dans le silence infini de ces espaces immaculés, ou plutôt à la démarche maladroite de ces drôles d’animaux incapable de voler et qui se déplacent pourtant vaillamment en file indienne au flanc des longues dunes enneigées de la calotte glaciaire, Madame Duchesne gardait, engoncée dans sa tenue bariolée, l’élégance si distinctive de ces femmes indolentes et oisives dont sont peuplés les beaux appartements du centre de Paris. Elle portait la doudoune à ravir. J’observais du coin de l’œil les ondulations que provoquait dans ses cheveux la lumière réfléchie par les étendues opalescentes dont l’agressive clarté ne parvenait pas à égaler les scintillations profondes de ses yeux. Raidis par le froid et la timidité, je n’osais entamer la conversation, quand soudain s’interrompit le grincement régulier de la remontée mécanique, et avec elle notre ascension. Aux grands gestes du père d’Amaury installé dans le télésiège devant nous, je devinais qu’il tentait de nommer, en les désignant de ses doigts épaissis par de vieux gants noirs, les différents massifs qui nous entouraient. Entre deux bourrasques bruyantes, je distinguais quelques brides de ses explications géographiques : « Tu vois Amaury, là-bas c’est le col des Aiguillettes, et derrière, c’est le massif de la Grande Chevreuse où culmine la dent du Guignol… ». Les mouvements excessivement enthousiastes de Monsieur Duchesne imprimaient au télésiège dans lequel il se trouvait une oscillation dont l’amplitude grandissante me terrifiait.
Les mille roses de mon émerveillement devaient rester à jamais fleurissantes pour moi seul, dans un coin secret de mon âme où elles avaient pour seul vase ma timidité maladive.
Alors, un incontrôlable réflexe me fit saisir la main dégantée de Madame Duchesne ; le contact impromptu de sa peau provoqua en moi un indicible trouble. Quoique surprise, mais toujours bienveillante et maternelle, elle se tourna vers moi et me dit d’un air grave, en esquissant un léger sourire : « Un grand garçon comme toi, ça n’a peur, n’est-ce pas ? ». Soudain percé à jour dans ma lâcheté enfantine, comme dénudé par son regard en dépit des multiples couches de vêtements qui recouvraient mon corps chétif, je puisais aux plus profondes sources de mon courage pour lui assener d’un ton que j’espérais assuré, malgré ma voix tremblotante : « Quand je suis avec vous, je n’ai peur de rien ». Le lent crissement métallique qui annonçait la reprise de notre ascension accompagna comme un contrepoint glaçant le rire nerveusement retenu de Madame Duchesne. Ce fut la première et l’ultime tentative, de ma part, de faire un compliment à cette femme dont la prestance infinie me fascinait, et qui devait désormais me paralyser au point de tenir toujours contenues au fond de ma gorge toutes les faramineuses formules que je rêvais de pouvoir lui jeter au visage ainsi qu’un bouquet d’odorantes roses blanches, avec autant d’élégance qu’elle n’en mettait à me relever en riant lorsque, débutant maladroit, je tombais tête la première dans la neige, à ses côtés. Je me contentais donc, par la suite, de l’admirer en silence ; et les mille roses de mon émerveillement devaient rester à jamais fleurissantes pour moi seul, dans un coin secret de mon âme où elles avaient pour seul vase ma timidité maladive.
Quelques jours plus tard, j’étais à nouveau assis à l’arrière de la berline aux sièges profonds, où je m’enfonçais inexorablement, malgré mon désir ardent de me hausser le col afin de pouvoir contempler, défilant sous la fenêtre, les béantes splendeurs des vallons où nous allions, sinueusement, avec lenteur, presqu’avec langueur, comme si la voiture elle-même espérait pouvoir prolonger encore de quelques instants, volés à l’inévitable conclusion, les délices innombrables des sommets. Le soleil déclinait ; il enflammait un interminable mur que notre automobile avait à longer avant d’arriver au fond de la vallée, mur sur lequel l’ombre de la voiture, projeté par le couchant, se détachait en noir du fond rougeâtre, comme un char funèbre de terre cuite de Pompéi. C’était l’heure du retour.
Jacques Pauchade