
Pour accompagner votre confinement et vos vacances de Noël, Zone Critique lance sa rubrique “Les classiques” de la rédaction” ! Chaque semaine, l’un de nos rédacteurs vous présentera une œuvre qui l’a particulièrement marqué, et tentera de vous donner envie de la lire, si ce n’est pas encore fait. Pour ce second numéro Zone Critique vous présente le roman Les quatre filles du docteurMarch de Louisa May Alcott et en profite pour se poser cette question : faut-il moderniser les classiques ?
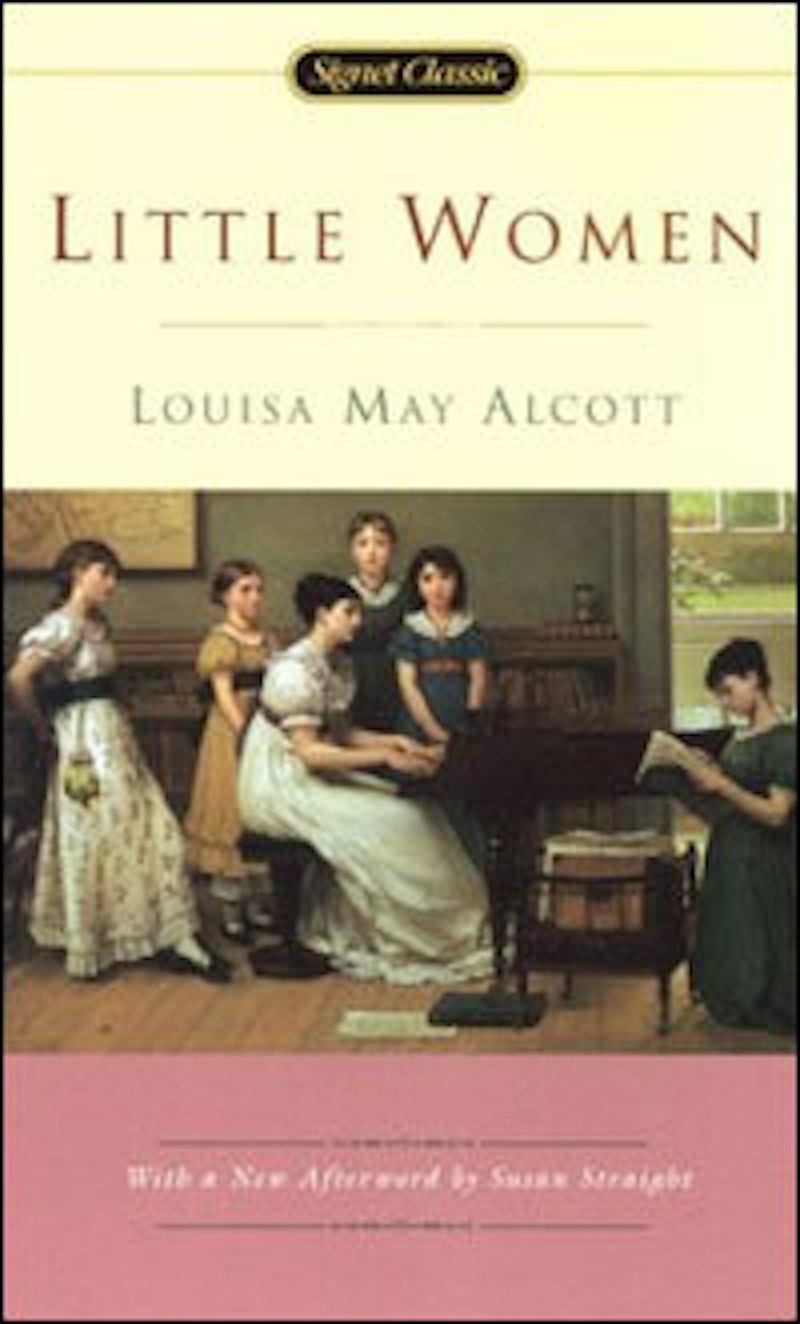
Lorsque l’on connaît la dévotion particulière que suscite cet ouvrage, et la défiance naturelle des lecteurs lors du passage d’un texte au grand écran (qui n’est jamais sorti d’une salle de cinéma en se plaignant de tel ou tel changement infligé à l’intrigue de son roman fétiche ?), les gros titres tels que « Les quatre filles du docteur March : les fans du livre saluent l’infidélité de l’adaptation2 » ont de quoi interroger. Loin d’être une anomalie, cette réception est intimement liée à la démarche artistique et politique de la réalisatrice, laquelle me semble s’inscrire dans une tendance culturelle plus large.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec l’œuvre de Louisa May Alcott, une remise en contexte est nécessaire (pour les autres, vous pouvez toujours sauter quatre paragraphes). Paru en 1868-1869, Les quatre filles du docteur March, ou Little women dans la version originale, raconte l’histoire de quatre sœurs adolescentes : la romantique Meg, l’impétueuse Jo, la discrète Beth et la capricieuse Amy. Le premier tome se déroule en Nouvelle-Angleterre, pendant la guerre de Sécession. Le père est absent, parti combattre aux côtés des nordistes. La famille March, autrefois aisée, a été réduite à la pauvreté par un revers de fortune.
Un portrait vivant et subtil d’une sororité
Le récit commence le soir de Noël, où chacune des sœurs reçoit pour unique cadeau un exemplaire du Voyage du pèlerin, ouvrage allégorique protestant racontant le chemin vers la délivrance divine d’un protagoniste nommé (fort à propos) Chrétien. Inspirées par cet édifiant récit, elles prennent la décision de travailler sur leurs défauts respectifs pour devenir de meilleures versions d’elles-mêmes. Cette résolution servira de fil rouge à l’histoire, et les aventures que les héroïnes traversent sont autant de mise à l’épreuve de leur caractère. Au passage, leur mère leur inculquera les joies du don de soi, les vertus du travail, et l’importance des travaux ménagers. Le deuxième tome, intitulé (fort à propos aussi) Le docteur March marie ses filles (Good Wives), raconte leur entrée dans l’âge adulte et les inévitables unions qui s’ensuivent.
Rares sont les livres qui explorent avec autant de tendresse et d’humour les relations sororales, avec leurs joies, leurs rivalités, leurs déchirements et leurs réconciliations.
La plus célèbre des quatre sœurs est sans contexte Jo March, la cadette. Intelligente, sensible, colérique, elle ne correspond en rien au portrait de la jeune fille modèle de l’époque, et regrette amèrement de ne pas être un garçon. Les tâches ménagères la rebutent, la mode la laisse froide, elle ne s’intéresse à l’amour que dans les romans qu’elle lit avec avidité. Dans le deuxième tome, Jo, déterminée à rester vieille fille, part à New York poursuivre ses ambitions littéraires, car elle rêve depuis toujours de devenir écrivaine. Seulement voilà ; elle y rencontre un professeur allemand, qui a vingt ans de plus qu’elle et qu’elle finira par épouser. Celui-ci est décrit comme n’étant ni extrêmement séduisant, ni particulièrement spirituel, mais très bon et très pieux. Des qualités certes fort louables, mais peu à même d’enflammer l’imagination des jeunes lecteurs, qui ont été nombreux à être très déçus de cette union. Plus grave encore, Jo s’arrête d’écrire après son mariage. Les conventions triomphent donc.
Un dénouement cinématographique alternatif
En 2019, Greta Gerwig propose un dénouement alternatif. À la fin du film, Jo March rédige un manuscrit qui raconte l’histoire de sa famille. Elle le soumet à un éditeur, lequel accepte de le publier, à condition qu’elle en change la fin : l’héroïne, qui était censée rester vieille fille, doit selon lui se marier. L’écrivaine cède, et modifie l’histoire. La dernière séquence du film consiste en des plans alternés, comparant la fin conventionnelle voulue par l’éditeur, et la fin « réelle ». D’un côté, nous voyons Jo March et son futur époux s’embrasser passionnément sous un parapluie. De l’autre, Jo March, célibataire, négocie un contrat d’édition avantageux, et devient une véritable autrice avec la publication de son roman, Little women.
En s’appuyant sur la correspondance et le journal de Louisa May Alcott, Greta Gerwig affirme que l’autrice a été forcée par son éditeur à marier Jo, qui devait à l’origine rester vieille fille. Elle rappelle, avec raison, que Les quatre filles du docteur March est un récit partiellement autobiographique ; on retrouve beaucoup de l’autrice elle-même dans le personnage de Jo. Or, Louisa May Alcott ne s’est effectivement jamais mariée, et a atteint l’autonomie financière grâce à ses livres. Greta Gerwig fusionne donc la créatrice et son personnage, et en conclut que son film donne à l’intrigue la fin que son autrice aurait voulue, si elle avait pu la choisir librement3.
Que signifie exactement « se débarrasser de la morale » d’un livre qui, on l’a rappelé, fonde sa narration sur un récit religieux, et a une volonté didactique assumée ?
Cette fin, amplement commentée, est à l’image de l’ensemble de son adaptation. Sa lecture consisterait à séparer les parties du texte reflétant les véritables valeurs de l’autrice, et celles correspondant à des ajouts artificiels rendus inévitables par l’époque à laquelle elle vivait. En suivant cette méthode, la réalisatrice relit Little women comme un manifeste féministe contemporain, tout en assurant rester très proche de l’œuvre originale. Elle le formule ainsi : « Tous les [dialogues] sont tirés du livre ou des journaux, lettres, et autres écrits de Louisa May Alcott. En se débarrassant de la morale prévictorienne4, on découvre ces jeunes filles ambitieuses, passionnées, colériques, sensuelles et intéressantes, qui ne rentrent pas dans les cases que le monde leur a données5. » Un parfait compromis entre fidélité et actualisation, semblerait-il donc, et la majorité des critiques de s’émerveiller de la modernité du film de Gerwig. Mais que signifie exactement « se débarrasser de la morale » d’un livre qui, on l’a rappelé (dans les paragraphes que vous avez sautés), fonde sa narration sur un récit religieux, et a une volonté didactique assumée ? La comparaison de passages du texte original avec leur traitement dans l’adaptation cinématographique de 2019 apporte quelques éléments de réponse.
Meg, l’aînée des sœurs March, souffre de vivre dans la pauvreté et de devoir travailler alors qu’elle rêve de fréquenter les bals et les théâtres, comme les jeunes gens de son entourage. Elle est coquette, mais ne possède qu’une robe de tarlatane, qui lui parait bien misérable devant les somptueuses toilettes des filles plus fortunées. À l’occasion d’un bal, une riche amie lui prête une belle robe de soie, la poudre, la corsète et la frisotte. Pendant une soirée, Meg boit du champagne, danse, et flirte. Lorsqu’un proche de la famille March lui reproche son attitude et sa tenue, elle lui rétorque dans le roman : « Demain, je rangerai mes plumes et mes falbalas dans l’armoire, et je serai de nouveau d’une sagesse désespérante. » Le film reformule la réplique : « Laisse-moi m’amuser ce soir, et je serai d’une sagesse désespérante pour le restant de mes jours. », et conclut ainsi la séquence.
Le livre précise cependant que Meg ne s’amuse pas vraiment au cours de ce bal, et trouve sa propre conduite scandaleuse. Rentrée chez elle, elle se confesse à sa mère : « je me suis comportée d’une manière abominable ». Elle se rend compte que le luxe qui la faisait tant rêver ne lui apporte pas le bonheur qu’elle en attendait, que ses amis riches mènent une vie frivole et vide de sens, et qu’en les imitant, elle perdrait le respect d’elle-même. Dans le roman, cette « foire aux vanités » — c’est le nom du chapitre — est l’occasion pour Meg de se guérir de son attirance pour les mondanités. Elle choisira par la suite d’épouser un homme pauvre, mais intelligent et vertueux, et de vivre modestement. Le film, souhaitant probablement éviter de punir Meg pour s’être amusée, supprime totalement ce passage, et sacrifie au passage une étape essentielle de la construction du personnage. Le bal est traité comme un moment de joie pure, contrastant avec une vie de privations. Exactement l’inverse, donc, du message du livre.
Dans un autre épisode, Jo, aveuglée par la colère, expose sans le vouloir sa petite sœur Amy à un danger mortel. Amy s’en sort finalement saine et sauve, mais Jo est rongée par le remords, et se confie à sa mère « Quand je perds la tête, je suis capable de tout. Je crois que je pourrais m’acharner sur quelqu’un et y prendre plaisir. J’ai bien peur qu’un de ces jours je fasse quelque chose d’abominable. » Sa mère lui révèle alors qu’elle était pareille dans sa jeunesse. Face à la surprise de Jo, elle explique « Je me mets en colère presque tous les jours, mais j’ai appris à ne pas le montrer. » Admirative, Jo décide de suivre son exemple : « Oh Maman ! Si seulement j’arrive à être à moitié aussi bonne que toi, je serai satisfaite ! » « J’espère que tu seras meilleure, ma chérie », lui répond sa mère.
La féministe Adrienne Rich cite ce passage du roman dans son ouvrage Naître d’une femme, en le commentant ainsi : « Je me souviens d’un endoctrinement similaire dans ma propre enfance : mon “mauvais caractère” était une tache sombre et malfaisante en moi, et non une réponse aux événements du monde extérieur. Mes colères enfantines étaient appelées des « crises », ce qui était pour moi la manière adulte de dire que j’étais possédée, comme par un démon6. » Elle lit cet extrait dans le contexte d’une culture visant à réprimer certaines émotions féminines, perçues comme non légitimes ou même dangereuses. Cette interprétation met au jour un aspect du texte qui entre directement en contradiction avec la réactualisation féministe que Greta Gerwig cherche à opérer.
Une modification profonde de l’esprit du roman
La réalisatrice résout cette difficulté en modifiant la conclusion de la scène. La mère de Jo lui dit donc désormais : « J’espère que tu feras bien mieux que moi. Il y a des natures trop nobles pour être soumises, et trop fières pour s’incliner7 ». En ajoutant cette dernière phrase (et en remplaçant le verbe « être » par le verbe « faire », plus actif), Greta Gerwig change l’entièreté du discours, éliminant toute idée de rédemption. Il ne s’agit plus de dompter son caractère, mais de le célébrer. La modification est là encore significative en termes de construction des personnages et de logique narrative. Elle apparaît étrange dans le contexte de l’histoire : il est quelque peu illogique que la mère de Jo choisisse de louer le tempérament de sa fille, alors même que celui-ci vient de mettre en danger l’une de ses sœurs. La phrase que Greta Gerwig rajoute au dialogue est tirée d’une lettre de la mère de Louisa May Alcott à l’autrice. La réalisatrice ne se contente donc pas de lire délibérément la scène à contresens ; en se donnant cette caution historique, elle semble encore une fois suggérer qu’elle révèle le « véritable » message du livre.
Ces procédés d’omissions, de réécriture, de rajouts de citations exogènes et décontextualisées sont utilisés tout au long de l’adaptation et mettent à mal l’intégrité narrative de l’œuvre.
Ces procédés d’omissions, de réécriture, de rajouts de citations exogènes et décontextualisées sont utilisés tout au long de l’adaptation. Comme le montrent les exemples ci-dessus, ils mettent à mal l’intégrité narrative de l’œuvre. Loin d’être de simples ajouts contingents destinés à contenter un éditeur réactionnaire, les valeurs morales structurent le récit et les personnages. Les quatre filles du docteur March est un roman d’initiation au féminin, dont la spécificité et l’originalité tiennent au fait que l’initiation passe ici avant tout par une lutte contre soi-même. Dans la célèbre lettre que le père, parti au front, adresse à ses filles, il les engage à « combattre courageusement leur ennemi intérieur ». Dans la version de Greta Gerwig, elles doivent désormais « combattre courageusement leurs ennemis ». Le doute, la remise en question, et le travail sur soi, absolument centrales dans le roman, passent à l’arrière-plan. Les jeunes filles deviennent presque, selon l’expression de Grewig des « super héroïnes8 » en costumes d’époque, sans peur ni reproche.
Or, la force du texte original est précisément de permettre à des forces contradictoires de coexister et de s’affronter dans les personnages, les rendant complexes, attachants et intemporels. Les quatre filles du docteur March est bien un texte féministe, en ce qu’il prend les femmes comme sujets et traite de leurs préoccupations et de leur quotidien sans condescendance. Simone de Beauvoir exprime ceci avec éloquence : « Il y eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin : Les quatre filles du Docteur March, de Louisa May Alcott. (…) Je m’identifiai passionnément à Jo, l’intellectuelle. (…) Je me crus autorisée moi aussi à considérer mon goût pour les livres, mes succès scolaires, comme le gage d’une valeur que confirmerait mon avenir. Je devins à mes propres yeux un personnage de roman9. »
Un film dans l’air du temps ?
Cependant ce féminisme est indissociable d’une certaine conception de la féminité, laquelle est bien entendu liée à un contexte historique extérieur, mais aussi réappropriée et revendiquée par les personnages. Cette ambivalence résonne toujours avec autant de force aujourd’hui. Nos convictions personnelles et nos comportements restent indissociables de l’époque à laquelle nous vivons, et des valeurs auxquelles nous sommes exposés. En cherchant à gommer cet aspect, l’adaptation de Gerwig rend l’histoire au mieux anecdotique, au pire incohérente.
L’enthousiasme qu’a suscité le film s’explique cependant aisément. D’abord il est visuellement très réussi. Ensuite, il est porté par une excellente distribution. En plus d’être talentueuses, ses actrices jouissent d’un fort capital sympathie, et leurs carrières font écho aux thèmes du film. Emma Watson ou Meryl Streep, par exemple, sont dans l’imaginaire collectif les incarnations d’un féminisme moderne et pop. Enfin, les faiblesses d’écriture sont largement camouflées par le choix d’une narration éclatée, construite sur une multitude de flash-back et des passages incessants d’une intrigue à l’autre. Cela permet à Greta Gerwig d’insuffler le dynamisme nécessaire à un récit qui aurait sans doute été assez statique autrement, car fondé sur des personnages évoluant peu. Ce procédé complique bien sûr la compréhension de l’histoire pour un spectateur non averti, mais ce film ne s’adresse pas à des spectateurs non avertis.
Greta Gerwig sait que son public est majoritairement composé de jeunes adultes ayant grandi avec le roman et ses précédentes adaptations. Sa grande réussite consiste à donner à ce public exactement ce qu’il recherche, c’est-à-dire à susciter chez lui une nostalgie réconfortante au travers de personnages familiers et aimés, tout en réaffirmant une vision du monde et des valeurs déjà largement partagées. La réalisatrice forge la version de l’histoire la plus conforme idéologiquement aux attentes contemporaines, et suggère dans le même temps que cette version a toujours été la bonne, la vraie, celle voulue par l’autrice. En vidant le récit de tout ce qu’il pourrait avoir de troublant ou d’étrange pour un spectateur moderne, cette lecture vise à rassurer bien plus qu’à innover ou subvertir.
Cette adaptation n’est pas un phénomène culturel isolé. Au contraire, elle me semble révélatrice de notre époque. Si les outils et les pratiques d’analyse féministe des œuvres culturelles ne sont pas nouveaux, ils n’ont jamais été aussi démocratisés. Ils rayonnent aujourd’hui bien au-delà des quelques départements universitaires qui les ont vus naître, ouvrant la voie à de nouvelles interprétations. On ne peut que se réjouir de cette vitalité critique. Le rabbin Delphine Horvilleur écrit : « les textes religieux crient : interprète-moi ! Fertilise-moi de ta lecture et ne me stérilise pas d’interprétations passées10. ». Elle souligne l’importance de « voix nouvelles, celles d’hommes et de femmes dont la parole est fécondante, porteuse de vie11. » Il me semble que cela est également vrai pour les textes littéraires. Se priver des possibilités multiples qu’offrent ces champs de réflexion reviendrait effectivement à appauvrir et pétrifier les classiques.
En arrachant un texte à son contexte historique, en passant sous silence ses aspects problématiques, ce sont nos propres ambivalences que nous cherchons à gommer.
Mais vouloir à tout prix qu’ils correspondent aussi parfaitement que possible à nos valeurs d’aujourd’hui n’est rien d’autre qu’un retour de cette morale didactique dont Greta Gerwig tentait justement de se débarrasser. En arrachant un texte à son contexte historique, en passant sous silence ses aspects problématiques, ce sont nos propres ambivalences que nous cherchons à gommer. Rejeter en bloc les interprétations féministes contemporaines ou s’y cantonner absolument, quitte à occulter le reste, revient au fond au même ; il s’agit de s’abîmer dans la célébration réconfortante d’un passé fantasmé. Cette sorte de mauvaise foi collective est peut-être le symptôme de notre malaise, notre incapacité à considérer notre histoire et notre héritage culturel de manière apaisée. Et pour cause ; alors même que les classiques sont censés nous aider à penser et panser le monde, l’évolution de nos valeurs morales nous les font soudain voir sous un jour bien sombre, ou tout au moins bien dérangeant. Pourtant, ils continuent d’être porteurs de vérités profondes et précieuses. Adresser ce paradoxe me parait, en définitive, essentiel pour éclairer un présent déchiré par les contradictions.
1 En 1917 par Alexander Butler, 1918 par Haley Knoles, 1933 par George Cukor, 1949 par Mervyn LeRoy, 1994 par Gillian Armstrong, 2018 par Claire Niederpruem et 2019 par Greta Gerwig. Le livre a également fait l’objet de nombreuses adaptations scéniques, musicales, télévisuelles…
2 https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/2690251-20200108-filles-dr-march-fans-livre-saluent-infidelite-adaptation-greta-gerwig
3 Greta Gerwig le dit explicitement dans plusieurs interviews : “my guiding light became “How do I not change what’s in the book, but bring out what’s already there, and how do I make a film that Louisa May Alcott would have liked?” https://www.thrillist.com/entertainment/nation/little-women-movie-2019-ending-greta-gerwig-interview
4 L’expression “prévictorienne” est surprenante ; Louisa May Alcott a écrit Little women en pleine époque victorienne. Peut-être Greta Gerwig fait-elle allusion au Voyage du pèlerin, publié en 1675. Pour le coup, c’est un peu trop pré pour être vraiment pré. Enfin, passons.
5 “every word is either from the book or Alcott’s journals, letters or another book she’s written. If you strip away this pre-Victorian morality, what you have is ambitious, passionate, angry, sexual, interesting women who don’t fit into the boxes the world has given them.” https://time.com/5743438/greta-gerwig-little-women-interview/
6 “I recall a similar indoctrination in my own girlhood : my “temper” was a dark, wicked blotch in me, not a response to events in the outer world. My childhood anger was often alluded to as a “tantrum”, by which I understood the adult word to mean some kind of possession, as by a devil.” Adrienne Rich, Of Woman Born, motherhood as experience and institution
7 “There are some nature too noble to curb, and too lofty to bend”
8 “Little Women: ‘The superhero origin story of girls who wanted more” https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-50835944
9Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir
10Comment les rabbins font les enfants, Delphine Horvilleur
11Ibid






































