
Le dernier recueil de Gérard Bocholier, J’appelle depuis l’enfance publié aux éditions La Coopérative, se présente comme une quête, lancée à corps perdu, vers l’indice d’une présence : un parent ou une fée, un mort ou un dieu – quiconque qui puisse promettre d’être là si le vent venait à souffler.
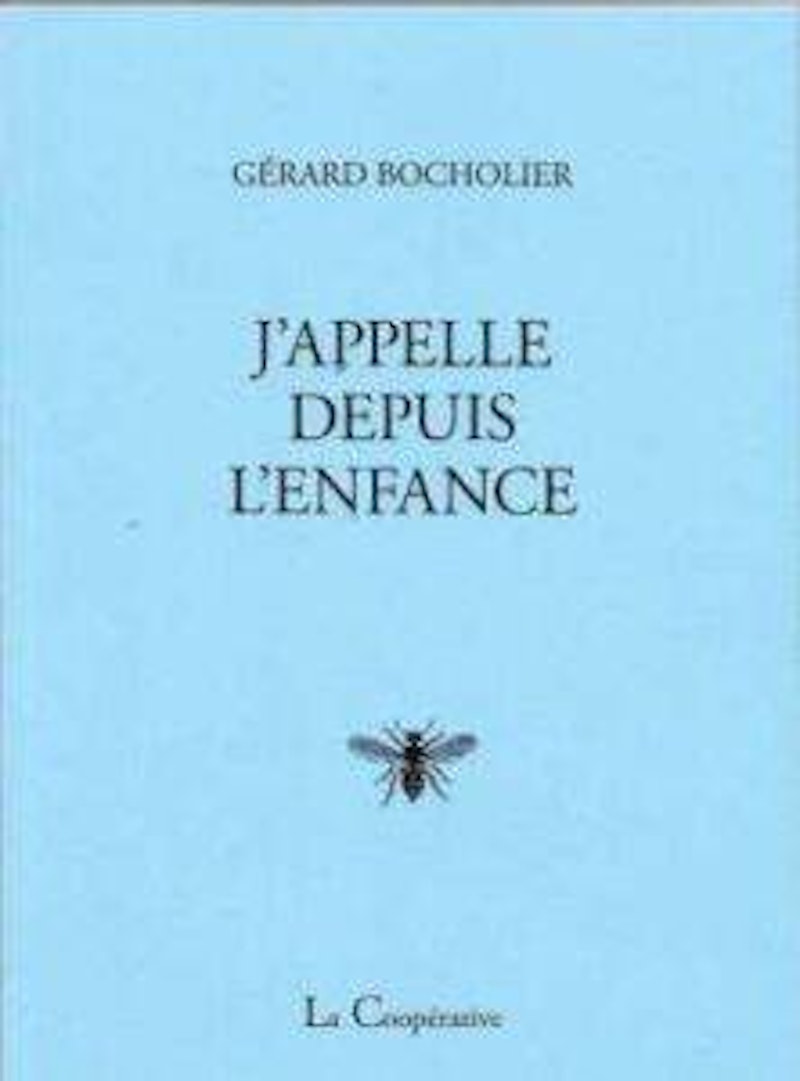
D’abord dans La Terre et les rêveries du repos, puis, plus tard, dans La Poétique de l’espace, Gaston Bachelard, en sa qualité de phénoménologue de l’imagination, s’intéresse aux transformations imaginaires que subit “la maison natale” dans la mémoire et l’esprit. Selon lui, la maison natale est construite et repose sur la maison onirique, une maison faite d’un « corps de songe », où les différents espaces sont chargés de signification.
C’est un lieu bâti sur des restes de rêves : malgré tout l’effort que l’on pourrait mettre à se le remémorer, il ne reste de lui, non le souvenir des jours qu’on a pu y passer, mais bien le souvenir des rêves que l’on y a eus. Ce n’est qu’au travers des impressions et des rêveries d’enfant que la maison natale peut se manifester sous la forme ambiguë de la maison onirique.
On s’y perd dans l’infini du temps où le réel s’efface : elle est cet appel d’une vie cellulaire, ce besoin d’être quelque part abrité. Qui s’en remet à ce rêve cherche à revivre en songe « dans toute leur variété les rêveries d’intimité ».
L’enfance est un lieu où il vente
C’est cette quête d’une intimité (re)trouvée – ou peut-être découverte, éprouvée en retard – qui anime les pages de Gérard Bocholier.
Puisque les soirs voient descendre
D’immenses draps sur les vignes
Devenues maigres orantes
Visages gris sous la bise
L’heure vient à la lisière
Les yeux pleins d’étoiles blêmes
Le vent risque son haleine
De prophète sous les portes
Puisque c’est l’heure où les âmes
Tentent d’allumer leur lampe
O la flamme est si tremblante
Comme la frêle espérance
Sur la vitre aux coins de givre
J’appelle depuis l’enfance
Dans la grande chambre vide
J’entends des pas qui s’approchent
Est-ce un ange ou bien mon juge ?
Dans ce poème liminaire, nous découvrons les motifs que l’on croisera tout au long du recueil : le crépuscule qui s’amène avec son lot de peurs, les saisons sur les vignes, les coins de la chambre et surtout l’image directrice : ce vent incessant qui se glisse sous les portes et fait trembler les flammes.
Le recueil est traversé par l’automne, saison mentale et éternelle du poète, sans arrêt balayée par des vents lourds et froids : si « l’imagination est un lieu où il pleut » (Italo Calvino, Leçons américaines, 1988), l’enfance pour Bocholier est un lieu où il vente. À ce climat pesant, s’ajoute, plus pesante encore, l’absence « intime et dure » qui justifie à elle seule cet appel incessant. L’ensemble du recueil se présente comme une quête, lancée à corps perdu, vers l’indice d’une présence : un parent ou une fée, un mort ou un dieu – quiconque qui puisse promettre d’être là si le vent venait à souffler.
Peu à peu se dessine l’ambition de l’ouvrage : tomber comme la feuille et écrire comme on meurt pour pousser un beau jour au printemps tout neuf.
À en croire notre enfant-poète, des fantômes du vent jusqu’aux pas de la mort, il plane sur ces lignes des ombres silencieuses qui dorment sous la porte et attendent l’Absence des adultes et des rêves pour abattre leurs salves de tristesse pluvieuse. Ce sont elles qui s’abattent quand meurt le père et que meurt avec lui la maison de l’enfant, figée à jamais dans un courant d’automne. Il ne reste plus alors que l’impérieux besoin d’être toujours protégé : « Je frissonne en entrant / Dans la pièce où blafarde / La pendule arrêtée / Implore des ténèbres / Un abri par pitié ».
C’est peut-être ce drame qui explique ce besoin d’exorcisme. Bachelard, là encore, peut nous être utile quand il note, dans La Terre et les rêveries du repos, qu’avec la maison onirique, « au lieu de rêver à ce qui a été, nous rêvons à ce qui aurait dû être, à ce qui aurait à jamais stabilisé nos rêveries intimes ». Ce qui aurait dû être ici ? Peut-être une sortie d’enfance un peu moins mortifère.
Elle qui marque la fin de la première partie précède l’espérance de la première jeunesse : renaissance d’un phénix dont l’enfance s’est finie dans les cendres de la mort. Pourtant, malgré les tentatives d’espoir, l’angoisse et le vent restent encore bien présents. Alors, à l’image de la feuille d’automne, l’adolescent-poète s’essaie à mourir « pour sentir d’autres souffles / tenter d’autres lumières », pour peut-être que le vent change enfin de couleur. Peu à peu se dessine l’ambition de l’ouvrage : tomber comme la feuille et écrire comme on meurt pour pousser un beau jour au printemps tout neuf.
La rosée des roses
Pour le poète, il ne s’agit pas simplement d’accumuler les teintes de couleurs du passé mais de trouver l’essence de l’enfance rappelée pour, peut-être enfin, s’en délester. Si Michaux lui aussi, a appelé depuis l’enfance et plus précisément depuis « la tombe » de celle-ci, « pour crever [s]on plafond » (Passages, 1950), Bocholier fait cela « pour sonder le fond du puits » et peut-être ainsi en sortir pour de bon.
Pour le poète, il ne s’agit pas simplement d’accumuler les teintes de couleurs du passé mais de trouver l’essence de l’enfance rappelée pour, peut-être enfin, s’en délester.
À force d’énoncer cette peur-somnambule de rester pour toujours dans les dédales d’automne de cette maison natale, progressivement le ciel se dégage. Si la peur reste omniprésente, le vent malgré tout laisse place à l’espoir et à la brise d’été : ce n’est plus les feuilles qui tombent mais la rosée des roses. Les morts toujours nous regardent et la peur s’éveille certains soirs mais la certitude d’avoir saisi une seconde ce qui précisément ne peut pas s’attraper rassure alors le poète :
Ce n’était qu’un petit livre
Que la beauté traversait
Les chagrins le déchiraient
Et la fin fut illisible
Tes mains se sont refermées
Sur ce qu’il n’a pu saisir
La lumière en pluie les souffles
D’amour dans d’obscurs vergers
Finalement, l’acceptation se fait : l’absence et le vent peu à peu sont domptés ; on arrive à marcher même s’ils soufflent sur nos têtes. Ici, ce n’est pas le temps qui est retrouvé mais, plus modestement, c’est l’enfance qui l’est.
Pour autant, si le recueil se clôt sur l’image d’une écriture cathartique qui a progressivement lavé les plaies du passé, une question reste en suspens : « Viendras-tu à mon chevet ? ». Et si l’écriture a refermé les sillons creusés par l’enfance, ce n’est que dans sa foi que le poète parvient à lancer à la nuit sa plus fière espérance en menaçant enfin le vent à son tour :
Soudain le vent tout se brouille
Mais ton visage me reste
Dans une contrée si pure
Que le jour devient aveugle
Non la mort n’est pas absence
L’absence n’est pas la nuit
Hors du temps bruit le silence
Je bois ton aube infinie
Alors, peut-être que si j’appelle depuis l’enfance, c’est parce qu’inexorablement elle s’éloigne et que, comme les heures, moi aussi, je fais mon temps ; parce qu’il n’était personne à mes côtés dans les courants de vent, de chèvrefeuille et de cercueil – celui du père surtout qui prit dans son sillage l’innocence et les chiendents. J’appelle, du bas de mon enfance, sous les portes de ma peur, j’appelle inexorablement parce qu’il y a du vent dans les coins et du vent dans ma tête. J’appelle de ma voix d’enfant seul et discret qui rêve en silence d’une flamme rassurante. J’appelle, j’appelle, mais, las d’appeler, voilà que j’écris.
- Gérard Bocholier, J’appelle depuis l’enfance, 2020

































