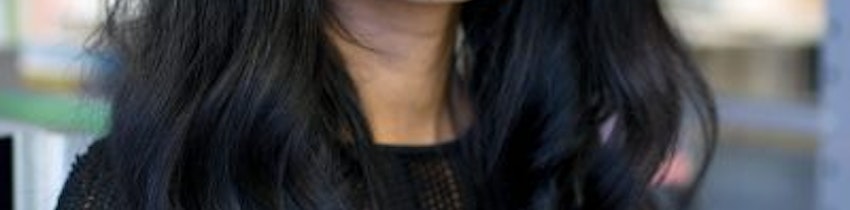A Rabat, le Musée Mohamed VI d’Art Moderne et Contemporain a accueilli durant cinq mois (20 novembre 2020 – 20 avril 2021) une rétrospective consacrée à l’artiste peintre marocain Fouad Bellamine. En parallèle, Latifa Serghini, autrice de trois ouvrages biographiques consacrés à trois figures majeurs de l’art contemporain au Maroc (Jilali Gharbaoui, Ahmed Yacoubi, Mohamed Hamri) explore dans un livre d’entretiens avec Bellamine les grandes lignes de son parcours et de sa création. Né en 1950 à Fès, Bellamine fait ses études à l’Ecole des Arts appliqués de Casablanca et réalise sa première exposition en 1972. Après une expérience d’enseignant et un séjour décisif à la Cité des Arts à Paris dans les années 1980, il construit une œuvre non figurative nourrie de diverses influences, entre minimalisme et expressionnisme abstrait. Plus qu’une reconstruction biographique ou artistique, la toile que tissent ces entretiens, réalisés sur une période de deux ans et publiés chez les jeunes et prometteuses Editions Studiolo, donne à lire la parole plurielle d’un peintre qui repense sa démarche créatrice à travers une dynamique de signes et de rapports dialectiques.
Investir l’entre-deux
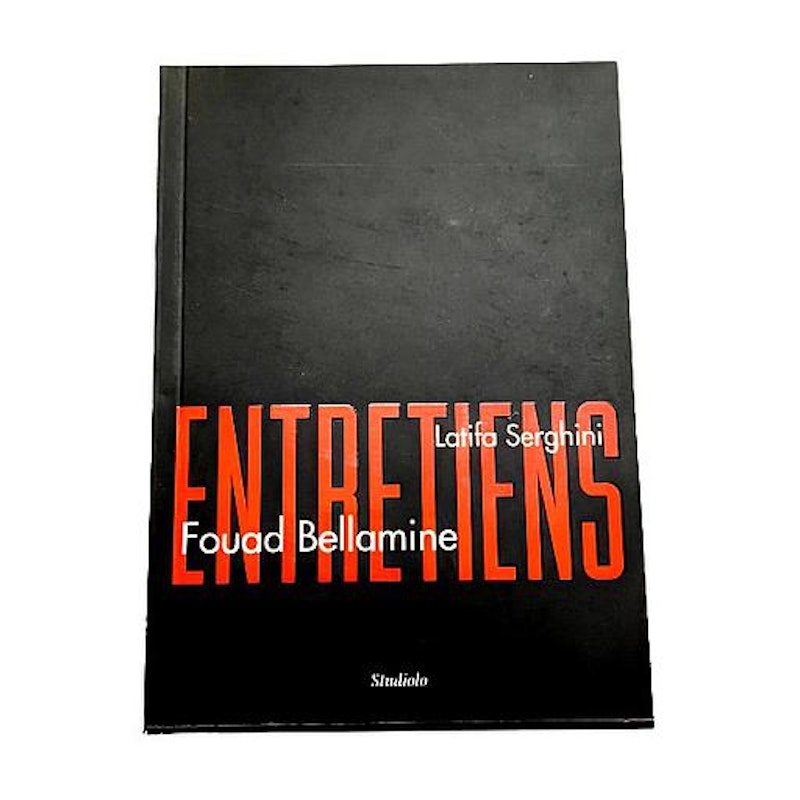
Pour Serghini, l’œuvre de Bellamine « n’est pas à proprement parler biographique, mais elle s’inscrit dans des moments forts de sa vie ». Il y a d’abord Fès, ville natale et matrice des commencements : les dédales de la médina, le salon de coiffure du père, le métier de tisserand du grand-père, la nécessité impérative d’exister malgré la rigidité du dogme et des hiérarchies. Pour Bellamine, la peinture est à la fois écho et rupture avec l’espace biographique. Face à la mémoire de l’enfance, il s’agit autant de reproduire des « perceptions premières » que de renouveler la « quête d’espace et de lumière ». Peindre c’est « affirmer [le] moi » par-delà diverses formes de violence et de frustration : « la peinture m’a permis d’estomper, d’exorciser les moments rudes et noirs de ma petite enfance ».
Le rapport de Bellamine à la mémoire est un itinéraire qui rappelle les dédales de la ville, un jeu de bifurcations entre rancœur et tendresse, entre adhésion et séparation. L’éclosion de l’œuvre de l’artiste a pour arrière-plan une déchirure originelle : la proximité et la distance sont les deux extrémités de son expérience créatrice. A titre d’exemple, les cimetières de la ville natale, aires de jeu traversées par l’enfant et le souvenir, font plus tard l’objet d’une série de toiles prises dans « un entre-deux qui n’est ni photographie pure ni peinture pure ». C’est précisément cet « entre-deux » qui se trouve réinvesti par la dynamique des entretiens : un fascinant va-et-vient entre l’artiste et la toile, entre la genèse et la lecture de l’œuvre, comme si chaque question-réponse mimait le geste du peintre dans l’intervalle des temporalités et des matières.
Eclats de signes
Pour échapper à la clôture des questions et des réponses, Latifa Serghini a eu l’heureuse idée de disséminer tout au long de l’ouvrage une série de citations empruntées à des critiques, des artistes et des écrivains, autant de fenêtres entrouvertes sur l’univers créatif de Bellamine. Comme un écho à cette structure fragmentaire, sans cesse aérée et relancée, le critique d’art Alain Macaire voit dans l’œuvre de l’artiste marocain des « milliers d’éclats de conscience arrachés à l’inconnu de soi-même ». Des éclats de la toile à ceux de la parole, il y a cet appel subliminal à varier les points d’entrée dans l’œuvre de Bellamine, à regarder ses toiles à partir du regard de l’autre.
Des éclats de la toile à ceux de la parole, il y a cet appel subliminal à varier les points d’entrée dans l’œuvre de Bellamine
Entre les analyses informées du critique d’art Gilles de Bure et de la philosophe Christine Buci-Glucksmann, surgissent des citations de Klee, Bataille, Bacon, Braque, Cocteau et d’autres. Un autre niveau de citations est constitué par des commentaires de Bellamine et de son interlocutrice : un dédoublement de l’entretien dans le creux du texte, comme un lointain écho aux épaisseurs de la toile et à ses niveaux de lecture.
On comprend dès lors la récurrence des motifs qui traversent la peinture de Bellamine et organisent les grandes phases de sa production. Qu’il s’agisse d’une arche, d’une niche ou d’un dôme, la forme importe en tant que miroir de l’acte de création. Dans sa célèbre série des « Marabouts », initiée en 1991, il s’agit de nouer la peinture autour d’« une marque picturale » et non d’« une aspérité identitaire ». En évacuant la contrainte figurative et l’assignation identitaire, la toile laisse place à ce que Serghini nomme à juste titre la « survivance des motifs », à savoir la circulation continue des signes et de leurs éclats, exactement comme dans le jeu des questions et des réponses.
D’un entretien à l’autre, le lecteur saisit le processus de création chez Bellamine. Avant la toile : « une sorte d’embouteillage visuel dont il faut fuir les clichés » et attendre patiemment l’aboutissement. Au moment de la création : la spontanéité du geste plutôt que la tentation du croquis. Lors de la réalisation : la peinture comme jouissance mystique. Et Bellamine de préciser : « quand je sens que je tiens la toile, je suis dans un état de transe et de jouissance comparable à la jedba des zaouias soufies ». Dès lors, l’artiste s’engage dans une quête de la « sérialité », autre principe fondateur de son œuvre : multiplier la jouissance pour maintenir la dynamique de la création. D’un bout à l’autre de ce processus, Bellamine enchaîne les expériences artistiques : le minimalisme des années 1970 nourri par une fascination pour les peintres de l’École abstraite de Paris ; la muralité explorée dans les années 1980 autour du mur comme « espace réceptacle » et à la faveur d’un « va-et-vient avec des matériaux divers » ; puis le basculement dans « une peinture gestuelle, matiériste » où la toile, le tissu et la matière deviennent des composantes à part entière de l’œuvre.
Dialectiques et dialogues

Entre la parole et la peinture, il y a un autre dialogue sous-jacent, à la frontière du visible et de l’invisible, du dicible et de l’indicible. Bellamine fait partie de ces artistes qui rejettent les dichotomies et bousculent les catégories. Son œuvre est le fruit d’une dialectique du voilement et du dévoilement qui n’en finit pas de redéfinir le cadre et l’horizon de la création. Souscrivant à la notion de « figural », définie par Lyotard et Deleuze comme un au-delà du visible, un débordement de toute forme de mise en récit ou de clôture du discours, Bellamine explique sa démarche en ces termes : « je cherche à voiler le visible tout en étant hanté par l’idée de révéler l’invisible ». Double dynamique qui exige l’effort du regardeur, invité à saisir les variations des tonalités et des couleurs qui remontent à la surface de la toile. Face à une peinture réputée « singulière et exigeante », Serghini note qu’« il faut du temps pour en détecter la couleur ensevelie puis révélée ».
L’autre rapport dialectique qui traverse l’œuvre et les entretiens est celui qui relie le silence à la parole. Où s’achève la toile sinon dans le double geste de l’effacement et de la régénération ? Dans l’atelier de Bellamine, à la fois « antre » et « refuge », Serghini assiste à la disparition d’une toile non réussie sous des couches de peinture qui annoncent la suivante. Selon un schéma similaire, les entretiens exhument les dessins et les découpages de l’enfance, les couvertures de livres et les affiches, toutes ces créations datant d’avant la peinture. Derrière le rituel de l’entretien, le lecteur est invité à méditer ces toiles fondées sur le principe du dialogue à distance : avec Courbet lorsqu’il s’agit d’interroger la sacralité et le poids des interdits ou avec Goya quand il faut témoigner d’un « vécu émotionnel » face aux tragédies juxtaposées des attentats de Casablanca du 16 mai 2003 et des bombardements en Irak. Ainsi, les toiles 16 de Mayo et Bagdad Mountains figurent une manière de dire la ruine et le chaos, de transposer le silence de la tragédie dans le souffle de la matière.
Transformation et mise en abyme
Loin des diktats de l’engagement, la peinture de Bellamine célèbre l’énergie de la quête et des mutations. Sa série « Tables des dieux», par exemple, est le résultat de l’irruption d’un parallélépipède dans « quelques toiles avec des formes elliptiques de sol qui devenaient une sorte de scène, d’arène ». Portée à ses limites, la promesse de la transformation repousse l’horizon de la création. Entre les monochromes gris et les éclats de lumière, l’artiste a pour objectif de « tendre vers l’absence de couleur ». Plus qu’un horizon, cette absence est une expérience, une sorte de ravissement qui rappelle celui vécu par l’artiste dans son atelier ou par le lecteur face à la densité des entretiens. En suivant les réponses du peintre, on en arrive à vouloir partager ses expériences visuelles et tactiles, à revivre ce « duel corps à toile » d’où émerge l’œuvre à venir.
« Même quand je ne travaille pas réellement, je peins virtuellement », dit Bellamine. Dans les intervalles qui ponctuent les huit chapitres des entretiens, le lecteur est livré à l’obscurité de la page et à la danse verticale des titres.
Dans les intervalles qui ponctuent les huit chapitres des entretiens, le lecteur est livré à l’obscurité de la page et à la danse verticale des titres.
Serait-on face à l’ombre projetée d’une toile ? Dans quelle mesure la parole du peintre est-elle un prolongement de son œuvre ? Un détail permet d’éclairer ces questions : dans l’atelier de Bellamine, Serghini repère « une très grande toile qui semble représenter un atelier » : étrange mise en abyme qui fait écho à l’expérience du lecteur, pris dans la toile de l’entretien, glissant entre les souvenirs, les motifs et les rencontres qui rythment cinquante ans de peinture. Lecteur de Bataille et Duras, Bellamine tisse le paysage de son œuvre autour de la perte et du ravissement. Dans ses toiles comme dans ses réponses, il y a quelque chose de l’ordre de l’extase et de la suspension.
Aventures visuelles
La parole d’un peintre, comme celle de tout créateur, est une constellation de références, une traversée de l’histoire et une restitution des réseaux d’influence et d’affinité. Pour Bellamine, ce sont, entre autres, la lettre et le graffiti de l’irakien Shakir Hassan Al Saïd, les natures mortes de l’italien Giorgio Morandi, « chefs d’œuvre de silence dont il a le secret », mais surtout l’expressionnisme abstrait des artistes américains, dont Arshile Gorky et Robert Motherwell. Au détour d’une réponse, surgit un rêve de dialogue avec Picasso et son œuvre « tonitruante », s’imposant au regard « avec force, bruit et fracas ». D’un artiste à l’autre, Bellamine tisse une toile de résonances artistiques et redéfinit l’histoire de l’art en « aventures visuelles successives et renouvelées ». À chaque aventure, ce leitmotiv : le sujet de l’œuvre importe peu, seuls comptent la trame et le décor. C’est que la peinture, pour Bellamine, est une affaire de regards, une « expérience de l’œil », voire un « voyeurisme obstiné ». Pour le lecteur, l’entretien est aussi un regard intrusif sur l’univers de l’artiste, une immersion visuelle et conceptuelle dans l’intimité de sa création.
S’il reconnaît volontiers que son regard a été forgé dans « le canon grec de la beauté à l’occidentale », Bellamine n’en demeure pas moins soucieux des mutations de la scène artistique marocaine. Citant ses confrères Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui, Ahmed Yacoubi et Farid Belkahia, il estime qu’« il y a des peintres marocains mais non une peinture marocaine », un principe d’individualité plastique qui résonne aussi bien dans son œuvre que dans ses réponses aux questions de Serghini. Rappelant les dégâts causés par les lectures folkloristes ou naïves de la peinture au Maroc, Bellamine dénonce les ravages du mimétisme et les « cotes artificielles » du marché de l’art mais aussi le manque de professionnalisme du secteur et l’insuffisance de l’éducation plastique chez les jeunes générations.
Pluralité et nostalgie
On l’aura compris : la parole de Bellamine, comme sa peinture, est ancrée dans un dialogue à plusieurs niveaux, entre l’ici et l’ailleurs, entre la mémoire de l’intime et les échos de l’altérité : « je reste un produit du Maroc avec une part d’Occident que je revendique », admet-il. L’œuvre de Bellamine est indissociable de cette identité plurielle dont elle est à la fois le prolongement et la réinvention. Tout se passe comme si la peinture était adossée au besoin de dire la multiplicité du « je » et les traces sans cesse réécrites de son existence.
Cette particularité permet peut-être d’éclairer la nostalgie qui traverse les entretiens. Quand il se remémore son immersion dans la scène artistique parisienne des années 1970, Bellamine s’empresse de noter qu’« aujourd’hui, Paris a perdu beaucoup de son panache, alors que c’était la ville des arts ». La même nostalgie imprègne ses évocations du Maroc de l’époque : « Il y avait une vie politique, nos intellectuels de valeur s’exprimaient. Il y avait également de la pensée et de l’audace chez les créateurs de toutes disciplines. La sortie d’un livre était un événement, tout le monde s’y précipitait, ce qui n’est plus le cas ». On imagine cette nostalgie drapant les toiles de l’artiste ou ajoutant à leur jeu d’ombres et de lumières. Mais dans quelle mesure la parole d’un artiste est-elle celle d’un exilé ?
Faire trace
S’il rejette toute forme de restriction de son champ de création, Bellamine parle volontiers de son œuvre comme le parcours d’un exil intérieur. Ce qui prime, chez lui, c’est la perception, les sillons conjugués du vécu et de la mémoire.
Bellamine parle volontiers de son œuvre comme le parcours d’un exil intérieur.
Il précise qu’il faut questionner dans son œuvre le « faire trace », soit la capacité de la toile à générer sans cesse des empreintes, des faisceaux, des écarts. Ce n’est probablement pas un hasard si Bellamine choisit comme trame de fond pour l’une de ses œuvres la version imprimée d’un fait divers. Prélever la matière dans le quotidien permet d’ouvrir des brèches dans le tissu de l’éphémère, de s’approprier la trace pour en faire le point d’articulation et de composition de la création.
Face à un artiste adepte du « voyage immobile », Serghini façonne et réorganise ses questions de manière à suivre les oscillations de l’œuvre mais reconnaît que « l’essence de la démarche créative » de Bellamine conserve une part insaisissable. Y aurait-il autant de manières de recevoir la parole d’un peintre que de lire son œuvre ? L’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb, ami de Bellamine et fin connaisseur de ses travaux, écrit que « la pluralité du déchiffrement déstabilise le sens sans faire trembler la fermeté de la composition ». Dans la toile dense et mouvante de l’entretien, la parole du peintre est cette autre composition, à la fois ferme et plurielle, sur laquelle glisse le regard du lecteur en quête de signes et d’indices. Il y a là peut-être un écho à l’œuvre de Bellamine dans ce qu’elle a de plus sensible et de plus exigeant.
- Latifa Serghini, Fouad Bellamine : Entretiens, Editions Studiolo, 2020, 154 p.