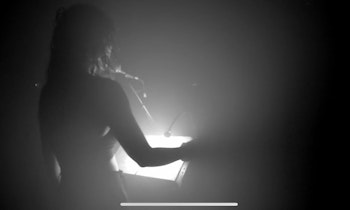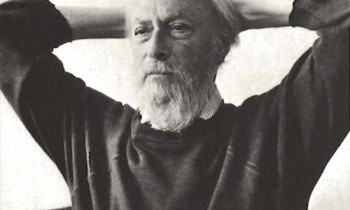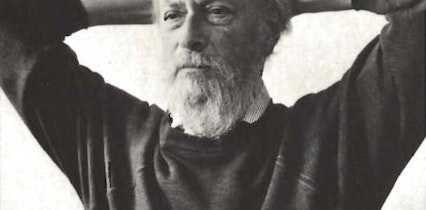La Poursuite de l’idéal est le beau titre donné au dernier ouvrage de Patrice Jean, roman d’apprentissage de notre siècle. En sept parties sont racontées sept années de jeunesse, qui sont surtout des années de recherches, d’épreuves et de désenchantements, où percent çà et là quelques moments heureux. Le récit suit son cours, de manière assez classique : exposition linéaire d’une « petite existence » humaine ; ennui du héros, et parfois du lecteur, dans les premiers chapitres, sauvé toutefois par une ironie discrète ; langue sobre, descriptions précises et fines, travail d’échos subtils et notations de détail, loin de toute emphase. S’il y a bien pourtant des irrégularités, des aspérités et beaucoup de fantaisie, celles-ci n’apparaissent pas d’emblée, et leur dévoilement progressif est l’un des plaisirs et l’une des grandes surprises qui attendent le lecteur de la Poursuite.
Un poète de notre temps
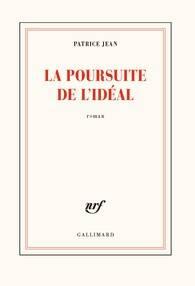
Plus précisément, le premier idéal porté par notre héros est celui de l’écriture : il veut être poète. Qu’il s’agisse d’une résolution profonde ou d’une simple velléité – le doute est quelquefois permis –, Cyrille en cela se distingue de son époque, quitte son habit de figurant pour endosser le rôle de l’original ou du fou, de celui qui n’a pas compris comment marche le monde. Chacun sait en effet qu’il faut être un « doux rêveur », comme on l’appelle, pour croire encore pouvoir vivre de sa plume, que, sauf exception, l’écriture n’est pas un métier ; que, dans la masse des lecteurs, ceux qui aiment les livres et, a fortiori la poésie, se font rares ; enfin qu’il convient, entre vingt et trente ans, de se trouver un vrai travail, d’obtenir une situation, un salaire, une surface sociale. L’inadéquation de la poésie à la vie moderne, qui compte parmi les motifs récurrents de l’ouvrage, constitue sans doute la leçon la plus importante des jeunes années de Cyrille. À vouloir le résumer en un trait, tout le roman se résoudrait à ce mouvement d’oscillation, à cette alternative entre, d’un côté, le vœu d’être poète, et de l’autre les contraintes du réel, du matériel et du social. Dans la nuance, les choses sont autrement plus compliquées, l’idéal pouvant prendre d’autres visages que celui de la poésie. Il semble par moments correspondre à l’exil, de préférence en Bretagne ou en Italie, quand l’essentiel de la Poursuite se déroule à Paris. D’autres fois, à telle ou telle femme aimée par le héros, comme Constance, Olga et Lucie, dans les premiers chapitres. Ou même aux perspectives d’ascension sociale qui se présentent à lui, à la tentation de trahir sa classe d’origine pour devenir un grand bourgeois – mirage d’abord, mais le rêve finira par s’accomplir.
L’inadéquation de la poésie à la vie moderne, qui compte parmi les motifs récurrents de l’ouvrage, constitue sans doute la leçon la plus importante des jeunes années du héros
Dans ces quêtes embrouillées et d’interprétation difficile, nous suivons la trajectoire de Cyrille : toujours hasardeuse, incertaine et heurtée, rattrapée par l’absurde. Ainsi, le chemin improbable qui le conduit, après la fac de lettres, à travailler pour un magasin de meubles puis comme prof de français remplaçant ; à devenir employé de supermarché, puis du ministère de la Culture ; enfin – et contre toute attente –, à connaître la gloire en écrivant le scénario d’une série d’anticipation, French Apocalypse, vouée à un succès fulgurant. Mais même cette « réussite totale » (p. 458), et jusqu’à la grande fête célébrant son triomphe en même temps que ses trente ans, laissent au jeune homme un goût amer et le désir de fuir. Quant au lecteur, l’apothéose de Cyrille lui rappellera peut-être les premières pages du livre, elles aussi consacrées à une fête : on y découvre le héros vingt ans avant le début de l’histoire, un Cyrille de trois ans donc, qui s’émerveille et danse en tourbillonnant, au milieu des adultes, dans la liesse générale d’un mariage ; soudain l’enfant se cogne et s’effondre, pleurant de douleur, est consolé par ceux qui se trouvent là ; il reste cependant en proie à « une tristesse infinie », tandis qu’autour de lui la fête continue, « insouciante et implacable » (p. 14). Sa vie durant, notre héros sera brinquebalé entre plaisir et peine, succès et échecs, traversera de nombreuses fêtes – autant de vanités – et constatera à chaque heurt sa solitude, au milieu d’une foule plus ou moins indifférente et joyeuse.
French Apocalypse
Cette scène de foule et de fête, à l’incipit du livre, fait entrevoir un autre trait programmatique du roman : donner une vue précise du petit monde qui tourne autour de Cyrille et, plus largement, de la société française au XXIe siècle ; autrement dit, donner une dimension sociologique à la Poursuite de l’idéal – entreprise qui, certes, n’est guère originale, mais où Patrice Jean excelle.
Le tableau général est plutôt sombre, le regard légèrement réactionnaire, mais charmant. Réactionnaire, au sens large d’antimoderne et d’un peu nostalgique, de méfiant devant l’idée de progrès ou de libération, de réticent face à toute nouveauté, soupçonnée de n’être qu’un effet de mode. À cet égard, le nom quelque peu pessimiste de French Apocalypse peut s’entendre comme un autre titre possible, sur le mode parodique, et cela d’autant plus que la série en question présente plusieurs points communs avec la Poursuite (ne serait-ce que son sujet, « l’histoire de jeunes gens confrontés aux dégâts de la modernité », p. 306). Charmant tout de même, non seulement parce que le discours sur la décadence ne manque jamais de charme, mais parce que l’ouvrage qui nous occupe, n’étant pas un roman à thèse, laisse le plus souvent à ses personnages le soin de discuter de propos polémiques que l’un d’entre eux aura tenus ; et parce que, d’autre part, l’actualité politique, plus ou moins fictive, plus ou moins vraisemblable, est traitée d’une manière drôle et vivante, avec jusque dans la satire une certaine finesse.
Prenons un exemple : pendant un bon tiers du roman, Cyrille travaille au ministère de la Culture comme assistant de Jean Trézenik – vieil universitaire, dont on reparlera bientôt –, avec pour mission de le seconder dans l’élaboration d’un musée de la Littérature française, lequel doit ouvrir ses portes quelque temps plus tard à Paris. Le projet voit le jour : dans les salles de l’hôtel de Soubise sont exposés des toiles de maîtres, des manuscrits jamais montrés, des objets ayant appartenu à tel ou tel auteur, de petites scènes emblématiques de leur œuvre, autres images chromos. Mais le musée n’est pas plus tôt ouvert qu’il échappe, déjà, à ses créateurs, en même temps qu’il devient un objet politique – ou, plus exactement, l’enjeu d’un enchaînement absurde de récupérations par un camp puis par l’autre. C’est d’abord le ministre qui se félicite, heureux de l’affluence du public et de cette propagande efficace qui lui est offerte ; puis, une manifestation d’identitaires et de nationalistes, outrés de la place accordée à des « écrivaillons de gauche » (p. 344), à un poète africain, Senghor, à un homosexuel comme Proust, au détriment de Céline ou de Péguy ; suit une contre-manifestation de soutien au musée, et les choses semblent peu à peu s’apaiser ; mais c’est sans compter sur un nouvel appel à manifester, lancé deux mois plus tard par des intellectuels de gauche, qui s’indignent à leur tour de l’approche nationaliste qu’implique pour eux le simple fait de parler d’une littérature française ; nouvelle manifestation, qui conduit cette fois au saccage du musée, dont par prudence on décide la fermeture ; il sera remplacé, enfin, par un autre, qui sera baptisé le MuLG, pour musée de la Littérature globale. Si d’autres luttes collectives, moins brutales et surtout moins bêtes, sont également dépeintes, quoique de manière moins suivie – par exemple, la grève désespérée menée par les employés d’un Carrefour Market, dans la troisième partie du roman –, il en résulte toujours un sentiment d’impuissance et de désolation, formant une sorte de fond très sombre aux tribulations du héros.
Encore plus réussis que l’arrière-plan, les personnages qui vont et viennent, porteurs d’un rôle social et, bien souvent, des opinions qui l’accompagnent. Certains sont, là encore, de pures caricatures. Tel est le cas, entre autres, de Pierre Beauséjour : personnage de philosophe médiatique, fat et ridicule, dont la bêtise n’a d’égale que l’intolérance, et qui reparaît de loin en loin pour se scandaliser publiquement, pavoiser et disparaître à nouveau. Comme il s’agit, peut-être, du caractère le plus comique du roman, on peut citer les circonstances de sa première apparition. Cyrille, à peine sorti de la fac, cumule alors un emploi fastidieux chez Salons&Cuisines avec un engagement, comme chroniqueur, pour une revue en ligne de jeunes intellectuels chrétiens. C’est dans le cadre de cette revue qu’il rencontre Beauséjour, à la faveur d’une interview, découvrant par la même occasion que le théoricien de la gauche radicale vit dans un magnifique appartement du Triangle d’or. Le dialogue qui s’ensuit est assez savoureux, attaché qu’il est à mettre en scène, dans une montée progressive de la caricature, un jargon de plus en plus envahissant (« devenir-monde », « dominant-soi », « privégatif »), une citation grandiose du philosophe (« la parole est un souffle qui doit s’introduire partout, elle doit vibrer, frémir, palpiter ; exclure un citoyen de la parole-souffle, c’est étrangler la démocratie »), presque immédiatement suivie de cette conclusion tranchante : « discuter avec un contradicteur de mes idées, ce n’est pas discuter, c’est donner voix au chapitre à l’antiparole » (p. 138).
Les scènes de dialogue sont prétextes à la confrontation de vues divergentes, sur les plans politique, social et moral, souvent magistralement argumentées de part et d’autre.
À côté de Beauséjour et de quelques autres de la même trempe, il est des personnages, parmi les amis de Cyrille, à la psychologie plus subtile et dont les discours laissent davantage de place au dialogue : Raphaël et Lucie, par exemple, tous deux rédacteurs à l’Épée des Croisades – on aura reconnu la revue en ligne évoquée plus haut –, incarnant une foi catholique et des idées que le héros ne partage pas, mais où réside, en quelque sorte, une poursuite de l’idéal toute parallèle à la sienne ; le premier est un jeune bourgeois en rupture de ban, beau, intelligent et plein d’audace, résolu à lutter contre le « camp de vacances universel » (p. 138) que deviendrait un monde, dit-il, privé de transcendance ; la seconde, figure pâle et timide, décrite comme naïve, éthérée ou « poétique, dans le mauvais sens du terme » (p. 120), est aussi le premier grand amour de Cyrille. Plus tard aura lieu la rencontre avec Jean Trézenik, fonctionnaire repenti de l’université, travaillant désormais, pour le ministère de la Culture, à authentifier des manuscrits attribués à Laforgue ou à Stendhal. Trézenik est un intellectuel plus âgé, spirituel et provocant, qui représente avec grâce le type du vieux réac et du misanthrope ; le genre de silhouette romantique qui, en regardant se lever une tempête, songe lui aussi que « l’apocalypse guette » (p. 133). Pour Cyrille, il joue le rôle d’un mentor et d’un double – il a poursuivi un idéal littéraire tout semblable au sien –, en même temps que d’un contradicteur récurrent. Avec lui en effet, comme avec Raphaël et quelques autres, les scènes de dialogue sont prétextes à la confrontation de vues divergentes, sur les plans politique, social et moral, souvent magistralement argumentées de part et d’autre. Les caractères en ressortent plus riches, leurs thèses se superposent ainsi sans trop de lourdeur, et la dimension sociologique s’accroît d’autant d’analyses ébauchées.
Chasse spirituelle
Revenons, pour finir, à l’idéal annoncé par le titre : idéal poétique de Cyrille, quand certains poursuivent la voie d’une transcendance religieuse et d’autres, tel Trézenik, l’espoir d’un exil hors du monde, au fond des terres sauvages de Bretagne. En dehors d’une narration qui va sans que l’on puisse toujours discerner si notre héros se rapproche de son idéal ou s’en éloigne, le livre de Patrice Jean parle de cette même poésie – rien d’original une fois de plus, mais tout est dans l’exécution. Il la met en œuvre aussi, si l’on entend par poésie la création littéraire au sens large, tant dans la construction du roman – où les effets de répétition et de contraste abondent – que, à plus petite échelle, dans l’attention portée aux mots, ou dans le détail insolite d’une description : c’est ainsi que, dans une langue qui paraît très classique par sa syntaxe et par un lexique quelquefois emprunté au XVIIe siècle (on pourrait compter les « il en concevait de l’humeur »), dans ce style à la fois sobre et démodé se décèlent des archaïsmes surprenants (icelui, icelle et leur déclinaison, la préposition fors), des raretés prisées par l’auteur (exciper, sentes et vie insane), du français oral et quelques grossièretés, le tout savamment accommodé ; quant aux descriptions, il s’agit le plus souvent de paysages, quelquefois de villes, dont la beauté majestueuse vient compenser la médiocrité de l’intrigue ; mais il peut aussi surgir, au milieu d’une action, une notation gratuite de détail ou une métaphore inattendue – la couleur d’un objet, tel le « carnage de papillons blancs » (p. 369), pour des mouchoirs en papier.
Peut-être est-il permis d’imaginer un écho entre le titre choisi par Patrice Jean et la Chasse spirituelle de Rimbaud, le faux le plus célèbre de la poésie moderne. Les deux œuvres ont un statut d’une semblable ambivalence
Un dernier mot, sur l’idée que la Poursuite de l’idéal parle de poésie. Nous voulons dire qu’il s’y trouve bien des choses, comme dans une poupée russe : quantité d’allusions aux écrivains des siècles passés, des mentions de poèmes ou, plus souvent, d’ersatz, emboîtés dans le récit principal, des jeux de vrais et de faux littéraires. Du côté des écrivains, Stendhal et Valery Larbaud, Baudelaire, Nerval et Leopardi, entre mille, hantent le roman comme des fantômes ou comme des saints que l’on implore (p. 383). Les tentatives poétiques de Cyrille se trouvent au détour d’une note de bas de page (p. 212), mais chacune de ses aventures, surtout, peut se lire comme une question sur le statut de la littérature : quel rapport entretient-elle avec le sacré ? peut-on faire d’elle un objet de musée ? les séries télés sont-elles la forme d’art de notre temps et, en dernière analyse, l’équivalent contemporain de ce que furent un jour les romans-feuilletons de Balzac ? Questions diverses et sans réponse définitive, malgré des réflexions partout esquissées, malgré la piste donnée par les pages finales du roman. Ces mêmes questions peuvent être subsumées sous une seule : quel idéal poétique est le bon, et lequel à l’inverse n’est qu’une œuvre de faussaire ? Le travail de philologue que Jean Trézenik accomplit pour le ministère, travail si discret que l’on oublie parfois son existence, s’éclaire alors d’un sens nouveau : authentifier un texte, faire la part des choses entre un vrai roman de Laforgue, ou un apocryphe de Stendhal, atteste d’un effort analogue à celui du héros, en quête d’un destin poétique qui ne soit pas une chimère. Peut-être est-il permis, dans ces conditions, d’imaginer un écho entre le titre choisi par Patrice Jean et la Chasse spirituelle de Rimbaud, le faux le plus célèbre de la poésie moderne. Outre la similitude des deux titres, en effet, les thèmes communs du départ et du divorce avec l’époque, enfin les références rimbaldiennes de la Poursuite, les deux œuvres ont un statut d’une semblable ambivalence : l’une est une supercherie historique, auquel il ne manquerait qu’un nom d’auteur authentique, ou la croyance d’un lecteur naïf, pour s’élever au rang de classique littéraire ; l’autre, à l’inverse, est une fiction où des manuscrits bien authentiques sont exhumés, dans l’indifférence générale.
Mais laissons là cette hypothèse fragile, pour tenter de formuler un jugement d’ensemble moins incertain. La Poursuite de l’idéal est un texte émouvant, bien fait et bien écrit, remarquable surtout pour son intelligence et sa délicatesse. S’il fallait exprimer une réserve, on pourrait trouver trop de lenteur au rythme languissant des premières pages, où les déceptions et les désirs amers sont posés comme des jalons, en sorte que l’on peut craindre, alors, un enlisement ; mais au lieu du marasme redouté, cette grisaille des commencements ne fait que préparer les mouvements plus vifs, les revirements fréquents qui se concentrent, surtout, dans la deuxième moitié du roman, enfin quelques moments de ravissement ou de rire qui justifient sa lecture.
- La poursuite de l’idéal, Patrice Jean, janvier 2021, 23 euros.
Anne Leon