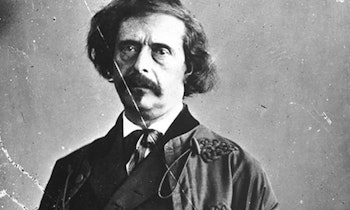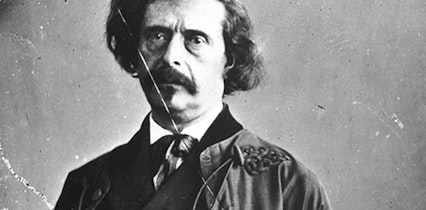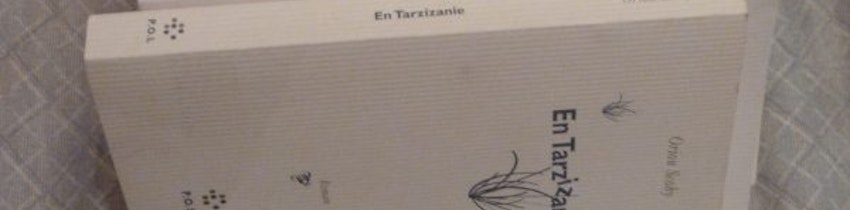Présenté à la dernière Berlinale, Petite Maman, le dernier film de Céline Sciamma, fera sans doute couler moins d’encre que le Portrait de la jeune fille en feu. Derrière son apparente modestie formelle se cache pourtant un grand geste de cinéma autour de l’enfance et des mystérieux ténèbres qui l’entourent.

Sans nul doute que Petite Maman ne passerait pas le test, se verrait attribuer un zéro d’office à l’interro-surprise de cette cinématographie arithmétique. Et à juste titre : les normes industrielles américaines, en vigueur sur l’ensemble de la narration audiovisuelle mondialisée, n’y ont effectivement aucune prise, y sont niées en bloc. C’est que l’œuvre de Céline Sciamma ne se construit pas autour de la performance et de son spectacle, du culte de l’exécution parfaite, chirurgicale, immaculée, et des savants mouvements de caméra à la précision militaire. Son art s’articule plus volontiers autour de regards, multiples, mouvants, aussi incertains qu’intrépides, en constante transformation. Un geste, pur dans sa modestie face au réel, de cinéaste.
De l’autre côté du miroir
Le grand mystère dans la vie de Nelly, son équation à une inconnue, c’est sa maman. Non pas qu’elle doute de son amour, aucune scène que nous montre Sciamma ne vient indiquer le contraire. Seulement voilà, maman est triste, alors ça la rend triste aussi. Et bien qu’elle n’ait que huit ans, elle voit bien que ce n’est pas que depuis que mamie est morte, même si forcément ça n’aide pas. Il y a de la résistance, de l’irréductible, du gouffre béant enfouie dans le cœur de maman. Une histoire doit sûrement se cacher derrière ce masque de tristesse. Mais ça, bien sûr, c’est précisément ce qu’elle ne veut pas raconter à Nelly. Et un jour que la désespérance s’est faite trop forte, elle est partie, la laissant seule avec papa dans cette petite maison de campagne perdue au milieu des bois, où la chambre de mamie restera pour toujours vide. Mais, fort heureusement, c’est dans le dos toujours que la lumière va venir frapper la nuit.
L’enfance, à travers les âges et à travers les continents, n’a eu de cesse de trouver la parade pour conjurer les ténèbres
Le surgissement du merveilleux dans le film est aussi surprenant qu’inévitable. Surprenant car ce n’est pas tous les jours que les fillettes rencontrent au détour d’une balade forestière leurs mamans qui, en plus d’avoir le même âge qu’elles, leur ressemblent comme une sœur jumelle. Inévitable parce que l’enfance, à travers les âges et à travers les continents, n’a eu de cesse de trouver la parade pour conjurer les ténèbres. De Perrault à Miyazaki en passant par Carroll, c’est une leçon que l’on sait sue par cœur et depuis longtemps par chaque petit garçon et chaque petite fille avec un peu d’imagination. Rien de nouveau sous le soleil. Nelly elle-même ne semble pas particulièrement affectée par ces après-midis voyagés dans le temps, passés à construire avec Marion la cabane en bois dont sa mère lui a tant parlé depuis qu’elle est toute petite. En elle, il n’y a aucun doute. De la surprise, un peu, de la peur, parfois, mais du doute, nullement. Elle comprend très vite ce qu’elle voit, et ne le remet pas en cause puisqu’à quoi bon ? Que le monde épouse comme par magie la forme de ses désirs secrets, que la réalité devienne conforme à l’image mentale qu’on s’en dessine et que l’on appelle de ses prières, quoi de plus normal quand on a huit ans. Ça n’est que justice après tout.
La représentation comme monde
Témoigner du plaisir de jouer, de ne plus être soi, d’embrasser le monde à travers le regard d’un autre je
Moins effrayants de technique et de professionnalisme que leurs congénères dégénérés américains, les enfants du cinéma français (d’auteur, mais pas forcément que) font souvent preuve de plus de spontanéité dans leur jeu. Le revers de la médaille, c’est qu’ils sont peut-être aussi contraints par plus de limitations, moins de maîtrise, dans leur spectre d’interprétation. Pour parvenir à les sublimer, Sciamma choisit elle une voie intermédiaire. Joséphine et Gabrielle Sanz, les deux sœurs qui incarnent Nelly et Marion, sont filmées, avant même comme des personnages de l’œuvre de la réalisatrice Céline Sciamma, surtout comme les deux adorables petites filles qu’elles sont et qui se font un monde de cette représentation cousue de fils blancs qu’est le tournage d’un film de cinéma. La cinéaste les met par exemple en scène se mettre en scène dans des courtes saynètes archétypales de théâtre de boulevard, gratuites en ce qu’elles n’ont d’autre fonction dans la narration que de témoigner du plaisir de jouer, de ne plus être soi, d’embrasser le monde à travers le regard d’un autre je. Ces interludes de jeux d’enfants contextualisent l’intrigue fantastique du récit dans un cadre plus large et plus ouvert, inscrivant le film et ses personnages dans une autre réalité, la nôtre, celle du quatrième mur, celle qu’habitent Céline Sciamma et les sœurs Sanz.
Mais revenons à l’histoire, qui le mérite puisqu’elle est si belle. Elle est construite comme un miroir. Entre les deux actrices, évidemment. Entre les personnages ensuite, puisque Nelly se reconnaît en Marion, tout comme elle reconnaît la tristesse de sa mère dans celle de sa grand-mère. Les maisons sont également symétriques entre elles, la petite cabane au milieu du bois figurant l’entrée de la boîte noire à travers laquelle Nelly peut projeter sa réalité dans celle de sa petite maman. Les séquences les plus saisissantes et irréelles du film sont d’ailleurs celles où chacune visite pour la première fois la maison de l’autre, entre stupeur et béatitude. Tout comme le début et la fin du film finissent par se répondre et se reconnaître, non plus comme le reflet froid de nous-mêmes que nous renvoie la surface d’une glace, mais bien plus comme la jeune fleuriste qui finit enfin par voir et reconnaître, le coeur au bord des yeux, le vagabond à la fin des Lumières de la ville. Entre l’instant où Nelly dit des au revoir qui sonnent comme des adieux à des grands-mères qui ne sont pas les siennes, puis finit par rejoindre sa mère dans la chambre de la morte, et celui où Marion revient dans sa maison d’enfance retrouver sa fille et qu’elles se reconnaissent enfin pour ce qu’elles sont, deux petites filles qui ne veulent rien d’autre qu’être aimées, entre ces deux instants-là, il y a toute une vie. Et qu’elle soit rêvée ou non, cela n’a jamais eu la moindre importance.
- Petite Maman, un film de Céline Sciamma, avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, en salles le mercredi 2 juin 2021.