
À travers le quotidien d’une famille d’aujourd’hui donc connectée, Laura Vazquez raconte les réseaux sociaux et Internet, la vie et la mort, les névroses, la beauté et l’absurde, et fait de la vie numérique un monde littéraire. « Le présent est un point, mais quelle est la taille de ce point ? » se demande l’un des personnages de La Semaine Perpétuelle, paru en août dernier aux Éditions du Sous-Sol. La Semaine Perpétuelle est peut-être la réponse que propose Laura Vazquez avec ce premier roman qui nous donne à lire le flux incessant qui occupe désormais nos têtes et nos vies et qui métamorphose la manière même de se penser et de penser le monde autour de soi.
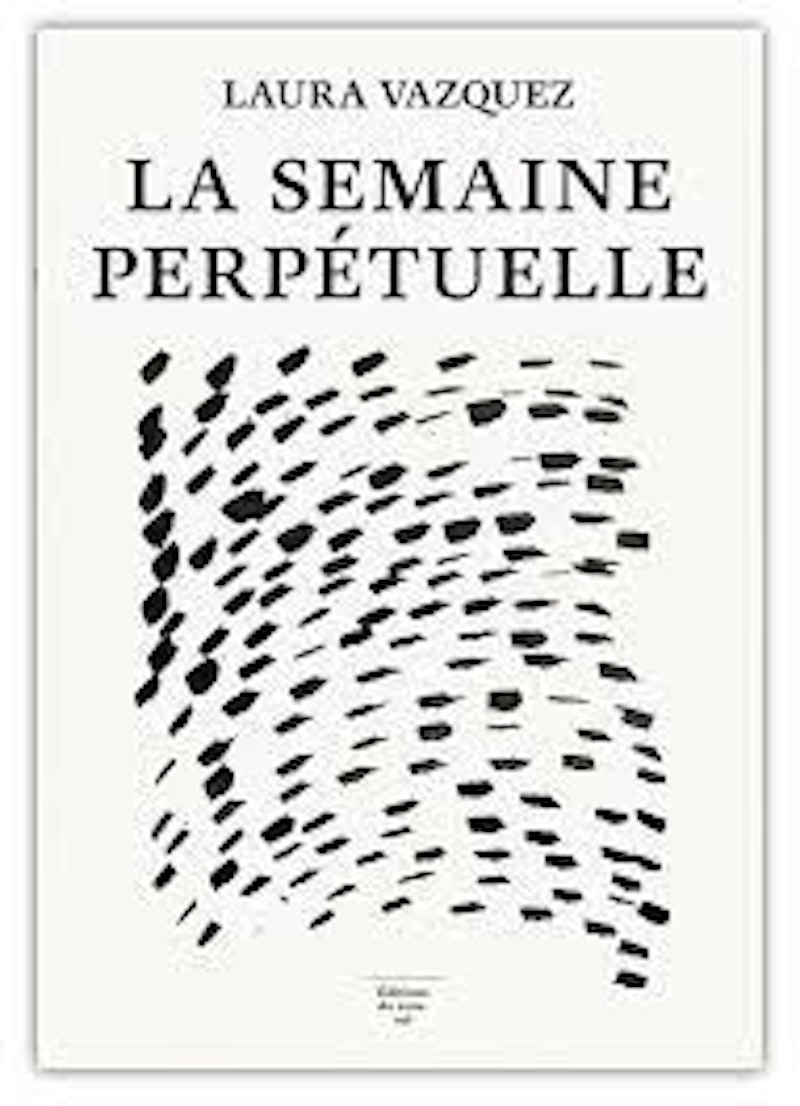
Pensées décousues, paroles heurtées, rêves et listes, répétitions, phrases scandées, observations existentielles, cruauté des choses écrites simplement, naïveté et bêtise aussi des petites certitudes… « Les pensées ne connaissent pas leur direction. Elles ne vont jamais quelque part. Les pensées commencent mais elles ne vont pas quelque part. Elles n’ont pas de destination. Chaque pensée forme une route et toutes les routes forment une carte à l’intérieur de la personne Des routes se croisent et d’autres se superposent, mais elles ne mènent nulle part. Les routes n’ont pas de fin parce que le monde est un cercle et les personnes font des cercles, de petits cercles sur terre. Personne ne peut dire : Voilà, ça y est, j’ai fini la pensée. »La semaine perpétuelle est ce fleuve qui mêle les pensées continuelles aux productions numériques des personnages, chacun avec son propre rythme, sa propre identité, son propre flot. Tous se reconnaissent, par le talent inouï de cette autrice qui nous offre avec ce roman une élégie numérique.
Nous y vivons, mais comment l’écrire, ce continent numérique ? Peut-être par cette voix dans le texte, une voix sans visage et sans nom, un flux continu, logique dans son illogisme, qui passe de tout à rien et de rien à tout, qui élabore, approfondit parfois, et puis abandonne son objet, ou bien perd le fil
Écrire l’obscur reflet du monde
En exergue de son roman, Laura Vazquez choisit une épître du Nouveau Testament : 1 Corinthiens 13. « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure ; mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » L’écran, l’image, la vidéo : autant de moyens de se donner à voir, d’être vu et d’être interprété, moyens que mobilisent activement Salim et Sara, un frère et sa sœur qui postent des contenus sur les réseaux sociaux, philosophiques pour Salim, artistiques pour Sara.
« Salut à toutes et à tous, aujourd’hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la pensée, c’est-à-dire de la mort. » Si les personnages jouent de ce dispositif médié au réel, ils en sont aussi les spectateurs, et cette réalité numérique constitue une part importante de leur quotidien.
L’autrice se nourrit dans son écriture des multiples matériaux d’Internet pour raconter ce monde : vidéos, commentaires, pages, profils, chansons, poèmes, mails… sont autant de traces fantomatiques du réel qui peuplent le roman et le temps du récit. Laura Vazquez révèle ce faisant toute la portée poétique de ces traces, dont elle fait littérature. Internet, espace-temps du roman, est le lieu d’une errance au milieu des signes, un lieu de multiples réponses disponibles, qui vient remplir le vide, opposer quelque chose au silence de la pensée et à la solitude des êtres. Salim, Sara, Jonathan pensent à un mot, le cherchent sur leur téléphone, pensent à une question, la cherchent également, lisent des articles, des commentaires, regardent des vidéos pour combler le vide parfois, pour éclairer le monde souvent.
« Il aurait bien voulu des touches sur son propre corps pour se régler. Une touche pour dormir, une touche pour rire, une touche pour parler, une touche sur le ventre pour ne plus être saoul. Il avalait des pilules, il appuyait sur des images, il se disait : Je prie. Il partageait des images sur la page de Salim, des sortes de papillons, des lézards, il envoyait de tout, des comètes, des maladies au microscope, des célébrités russes. Il photographia sa chambre. Il envoya les images noires de sa chambre dans le noir. Il pouvait tout envoyer, miraculeusement, toutes les images partaient. Il n’y avait pas de limite, elles partaient sans problème. »
Internet est aussi le lieu d’une communication possible. Salim et Sara font des rencontres, interagissent, grâce à leur vie en ligne ou via des images et des références numériques partagées.
Jusqu’à leur père qui, pour aider ses enfants à vivre, à comprendre comment vivre, leur écrit régulièrement des mails, listes de maximes et de perles de sagesse ordinaires.
Laura Vazquez révèle ce faisant toute la portée poétique de ces traces, dont elle fait littérature. Internet, espace-temps du roman, est le lieu d’une errance au milieu des signes, un lieu de multiples réponses disponibles
« J’attache mon ombre dans le jardin »
Mais voilà, cette famille dont les pensées et les gestes naviguent sur le fleuve Internet est une famille d’individus blessés par le monde. Salim ne sort presque plus depuis qu’il a 14 ans, après un incident traumatique. Il est retiré du monde mais désireux de l’interpréter et de le comprendre. Sara ne supporte pas de s’en approcher de trop près et se transforme sur les réseaux sociaux pour se montrer. Quant à leur père, maltraité dans l’enfance, abandonné par sa femme avec deux enfants, il nettoie, nettoie avec des éponges spéciales pour chaque chose, chaque être, comme sa manière de soigner les choses et les êtres, de leur pardonner aussi.
Au fil du récit, les personnages sont amenés, en-dehors d’Internet et des réseaux sociaux, à entrer en contact avec les autres: un colocataire obsédé par le feu, un voisin qui torture ses enfants, une femme alcoolique, un assistant social qui a deux chiens qu’il considère comme ses enfants, … Le monde réel apparaît dur, incompréhensible, plein de personnes blessées, obsessionnelles, insensées, d’histoires délirantes et terribles, de dialogues impossibles.« J’ai eu des cas de mort des lèvres. On peut mourir d’un doigt pour commencer. Mourir d’un membre. Il faut bien commencer quelque part. L’os se carie, le mal l’emporte. Le directeur des pompes funèbres se mit à rire. Il dit : J’adore ce sens de la repartie sans parole. Vous percevez ce sens de la répartie ? La répartie de la mort. J’adore. Par contre, la mort me dégoûte, je suis comme tout le monde. Comme vous. Je suis normal. »
Etrangement cependant, ce monde-là se fait attachant, parce qu’il est sauvage, parce qu’il ne rentre dans aucune case, ne répond souvent à rien. C’est un monde à côté de la plaque, à l’image de toutes ces personnes que l’on croise et qui semblent vivre dans les limbes d’une société qui leur échappe. C’est un monde parfois sublime et souvent terrible, mais c’est un monde vivant, dans lequel les personnages s’appliquent à sentir, respirer, digérer, autant d’expériences impossibles derrière un écran.
« Commencez une phrase et ne choisissez pas la fin »
La Semaine Perpétuelle, une fois terminé, nous laisse avec le sentiment d’avoir traversé deux mondes, même si nous serions bien en peine de dire lequel serait le plus souhaitable des deux. Sans jamais juger ses personnages, leurs choix ou leurs pratiques, Laura Vazquez nous invite à regarder autrement, en accordant une attention profonde aux choses et aux êtres, aux expressions et aux logiques que nous ne remarquons plus tant elles sont devenues ordinaires.
La Semaine Perpétuelle, une fois terminé, nous laisse avec le sentiment d’avoir traversé deux mondes, même si nous serions bien en peine de dire lequel serait le plus souhaitable des deux
Lire La Semaine Perpétuelle, ce serait alors comme relire notre propre semaine, en redécouvrant au détour d’une pensée, d’une vidéo ou d’une situation ce dont on avait oublié de se souvenir ou de s’étonner. Emporté dans le flot des pensées des personnages et des êtres et objets qui habitent ce monde, le lecteur ou la lectrice découvre un long chant littéraire, d’une stupéfiante beauté, avec comme narrateur un Chœur dont la voix change souvent, et qui dessine imparfaitement, donc très justement, les contours d’une réalité qui s’affirme sur le continent littérature.
Bibliographie :
Vazquez, Laura, La Semaine Perpétuelle, Éditions du Sous-Sol, 2022.





























