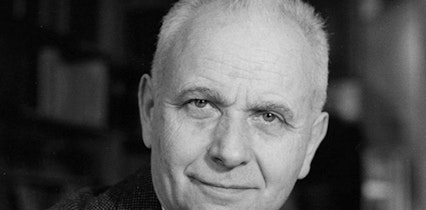À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Zone Critique vous propose son journal de bord, modeste recueil d’impressions, de réflexions, de souvenirs et d’oublis autour de films chéris ou, plus rarement, honnis, qui composent les différentes sélections cannoises.
- De humani corporis fabrica de Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel (Quinzaine des réalisateurs)

Encore une fois, c’est du documentaire qu’est venue l’incarnation, soit ce moment rare où le réel, la chair et la matière s’incorporent dans un dispositif cinématographique, lui conférant la force, la beauté, mais aussi l’antique cruauté du vivant. Venus de l’anthropologie, Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor prolongent avec De humani corporis fabrica le traité d’anatomie éponyme d’André Visale et exposent donc la fabrique, la machinerie, la tuyauterie du corps humain, déployant l’imagerie exploratoire de la médecine moderne – opération à crâne ouvert, endoscopies, chirurgie oculaire ou accouchement par césarienne – selon les lois de la perspective expérimentale, procédant par là même au retour de la corporalité, jusqu’alors relégué dans les ténèbres, dans le domaine du visible. L’horizon soudainement ouvert au regard du spectateur, la science-fiction n’aurait pas pu l’inventer, incapable de réunir sous un même régime plastique l’exactitude de l’enregistrement scientifique et le foisonnement d’abstractions délirantes, l’engendrement du monde biologique et son extension permanente à une dimension cosmique. Quel plan pourrait mieux raconter le vertige des échelles que ce gros plan d’un œil sanguinolent, semblable à une naine rouge au bord de l’effondrement ? Comment mieux rendre compte de la violence de l’arrachement au paradis amniotique qu’en filmant ces mains qui écartèlent le ventre maternel ? Et que dire de ces pinces de métal qui serpentent à travers les tissus, manipulent et ablatent les organes, comme animées de leur volonté propre, sinon que leur puissance d’évocation ouvre une fenêtre terrifiante sur les lendemains post-humains ?
Des abysses comme des entrailles : Léviathan (2012) mettait en rapport la primitive puissance des océans et leur exploitation par une pèche industrieuse, De humani corporis fabrica lie constamment le corps social et l’organisation anatomique qui le fonde. Castaing-Taylor et Paravel filme l’hôpital public comme une instance physiologique nécrosée, dotée de son système nerveux et de son système digestif, où le corps individuel est toujours saisi par la loi du nombre. Le geste est éminemment politique, puisqu’en plus de documenter concrètement l’effet des austérités successives sur le système de santé (un outil défaillant engageant le succès d’une opération et le pronostic vital d’un patient, par exemple), il rappelle que la médecine doit sans cesse repousser le processus de déshumanisation que produisent sa technicité et son aspiration téléologique à dépasser notre finitude naturelle – il est des frontières qui ne seront franchies qu’une fois.
- Retour à Séoul de Davy Chou (Un Certain Regard)

Il est également question de biologie dans le beau film de Davy Chou. Le Retour à Séoul, c’est celui de Freddie, qui foule à nouveau le sol de ses origines, 25 années après avoir été adoptée par un couple français. Arrimée à son héroïne – à laquelle la débutante Park Ji-min donne multitude de pistes, d’inflexions et de nuances – Davy Chou mesure l’écart créé par deux identités, qui viennent mutuellement se contrarier et se télescoper, comme deux plaques tectoniques mues par des forces contraires. Tout l’enjeu du récit – construit sur des ellipses et éclaté sur des périodes disjointes – sera de suivre l’affranchissement et la recomposition intime de Freddie, qui en refusant de suivre les injonctions des orchestrations étrangères à son cœur, trouve la force de composer sa propre partition. C’est peut-être ça, un personnage de cinéma : on ferme les yeux, et sa musique personnelle ne nous quitte pas.
- La Jauría de Andrés Ramírez Pulido (Semaine de la Critique)

On ne sait pas si Andrés Ramírez Pulido admire Sayat Nova, mais son premier long-métrage et son protagoniste portent les traces de la couleur de la grenade. Eliú a du sang sur les mains et son crime lui vaut un internement dans un centre de détention pour mineurs, à mi-chemin entre le camp de redressement et la retraite dépurative, des séances thérapeutiques étant administrées aux jeunes délinquants, entre deux travaux de terrassement (du relief comme des corps récalcitrants). Avec minutie, le film interroge la croyance carcérale, ajoutant le soigner au surveiller et au punir, associant le guérisseur de l’âme au geôlier des corps, et expose son épouvantable promesse : puisqu’il y a une maladie criminelle et une tare civilisationnelle, il faut l’éradiquer, dans un souci de purification sociale. Au fond d’une grotte, le secret originel d’Eliú demeure néanmoins, la mystique proposant son propre espace de résistance. Ainsi le mal s’immisce dans l’anfractuosité humaine.