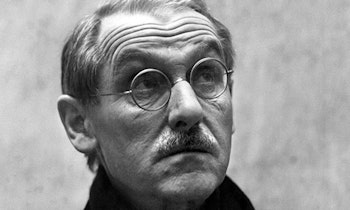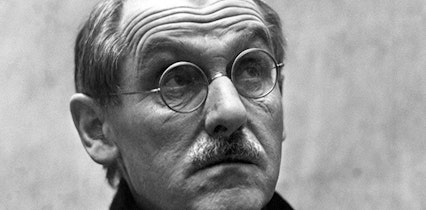– Quand l’œuvre fait crime de genre –

Sobrement intitulé Une adolescente, le dernier ouvrage de Lolita Pille, paru chez Stock (le 6 janvier 2022) est un roman d’apprentissage et d’initiation – jouissive, douloureuse. La littérature a ceci de pratique qu’elle permet de ramener à la vie ceux qui sont morts, en les couchant sur une page. Et quoi de plus mort que cet être que l’on fut un jour, que cet enfant qui se regarde soudain, ayant grandi, ne plus être ? Ainsi, autrice, Lolita Pille épuise-t-elle le souvenir de l’adolescente qu’elle a été ; elle en décrypte les agitations, en retrace la trajectoire, non sans se prêter au jeu de l’auto-fiction, qui n’est pas tant un jeu qu’un moyen de dire, d’écrire et de recomposer le monde disparu.
Voilà bien longtemps que, dans ce genre plus vraiment particulier de la littérature, je n’avais pas été autant secoué. Une grande réussite.
Bûcher littéraire
Lolita Pille a 19 ans lorsqu’elle publie Hell. On ne lui pardonnera ni son âge (trop jeune, trop bimbo), ni son air renfrogné un peu bourgeois, par trop grunge, ni la qualité globale du roman, tout à la fois son acidité et sa lucidité (on y suit Ella, jeune bourgeoise – encore une ! – qui traverse le chaos des nuits parisiennes avec l’envie furieuse de mourir et l’on assiste impuissamment à sa lente déréliction, au milieu des drogues à sniffer, de l’alcool à avaler et des corps à oublier). Comme l’écrit l’autrice : “Hell faisait le procès d’un milieu et d’une époque : de la violence de classe du côté des violents, pas des victimes. J’ai rendu ainsi cette violence éclatante”.
On pardonnera encore moins, car si ce n’est un crime, c’est au moins se rendre suspect auprès de la sainte instance des saints patrons de la littérature et du monde culturel, le succès du roman et sa médiatisation. Très vite, Ella, la créature, échappe à Pille. Soit que l’on soupçonne l’œuvre d’avoir été écrite par un autre, et de préférence par un homme, tout simplement parce qu’ils écrivent mieux, c’est connu. Cela fait partie des lois du monde. Car, séduisante théorie, “leur style provient, selon Norman Mailer, du “résidu de nos couilles””. Soit que l’on ne fasse plus la différence entre celle qui écrit, et celle qui est décrite, créature d’encre, amalgame certes d’un-peu-de-soi, mais aussi de pas-vraiment-soi, et de bien d’autres choses (l’imagination par exemple).
(Je vais faire comme Péguy et ouvrir une petite parenthèse, que je fermerai bien vite. Voilà ici même, dans l’affaire “hellisation de Pille”, un symptôme supplémentaire de ce mal, que je déplore, très actuel, et que l’on pourrait qualifier d’impossibilité de la fiction. Impossibilité rendue saillante à l’heure où se déclare joyeusement la mort du roman. Peut-on au moins lui organiser des funérailles ? Ce n’est tout de même pas rien le “roman”. C’était une grande personne ! Il faut du temps pour se faire à sa disparition. Je ne suis pas certain de m’y être préparé. Est-on bien sûr que son cœur ne bat plus ? Peut-on trouver quelque certificat de décès ? Non, alors peut-être bien qu’il n’est pas mort, pas tellement décédé.
À celles et ceux qui en doutent encore, soit qu’ils ont mal lu, soit qu’ils n’ont rien lu : la fiction, ce n’est pas l’art du mensonge.
À celles et ceux qui en doutent encore, soit qu’ils ont mal lu, soit qu’ils n’ont rien lu : la fiction, ce n’est pas l’art du mensonge. Un bon menteur fait cependant un mauvais écrivain. Une bonne fiction fait une bonne littérature, tout simplement car elle produit ses vérités, des vérités qui sont siennes, qui nécessitent quelque fabrication, quelque mixture, qui supposent de piocher dans le “on-dit”, d’en déjouer les évidences, ainsi que dans un matériau vivant, le sien, pour – de préférence – le défigurer. Oui, d’autres idiots penseront au mentir-vrai d’Aragon, c’est connu ! mais, je vous le dis, cela dépasse quelque préoccupation théorique ; est en jeu l’essence même de la création.
Hélas la fiction, de nos jours, est incessamment dépecée par une cohorte de critiques et de mauvais lecteurs, par une cohorte de lecteurs psycho-analysant, psycho-judiciarisant. La fiction fait face à la morale, et face à la morale on perd fatalement. Si bien qu’il est ardu d’oser même inventer quoique ce soit, maintenant, sous peine de devoir à jamais et pour toujours, et devant toutes les instances moralo-critico-littéraires, et autres tribunaux publics, se justifier. Battre la coulpe. On en revient à Sainte-Beuve. Moi qui pensais que Proust lui avait réglé son compte. Hélas non ! L’œuvre est l’auteur – et vice-versa. Mais que se fiche-t-on, bon sang, des vérités extérieures au roman ? Que se fiche-t-on des idiots qui les composent ! Eux-mêmes s’en préoccupent peu. “Ce fils a fait son père” disait Michelet, c’est dire ! Lolita Pille a souffert d’une assimilation, d’une réduction, de son œuvre à elle-même, tandis que certaines œuvres souffrent d’une assimilation à leur auteur. Je vous en prie, tenons-les séparés.
Il est maintenant temps de refermer cette parenthèse.)
Prise au piège, Pille est réduite à l’agaçante créature d’un système tout autant détestable, à la chose bourgeoise d’un talent volé. Contre elle, naturellement se déchaînent les calomniateurs :
“Vous n’avez pas écrit votre livre et j’ai la ferme intention de le prouver.” Livia E., journaliste.
“Vous n’êtes pas l’auteur de ce livre. Beigbeder est le véritable auteur de ce livre.” Jean-François K., journaliste, Paris Première.”
Ce qui pourrait nous étonner réside dans la facilité avec laquelle ce monde médiatique s’autorise à broyer la jeune autrice, l’autrice-en-devenir qu’est Pille, à la mettre au bûcher, pauvre sorcière. Pille est pourtant fière. Fière d’avoir su transformer la laideur, la laideur du monde au sein duquel elle gravite. De l’avoir assemblée, transfigurée en une sorte de théâtre baroque où viennent se peindre une succession de tableaux-personnages et tous les malaises du temps. Amèrement, elle résume : “ Quand il s’agit de slut-shaming, le monde journalistique, adulte, huppé et diplômé ne se comporte pas différemment de racailles ou de lycéens en quête de plaisirs cruels. […] Me voici au nombre des chiens et des chiennes enragées vers lesquels une presse envoûtée et achetée par le patronat – et reconvertie en fabrique de boucs émissaires – détourne la colère du peuple. La diffamation : cette plaie qui défigure. Un jugement loyal : la fleur la plus rare.”
La violence radicale dont est empreint l’ouvrage, sert moins de démonstration que d’usage, et les événements collectés, comme autant de preuves, sont moins des témoignages que des armes.
C’est la force d’Une adolescente : il ne s’agit pas d’un récit-mémoire, d’un parchemin-des-douleurs, pas davantage qu’il s’agit d’un mouchoir sur lequel on glisse à l’encre quelque larme. La violence radicale dont est empreint l’ouvrage, sert moins de démonstration que d’usage, et les événements collectés, comme autant de preuves, sont moins des témoignages que des armes. Le talent de Lolita Pille ne réside pas dans la mise en scène de quelque bûcher littéraire, mais bien dans l’élaboration du sien pour y jeter la horde, ou la meute, toute la meute, en leur renvoyant le brutal reflet des violences passées. Ici la violence n’est pas monstrative mais réversible, l’écriture se fait poignard et la parole assertorique.
Comment prépare-t-on un bûcher ? L’intégralité de l’ouvrage se construit par dichotomie d’ensembles. L’espace domestique/familial et la nuit parisienne, le primo-érotisme intérieur, naïf, de Pille ado et la pornographie sauvage de l’époque, les bandes de gamines moquées et les gamins moqueurs… Couple-dualité-confrontation. Un exemple ? “Notre civilisation utilise deux sortes de filtres : le romantisme et la pornographie. Ils marchent comme ces mouvements de caméra appelés travelling arrière et zoom avant. Le romantisme éloigne l’œil : flou des organes génitaux. La pornographie rapproche l’œil : flou des âmes.” Cela nous rappelle Georges Bataille et son érotisme singulier, et son imagerie, ou son bestiaire, pornographique. Et précisément, sur son théâtre des obscurités humaines, le déchaînement de ceux-ci à des fins métaphysico-politiques : détruire les cadres, prévenir du danger que courent les sociétés modernes. Souvenons-nous de Dirty, “décolletée jusqu’à l’indécence” dans Le bleu du ciel, ou bien cette autre scène, sans doute l’une des plus belles d’amour, atmosphériquement orageuse, qui déroule à la lumière d’une lune, dans un cimetière :
“À un tournant du chemin un vide s’ouvrit au-dessous de nous. […] Je pris Dorothea par le bras. Nous étions fascinés par cet abîme d’étoiles funèbres. Dorothea se rapprocha de moi. Longuement, elle m’embrassa dans la bouche (notez la singularité du langage !). Elle m’enlaça, me serrant violemment: c’était, depuis longtemps, la première fois qu’elle se déchaînait. Hâtivement, nous fîmes hors du chemin, dans la terre labourée, les dix pas que font les amants. Nous étions toujours au-dessus des tombes. Dorothéa s’ouvrit, je la dénudai jusqu’au sexe (autopsie d’une petite mort à venir). Elle-même, elle me dénuda. Nous sommes tombés sur le sol meuble et je m’enfonçai dans son corps humide comme une charrue bien manoeuvrée s’enfonce dans la terre.”
Ainsi, bûcher, Une adolescente constitue la parfaite revanche de Pille et la défense de Lolita, contre tous ceux qui ont voulu, précisément, la réduire à cette Lolita-là, à cette Lolita de plus, contre tous ceux qui ont cherché à la lolita-nabokover, à la humber-humberiser, ou simplement à la plateau-télévisionniser. Une adolescente amalgame le doigt d’honneur, ce doigt que l’on fait de jeunesse à ceux qui nous emmerdent, et le poing levée de la femme que Lolita Pille est devenue – le poing levé des résistances.
Ce qui nous touche, au fond, dans ce récit, c’est l’âpre reconquête d’une dignité perdue. Une reconquête qui, intelligemment, ne cesse de dévoiler les communs fondements d’une violence institutionnelle, se déployant à tous les niveaux du spectre social (depuis le harcèlement et la calomnie, au viol). Parallélisme de formes, parallélisme de moyens. Vive les bûchers littéraires contre les crimes de genre.
Les mécaniques d’une femme
L’autofiction, ici, ouvre la porte de l’autoanalyse, et peut-être même de la réconciliation – avec la figure parentale, nécessairement maltraitée en ce temps où les cadres rigides, sous le regard de l’adolescent, ne semblent destinés qu’à la destruction.
Qu’est-ce que l’adolescence, si ce n’est cette période fugace du coup de dés intégral ? L’adolescent est, par essence, un hyper-joueur. C’est être à la vie comme d’autres vont à la roulette dans casinos, avec les envies pleines et débordantes, avec des envies partout, des envies de tout, des envies qui inondent le monde et le submergent, avec de gros désirs, des désirs de braquage et de révolution, d’action violente ou bien de liberté, c’est être prêt à tout faire sauter, en claquant des doigts, à rafler la mise ou bien à perdre le tout. C’est être ce corps en furie, ce corps furieusement désirant, et non pas uniquement d’autres corps, mais bien la vie, la vie en elle-même. Sur cette période, Lolita Pille opère une retour réflexif, transformant le matériau mémoriel en une série d’apprentissages. L’autofiction, ici, ouvre la porte de l’autoanalyse, et peut-être même de la réconciliation – avec la figure parentale, nécessairement maltraitée en ce temps où les cadres rigides, sous le regard de l’adolescent, ne semblent destinés qu’à la destruction.
“Mécaniques d’une femme”, en ce sens qu’Une adolescente souligne l’importance prise par l’autre dans le cadre du devenir-adulte. Une adolescente, l’être-adolescent, n’est-il pas autre chose que le conglomérat, plus ou moins filtré, plus ou moins altéré, plus ou moins recomposé, dilué, des innombrables rencontres faites en ces temps ? Hegel lui-même le dit : l’adolescent est l’être du bourgeonnement, l’être du non-être, l’être sartrien par excellence, celui qui virevolte. C’est l’être de la projection, du toujours-en-devenir, l’être qui n’est plus tout à fait lui-même et qui n’est pas encore ce qu’il sera, l’être de la révolte qui toujours embrasse la fuite.
Les occasions de fuir, chose pratique, ne manquent pas au temps de l’adolescence. Il y a les disputes familiales, “Quand la discorde est dans ton foyer, la rue te paraît pleine d’amour” écrit Pille ; il y a encore le simple appel des nuits, moment où le masque des villes s’abat, moment des métamorphoses urbaines, avec ses lois propres, son peuple, ses coutumes :
“La nuit est une autre ville. Au milieu de petites rues, des foules en noir serrent les portes des clubs et s’y précipitent comme des chauves-souris dans leur grotte. Dépasser les autres fait de vous le roi ou la reine des chauves-souris. C’est bien une grotte humide. Saturée de sueurs et de fumées. […] Descendre, c’est monter. Je descends l’escalier. Une bouffée me prend la gorge. D’en bas, l’odeur chaude des corps souffle et remonte, imprégnée par les sons et les lumières. Une haleine sulfureuse me mouille le visage, l’éveille et le baptise, comme, à la sortie de l’avion, les brumes brûlantes de Chine.”
L’autre, c’est aussi l’ami, qu’il soit le miroir ou bien l’anti-reflet. Lolita Pille revient ainsi sur l’influence que d’autres adolescentes, d’autres presque-femmes, ont eues sur elle. Les amitiés sont une famille. Il y a Régina, l’amie de banlieue, “son premier amour”, qui lui “a appris comment donner un coup de poing, un vrai, contre sa paume ouverte ; à boire, marcher, danser avec du style ; pisser debout et peindre mes yeux d’une arabesque altière avec un pinceau noir, comme aux tempes d’une reine égyptienne morte, pas d’autre maquillage”. Ou bien Ambre, la bourgeoise, reine de Paris la nuit tombée, sur son scooter et avec son argent dérobé qui gonfle les poches et ouvre les portes, sur laquelle “les engueulades glissaient”. Le récit fonctionne ainsi comme autant de grands rouages, chacun appartenant à un temps donné, qui viennent s’agrandir d’une nouvelle rencontre, d’un nouvel événement, d’une nouvelle fuite, d’une nouvelle blessure.
Mais il y a surtout, et partout, la parole de l’autre. C’est, précisément, cette parole performative qui “produit” l’adolescent, qui l’informe, au sens bataillien du terme, c’est-à-dire qui tout à la fois l’étire et l’éclate et lui donne naissance.
Et des blessures, on en compte sur le corps de l’adolescent(e). Car l’autre, c’est également le bourreau. En l’occurrence, nombreux sont les bourreaux quotidiens, les bourreaux blanchis, qui, sans trancher des têtes, condamnent bien des vies. La parole, en tant que source primordiale d’altérité, est ici démontée comme ce qui tout à la fois relie et détruit, comme ce qui humilie et protège, comme ce qui assassine ou bien fait grandir. Que sont ces paroles meurtrières ? Il y a la parole des injonctions, parole des lois morales à peine écrites qui font battre la discipline dans les établissements scolaires. Il y a la parole parentale, parole des ordres et des interdictions, parole des engueulades et des frustrations. Mais il y a surtout, et partout, la parole de l’autre. C’est, précisément, cette parole performative qui “produit” l’adolescent, qui l’informe, au sens bataillien du terme, c’est-à-dire qui tout à la fois l’étire et l’éclate et lui donne naissance. Dans l’ouvrage, une séquence me marque particulièrement, séquence que l’on pourrait appeler “la fabrication des laides”. Lolita Pille démontre combien le langage, de sa puissance, pour ainsi dire de sa magie, détourne et pirate, les humeurs, l’esprit, le corps et même l’âme des sujets auxquels il se destine. Destruction intime et corporelle à coups d’épithètes létales : “Bientôt, j’ai appris que certains garçons de la classe nous surnommaient la Cour des Miracles. Ils nous trouvaient laides.” La scène se déroule au lycée, dans ces champs de guerre que l’on nomme cour de récré :
“Il leur a suffi de la nommer pour qu’elle soit. Oui, comme un sortilège. Notre tort a été de les écouter. Florence Manens, par exemple, la meilleure en maths. Elle n’était pas plus bossue que j’étais lépreuse. Elle ne se tenait pas droite, c’est vrai. […] Et c’est seulement lorsque Baptiste Lefèvre et sa bande ont commencé à l’appeler “bossue” que Florence a enroulé son cou dans ses omoplates et baissé la tête, jusqu’à ce que son dos saille comme celui d’un rapace. Changer nos noms a été leur première initiative. […] Plus de Florence Manens, de May Sterne, de Blandine, de Judith et de Lolita. À leur place, sont venus au jour la Bossue, la Folle, Blandino, Auschwitz et la Lépreuse.”
Tératologie discursive dont, comme tant d’autres, j’ai moi-même et souvent fait l’objet.
Ces mécaniques, ce sont enfin celles du désir. À l’âge des adolescences, ce désir est omniprésent. Non pas que l’adolescent soit, en puissance, ce petit être hypersexuel, mais qu’il subisse de plein fouet, entrant à moitié dans le champ des adultes, les sursauts, consentis ou non, du désir – du sien comme celui des autres. En réalité, tout est affaire d’écart, entre celui-ci et ceux-ci, entre l’intimité désirante et l’intimité désirée, entre le désir naissant encore naïf de l’adolescente, et le désir visqueux d’hommes plus âgés. Tout est question d’écart et, potentiellement, d’incompatibilité – et alors de force. Certes, l’adolescence marque le renoncement à un certain idéalisme, c’est l’advenue du bas, de la matérielle bassesse du bas, c’est le triomphe du génital, pas vraiment glorieux, dans la haute sphère de l’Amour : “ Non, Krim ne m’enflammerait pas de cet amour dépeint par Emily Brontë dans Les Hauts de Hurlevent, dont je conservais une page arrachée dans mon porte-monnaie : “Ma grande raison de vivre, c’est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurât, je continuerais d’exister ; mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l’univers me deviendrait complètement étranger, je n’aurais plu l’air d’en faire partie.””
Plus exactement, de ces grandes pages d’amour, il s’agit à la fois d’en sortir, via le rugueux frottement du désir, en l’occurrence masculin, monotopique car davantage tourné vers l’utilisation du corps, et d’y rester, par force d’idéalisme – par croyance.
De ces grandes pages d’amour, auxquelles on croit facilement, de ces grands élans romantiques qui donnent une image exigeante de la relation amoureuse, il s’agit d’en sortir. Plus exactement, de ces grandes pages d’amour, il s’agit à la fois d’en sortir, via le rugueux frottement du désir, en l’occurrence masculin, monotopique car davantage tourné vers l’utilisation du corps, et d’y rester, par force d’idéalisme – par croyance. À ce sujet, je me suis souvent demandé pourquoi certains s’entêtent dans des relations toxiques, asphyxiantes, pourquoi certains s’enterrent en s’agrippant à des amours sans souffle, est-ce une question de désir ? Ou bien de son absence ? À quelles lois obéissent ceux qui s’entêtent à jouer inlassablement la même partition, à répéter les mêmes notes de violence, de déception et de dégoût ? N’ont-ils tout simplement pas pu sortir de cette adolescence, de cette adolescence naïve que la cécité protège ? C’est en tout cas par l’acte d’écriture, au travers de la littérature, que Lolita Pille rétablit un regard sur celle qui, parfois, a pu manquer de vue. Décryptant ses propres choix, absurdes ou risqués, elle fait sourdre le sens de cette jeunesse non pas perdue, mais disparue.
Et puis, arrive le viol – sortie du domaine du désir. L’adolescente se retrouve prisonnière d’un homme, d’une pourriture. Dans une scène monologique d’une rare violence, Lolita Pille retranscrit les paroles du bourreau au-travers desquelles s’engendre le viol. L’efficacité du langage, autant que l’économie de la scène, essoufflent. On sort de la lecture poisseux en lecteur impuissant.
Néanmoins, si le lecteur s’arrête à ce viol, il n’aura rien compris. Car la chose primordiale, me semble-t-il, que l’autrice tient à démontrer, c’est tout simplement l’omniprésence de la violence. Ce n’est pas tant le viol en lui-même, que sa répétition, sous d’autres formes, à des dégrés divers. Omniprésence et pour ainsi direi banalité de la violence, qui toujours se répète sans jamais être punie, ni même vraiment combattue. Car des viols il y en a de toutes sortes. Viol, lorsqu’un jeune homme tague sur la porte de la maison familiale le mot pute : “Pute est le mot que Cillian L. exhuma de sa féconde imagination et tagua sur la porte de mes parents une belle nuit de janvier 1997.” Viol encore, quelques années plus tard, lorsque toute une industrie se déchaînera contre Pille autrice d’un premier roman. Viol lorsqu’une meute de trollers trouvera divertissant d’insulter et de menacer des femmes, plus ou moins médiatiques, sur les réseaux sociaux. Viol toujours, comme si cette mécanique, cette mécanique-là, demeurait indépassable, comme si elle était promise à tourner, à tourner encore, comme si ses rouages ne pouvaient ni être freinés, ni être modifiés. Il faut être naïf pour croire cela, bien-sûr : il est temps de faire exploser cette machinerie. La littérature, lorsqu’elle est efficace, n’est-elle pas l’équivalent d’un bâton de dynamite ?
Avec une adolescente, roman des apprentissages, autofiction des initiations, Lolita Pille livre une œuvre d’une grande qualité. Sans être belliqueux, l’ouvrage est virulent, tranchant le nœud gordien d’une société à la violence systémique, qui s’abat sur les corps adolescents, et plus particulièrement sur les jeunes filles/femmes. Il ne s’agit cependant point d’un pamphlet, ni même d’un récit, mais bien d’un oeuvre proprement littéraire, poétique et intelligente, dont on sort lessivé mais avec l’adolescente envie, envie si nécessaire mais si fragile, à l’instar d’un flambeau que des générations se passent, de poursuivre la lutte, de se mettre au combat.
Bibliographie :
Pille, Lolita, Une adolescente, Stock, 2022.