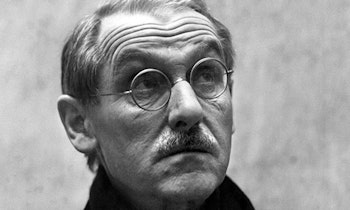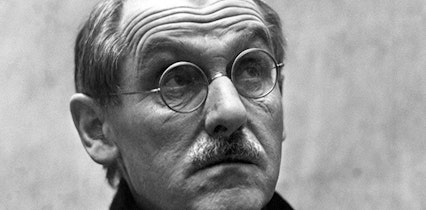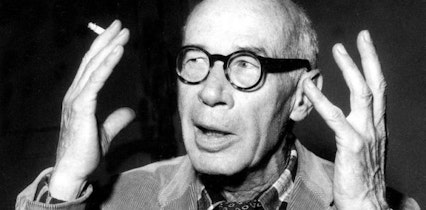A l’occasion du Festival America 2022, Zone Critique présente le dernier ouvrage d’Eugene Marten, Ordure, paru aux éditions Quidam. Dans ce texte traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe, Eugene Marten nous plonge dans la ronde journalière d’un agent d’entretien. Des bureaux déserts aux détritus de leurs poubelles, le style minimaliste de ce portrait fait de la visite de cet espace intérieur singulier une expérience déroutante pour le lecteur.
Choisir le bon produit pour les vitres, supporter les blagues grivoises de ses collègues à la pause déjeuner, ratisser les moquettes avec l’aspirateur calibré selon les désideratas de l’entreprise et enfin glaner un petit morceau de sandwich en vidant les poubelles ; voici l’enfer salarial dans lequel Eugene Marten engage son lecteur en l’invitant à suivre les journées de l’agent d’entretien Sloper.
Les prémices du récit sont simples. Sloper fait partie de l’équipe des agents d’entretien d’un immeuble de bureaux et passe le plus clair de son temps à se cacher. Pendant la journée, dans l’indifférence générale, il s’attache à ratisser les moquettes (dont le sens de brossage varie selon les bureaux), faire briller les carreaux et délester les poubelles de leurs détritus, leurs déchets et, surtout, leurs restes de nourriture. Quand la nuit est suffisamment avancée, l’employé du mois (récompensé pour sa docilité et la facilité avec laquelle il se fait oublier) regagne la cave de sa mère, qu’il ne voit jamais et dont la communication se borne à un échange de linge par le biais du vide-ordures, parfois ponctué de cris. Des open spaces souvent déserts, une communication quasi absente, réduite à des gestes et des borborygmes, et un personnage précaire, à la limite de la misère sociale. Un décor qui semble augurer un roman social, et pourtant… Bien que l’absurdité liturgique du règlement imposé au personnel et le caractère stéréotypé des discours salariés glanés au détour des couloirs peuvent faire sourire et rappelleront avec humour au lecteur que le monde de l’entreprise est bien souvent celui d’une aliénation bienheureuse, Ordure n’est pas un miroir pour que le néolibéralisme ne se regarde en face ; il n’y verrait que son derrière. Le point de vue imposé par le personnage de Sloper refuse au lecteur la lecture politique au profit de la dépiction d’un univers déshumanisé où la seule transmutation possible se fait par le bas, où la matière redevient matière.
Poubelle vide
Ce qui surprend en premier lieu, et très certainement ce qui rend ce roman si original, est la perception singulière qu’il adopte à travers le regard de Sloper : le regard d’un homme-rat plus habitué à survivre qu’à vivre et pour qui l’existence n’est qu’une succession d’occasions pour assouvir ses besoins, ses réflexes, primaires. La construction même du roman en témoigne : peu de liant, peu de temps morts entre ce qui finit par ressembler à des tableaux, des instantanés de vie où les expériences sensibles et leur compréhension s’interpénètrent. Le cheminement de pensée de l’agent d’entretien devant les stimuli de sa vie quotidienne est de l’ordre du masticatoire, la cause de toute chose apparaît systématiquement comme prémâchée et reste à l’état de bouillie consommée. Ainsi, aucune explication ne sera donnée à propos de la situation domestique de Sloper; nous ne saurons pas pourquoi il vit dans la cave de sa mère, ni ce qui les a conduits à vivre dans un tel état de désintérêt voire d’animosité mutuelle : « elle hurlait par le registre que ça dégénérait, comme c’était pas permis. Sloper ne savait ce qu’elle attendait de lui au juste. S’il se sentait d’attaque, il hurlait à son tour par le registre qu’il fallait qu’elle appelle la police ou qu’elle appelle l’autre, là – comment déjà, Virginia ou Véronica ? »
Dénué de circonstances, de causes, de son sens finalement, le monde dans lequel (où l’absence au monde dans laquelle) navigue Sloper est surtout celui d’une incommunicabilité fondamentale, qui cantonne les êtres à leur rôle social et rend futile toute tentative d’échange, échouant dans une accumulation de banalités vides de sens.
Le motif de la mort traverse le roman sans en être une clé interprétative ou narrative tout en étant la seule information sur le passé de Sloper ( où l’on apprend avec quelle légèreté et quel manque de considération pour le corps il exerçait ses fonctions d’embaumeur). Paradoxalement elle semble donc marquer des jalons importants, découverte d’un homicide et mort de la mère, sans pour autant faire avancer l’histoire. Elle n’est qu’un moyen pour rappeler l’aspect bestial du rapport au monde de Sloper. Si la mort de sa mère pourrait laisser entrevoir une clarification attendue sur la situation de Sloper, au moins un changement, ce ne sera pas le cas, le fils restera confiné au sous-sol en s’abandonnant au silence nouveau qui a envahi l’étage. L’événement central, celui qui annoncera le seul espoir de voir enfin la situation de Sloper, à savoir la découverte d’un cadavre féminin dans la benne à ordures, n’échappera pas non plus à la dévitalisation par la psyché. Face à une telle découverte, le lecteur aurait pu s’attendre à voir poindre une once d’humanité chez Sloper, un questionnement sur les circonstances de l’arrivée de cette femme parmi les ordures ou au moins un vague sentiment d’effroi. Mais rien de tout ça, seul le poids du corps rigide surprendra l’agent d’entretien pendant qu’il s’attellera à enrouler soigneusement le cadavre dans des chutes de moquette pour la ramener chez lui et s’en servir de poupée gonflable. Dénué de circonstances, de causes, de son sens finalement, le monde dans lequel (où l’absence au monde dans laquelle) navigue Sloper est surtout celui d’une incommunicabilité fondamentale, qui cantonne les êtres à leur rôle social et rend futile toute tentative d’échange, échouant dans une accumulation de banalités vides de sens. On pense tout de suite au mutisme qui caractérise les relations qu’il entretient avec sa mère, mais les relations extérieures (d’apparence, mais seulement d’apparence, bien plus heureuses) n’échappent pas à cette difficulté. Ainsi ses voisines, une femme tétraplégique et son aide-soignante, ne communiquent que par bips interposés et les conversations épiées au détour des couloirs de l’open space frappent par leur absence apparente de sens et leur minimalisme. Très régulièrement, Sloper passe devant le bureau d’un cadre habitué à rester tard au travail dont il retranscrit les conversations téléphoniques aux allures de monologue. Les départs de ces échanges semblent s’ancrer dans la matérialité et donc à même d’offrir enfin un sens à cet étrange univers. On commence par des propositions commerciales, un refus de se compromettre en vendant ses clients mais très rapidement, les conversations téléphoniques glissent dans l’absurde, retombent en enfance, évoquent des parties de pêche et des agressions dans un ton proche du délire fantasmatique :
« Une autre fois il l’entendit parler avec quelqu’un au téléphone, lui demandant : Tu es monté sur le plongeoir ? Le plongeoir du haut ou du bas ? Et elle, elle est montée avec toi ?
Demandant : Tu as sauté ou plongé ? Tu as fait la bombe ? Tu y arrives ?
Sauf que quand Sloper passa devant son bureau, l’associé avait dans sa main la photo encadrée d’un enfant, pas le téléphone. »
Cet immeuble de bureaux, cet univers fourmillant où employés et agents en tout genre s’affairent en suivant un protocole ubuesque apparaît bien vide, dévivifié, et ne semble tenir que par un seul lien : la colonne du vide-ordures, côlon d’acier, seule apte à donner un peu de substance aux choses. C’est par lui que tout arrive dans ce roman où règne une économie narrative, c’est le vide-ordures qui offre le cadavre qui offrira le seul rebondissement dans la vie bien réglée de Sloper, c’est aussi lui qui permet la seule communication entre le fils et sa mère. Plus que cela, c’est peut-être par lui que parvient la seule trace d’humanité compréhensible pour l’agent d’entretien : le contenu d’une poubelle.
Rien ne se perd
Le titre est clair, Ordure, le déchet, le détritus et les restes seront le fil rouge de l’œuvre. De l’univers professionnel de Sloper aux multiples descriptions du contenu des poubelles, tout renvoie à l’idée du rejet, de la seule trace que peut laisser un être dans un univers où la moindre humanité est niée.
C’est dans cette marge que se complaît Sloper, dont le comportement est plus proche du rat que de l’humain.Il récupère dans les poubelles morceaux de sandwiches, parts de pizza entamées et feuilles de salade oubliées dont il se remplit les poches et qu’il engloutit à l’abri des regards, dans la pénombre de l’ascenseur ou entre deux serpillières dans son local.
« Si des poches étaient vides, tu pouvais t’en servir pour y glisser des burgers et des sandwiches. S’il n’y avait plus d’emballage autour du burger ou du sandwich, tu prenais une serviette en papier d’une autre poche située sur le tablier plastique. Et ce n’était pas un problème si un sandwich ou un burger était à moitié mangé. »
Si Sloper semble avoir du mal à trouver sa place dans cet environnement social, homme-bête parmi les hommes creux, il est en revanche particulièrement doué pour décrire le contenu des poubelles.
Puis, au fur et à mesure, les petits plaisirs de Sloper font dans la surenchère, le grignotage des restes laissés devient une séance de masturbation dans un bureau lorsque il parvient à mettre la main sur des collants jetés dans une corbeille. Au franchissement de ces tabous s’ajoute une gradation dans l’horreur des descriptions organiques. Car si Sloper semble avoir du mal à trouver sa place dans cet environnement social, homme-bête parmi les hommes creux, il est en revanche particulièrement doué pour décrire le contenu des poubelles. Ces descriptions sont parfois une manière de sonder les habitus du propriétaire de la poubelle: dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es.
« Soit elle était végétarienne, soit elle faisait régime. Dans sa poubelle souvent, un petit plateau avec des morceaux de fruits sur une feuille de salade détrempée. Un muffin aux myrtilles entamé jusqu’à la corbeille de papier seulement »
D’autres fois, les conversations téléphoniques se laissent aller à une sorte d’évocation métaphysique du devenir de la matière.
« La chair se tasse contre l’os et prend de nouvelles formes, mais le mexicain ça fait plutôt de la bouillie. Si le plateau est jeté de travers dans la poubelle, le guacamole et la crème dégoulinent sur tout le reste. Le fromage formait une peau. Les haricots s’agglutinaient en une croûte glaiseuse et les chips tout collés les uns aux autres avec le fromage, devenaient mous et caoutchouteux ».
Un récit qui manifeste la dépiction de l’horreur organique au sein de laquelle l’agent d’entretien évolue.
Il y a tout un monde dans les descriptions imagées de Sloper. « Glaise », « peau », « chair », un homoncule comique de ce monde vide de sens dans lequel il évolue. Il le sait, rien n’est imputrescible et tout se transforme; ainsi, sans surprise, Sloper décrit la lente décomposition du cadavre comme un énième objet pillé dans les poubelles. Le lecteur assiste aux changements de teintes de la peau et d’odeur à la suppuration naissante, et, comble de l’horreur,à la description des différentes balafres que l’homme taillera dans la carcasse quand la putréfaction l’empêchera d’obtenir jouissance par les orifices premiers. Plus Sloper s’enfonce au plus profond des poubelles, plus le récit s’abîme dans la dépiction de l’horreur organique au sein de laquelle l’agent d’entretien évolue.
Ordure est une lecture déroutante, horrible parfois, dans la mesure où elle semble être une expérience proposée au lecteur tout en s’attachant par toutes les ficelles discursives possibles à le tenir le plus loin possible de toute interprétation. Et c’est peut être dans cette expérience de la marge imposée que se trouve le seul message politique audible: évoluer dans un système néolibéral, c’est faire partie d’un monde où l’humanité est niée, où la moindre trace possible du passage de l’homme est les restes, les déchets qu’il laisse derrière lui. Et quel meilleur moyen pour faire cette expérience du vide qu’une mise à mal par la narration des procédures d’interprétation, d’un point de vue qui force le lecteur à subir la surenchère dans l’immondice?