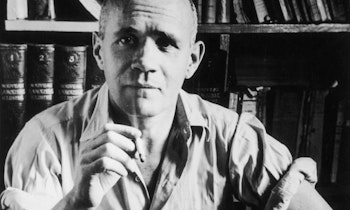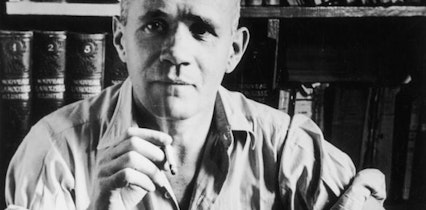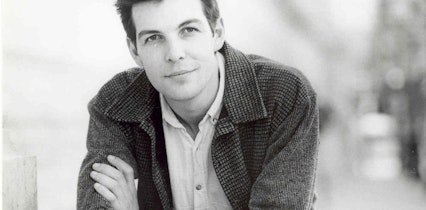Catherine Millet, fondatrice de la revue art press qui fêtera cette année ses 50 ans d’existence, continue son entreprise autobiographique. Après « sa vie sexuelle » (La vie sexuelle de Catherine M.), sa jalousie amoureuse (Jours de souffrance) et son enfance (Une enfance de rêve), voici que la célèbre critique d’art, avec Commencements, publié chez Flammarion, se penche sur ses années d’adolescence et d’entrée dans l’âge adulte, racontant la genèse des premiers numéros de la revue qui la rendra célèbre, art press.
Tout a commencé par la poésie, c’est-à-dire déjà par les mots, avec la fréquentation de quatre jeunes garçons qui avaient fondé une revue de poésie, Strophes. Catherine Millet a seize ans quand elle tient en mains son premier numéro de Strophes, le numéro 3, consacré au décès du pape du Surréalisme, André Breton. La jeune fille s’essaie alors à l’écriture de poèmes, qu’elle finit par détruire et qui ne la satisfont jamais. Assez vite, la jeune femme, pas encore sortie de l’adolescence, veut sa liberté, et fugue (avec Daniel T. dans le récit, c’est-à-dire celui qui allait devenir le galeriste bien connu Daniel Templon). Son amant fonde une galerie rue Bonaparte, la galerie Cimaise-Bonaparte, dans une cave : une cave à Saint-Germain-des-Prés : l’idée de « la bohême » de l’époque est respectée… Pourtant, on sent la jeune fille de l’époque indécise : oui ses proches la voient comme quelqu’un de « spécial », « une poète » ; mais, précise-t-elle, « je n’étais pas folle au point de ne pas entendre le murmure de raison au fond de moi qui désignait mon arrogance ». Elle préfère dériver qu’écrire (rappelons que l’époque est aussi au Situationnisme, même si l’auteure ne cite pas une seule fois Guy Debord dans ce livre) ; elle attend la Providence, des signes du destin : « Mais je n’avais pas trop à m’en faire, j’allais avoir de la chance, car les circonstances de la vie, de la vie réelle, me conduisaient sans que j’aie à les chercher vers ces rencontres miraculeuses que j’attendais depuis que j’avais commencé à lire des romans » (c’est moi qui souligne). Le mot est lâché : « lire des romans ». Car c’est bien par les mots, tout au long de son œuvre, que le désir se forge, puis prend forme.
Les mots et les images
Car que serait La vie sexuelle de Catherine M. (ou toute l’œuvre de Sade), sans la précision diabolique des scènes, rendue possible par les mots en un certain ordre assemblés ? Sans toute une disposition géométrique des tableaux ? Est-il encore nécessaire de souligner combien ce type d’œuvre est inadaptable au cinéma ? Le trop de réel des images empêcherait l’imaginaire. Le désir passe par les mots, mais par n’importe quels mots : des mots précis, soigneusement choisis dans et avec l’aide du dictionnaire. « Les premiers mots d’amour qui nous sont adressés ne sont-ils pas ce qui nous met vraiment au monde ? » Ils « nous apportent la vraie preuve de notre existence ». Plusieurs lectures de formation émergent du récit des souvenirs de Catherine Millet : Tombeau pour 500 000 soldats et Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat ; La maison de rendez-vous d’Alain Robbe-Grillet : c’est que le jeune couple formé de Daniel T. et Catherine M. voulait « ne rien laisser passer » de ce « qui se présentait comme nouveau, signé d’avant garde ». Pourtant, la première réaction de la jeune lectrice ne laissera pas d’interroger : « Ce n’était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière, que j’éprouverais ce sentiment inavouable de dépossession lorsque je lirais des livres dont le contenu me semblerait en partie rencontrer mes propres fantasmes : j’aurais du mal à accepter, non pas de les reconnaître, mais que l’auteur, en les livrant au public, les galvaude. » Les mots viennent-ils à manquer ? Le sevrage est difficile : « De ces mots que l’échange épistolaire avait matérialisés et multipliés, j’avais été abreuvée des jours durant, et la perspective d’en être privée me fit basculer d’un coup d’une innocence comblée à l’état hébété d’un ivrogne qui dessaoule. » La critique d’art s’expose, sa destinée s’affiche : « Au fond de moi, ce que je voulais, c’était écrire des romans. »
Être là où ça se passe
L’un des leitmotive des souvenirs d’adolescence de Catherine Millet est le besoin avoué d’être constamment synchrone avec l’art et la pensée de son temps : « Je désirais seulement être là où quelque chose se passait » ; or à la fin des années 60, cela se passait dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où le jeune couple va habiter ensemble. Commencements prend alors des allures de document sur ces années-là où tout allait vite, tout semblait possible. Vous vouliez voir un artiste important, un éditeur, un journaliste influent ? Vous lui téléphoniez (pas de filtrage avec les numéros qui s’affichent sur vos téléphones « intelligents », alors…) ; le rendez-vous était souvent pris pour l’après-midi même ; et parfois le soir vous couchiez avec…
Ce besoin d’être « d’avant-garde » ne va pas sans un certain snobisme, et l’auteure a la franchise de l’avouer : ces amateurs qui veulent être les premiers à avoir repéré tel ou tel artiste qui deviendrait connu sont souvent de vrais snobs (l’auteur de ces lignes avoue l’avoir été lui-même…). Pourtant, ce snobisme est sincère : « Rien ne vaut d’avoir été le premier à le [l’objet d’art] rencontrer, au moins d’avoir été de son premier cercle d’intimes. » C’est bien sûr comme cela et pour cela qu’on devient collectionneur : collectionner est un vice d’avant-gardiste (j’élimine ici les cas de spéculation), « les plus mordus deviennent collectionneurs pour garder l’objet » découvert avant tout le monde « près d’eux »), ou de fétichiste (« ceux qui aiment les œuvres d’art ne jouissent pas seulement de la contemplation d’un bel objet, ils jouissent d’être avec lui »). Non seulement une « faute » avouée est à moitié pardonnée, mais cette mise à nu sincère constitue tout le courage de soi dans la vérité que réclamait le philosophe Michel Foucault.
Pourquoi écrire ?
Catherine Millet l’avait déjà dit à l’époque de son « best seller », écrire lui permet d’établir une distance entre soi et le monde environnant : « Car pour se regarder souffrir, il faut extérioriser sa souffrance, c’est-à-dire l’exhiber, en détacher de soi des lambeaux que l’on agite et qui deviennent alors des signaux. » Manière de moins subir, mais d’interpréter une topographie intime, inversant ainsi le paradoxe du comédien selon Diderot : « Quand l’acteur sur scène garde une distance pour mieux faire croire aux émotions de son personnage, le comédien dans la vie adoucit de vraies et douloureuses émotions en y introduisant un peu de jeu » (par exemple les jeux sexuels de Catherine M.). L’auteure y insiste : en certaines circonstances, un « réflexe » lui « fait quitter intérieurement la scène, mouvement automatique de bascule qui fait [d’elle] la spectatrice des péripéties de [sa] vie » : un tel mouvement s’était déjà dégagé de notre lecture de La vie sexuelle de Catherine M. : un avatar semblait tenir son rôle, « un héros de fiction » possédant « toutes les qualités pour bien le tenir ([le rôle]), […], tant et si bien qu’il contamine la scène entière de son irréalité et qu’entre la vie, [sa] vraie vie, et [elle] se déplie un tapis d’indifférence » : meilleure critique de ce livre inouï et inoubliable. Dans tous les cas, l’écriture reste une thérapie (j’élimine ici d’office les inutiles feuilletonistes dixneuviémistes, qui se reconnaîtront d’eux-mêmes), « pour passer de la détresse à l’euphorie » : une échappatoire à un trop de souffrance. Celui-là qui ne souffre pas, n’a pas besoin d’écrire (ni même d’art).
L’avant-garde et après ?
La liberté sexuelle revendiquée et vécue très tôt par Catherine Millet va de pair avec le goût du nouveau en art.
La liberté sexuelle revendiquée et vécue très tôt par Catherine Millet va de pair avec le goût du nouveau en art : il s’agissait de défendre alors un art (conceptuel, minimaliste, expressionniste abstrait) qui n’en était pas un pour les autres (le grand public) – tel est la plupart du temps le destin des défricheurs : ils n’ont pas vraiment le choix ; ils doivent le faire : « C’était l’avant-garde, dans le futur tout le monde jugerait et baiserait pareil » (qui pourrait contredire Catherine Millet sur ce point précis ?) ; « de même que les artistes que je défendais seraient admirés de tous dans les musées où ils auraient rejoint les classiques » (idem). Les Commencements, ou une autre histoire de la libération sexuelle… Libération comme moyen de connaissance, connaissance de soi aussi bien. Volonté de savoir… volonté de donner un sens �à un art qui tente à tout prix de se soustraire à l’interprétation (exemplairement celui de Jean-Pierre Raynaud) : écrire dessus pour voir.
L’époque dont se souvient Catherine Millet, et qu’elle décrit si admirablement (en rendant avec une grande finesse le Zeitgeist), nous semble si loin maintenant : « tout entière tendue vers le futur », quand la nôtre est bouchée, réactionnaire, tendue vers la régression sur tant de sujets (repli sur soi, marche arrière énergétique, etc.). Tout était alors tellement possible que les « objets venaient se poser presque par hasard, en urgence, ovnis égarés sur un terrain mal délimité », ici et là : dans des caves, dans des lofts, dans le désert, sur des scènes de théâtre underground, etc. « C’était un art de fugitifs s’échappant du vieux monde où se lisaient encore les stigmates de la guerre, pour s’installer en terre inconnue et, ainsi que font les pionniers, tout fabriquer de leurs mains à partir de presque rien » (c’est moi qui souligne pionniers, tant ce terme fut le beau souci, véritable fil conducteur, de la revue qu’elle a fondée, jusqu’à aujourd’hui encore). Les artistes « pensaient pouvoir tout se permettre, pas par volonté de puissance », mais « par nécessité ingénue ». « Catherine Millet ou la folle ingénue de l’art » pourrait être un titre acceptable pour un futur biographe. Avis aux amateurs !…
Une seule phrase saurait résumer l’esprit de l’époque, et ce livre : « Car la vie allait son cours rapide » (nous sommes alors en 1972, et le premier numéro d’art press est paru). Comment ? vous trouvez notre époque lente, obstruée, quasi mortelle ? Mauvais esprit, va…
- Catherine MILLET, Commencements Flammarion, 318 p., 20 €
Crédit photo : Art Press