Les Tourmentés (Alma Editeur, 2022) est le premier roman du réalisateur Lucas Belvaux, à qui l’on doit déjà Un Couple épatant, 38 Témoins ou bien encore Des Hommes, son dernier film. Dans ce récit sombre et sous tension, tout part du désir (pervers ?) d’une riche veuve véneresse, qu’on ne connaît que sous le nom de Madame, qui, pour tromper son ennui telle une Lafcadio au féminin, s’est donné pour objectif de traquer le seul gibier qu’elle n’a pas encore chassé : un homme. Guidée par son majordome Max, elle porte son choix sur Skender, sans-abri et ancien légionnaire à la dérive, qui accepte son marché funeste contre une énorme somme d’argent destinée à sa famille. Ce dernier aura six mois pour se préparer et se rapprocher de son ancien foyer…
Le primo-romancier Lucas Belvaux revient pour Zone Critique sur ce récit haletant, à la construction implacable et qui, tout en sondant les affres les plus ténébreuses de la psyché humaine, reste paradoxalement et résolument optimiste et lumineux.
Votre roman a été publié après la sortie de Des Hommes, votre dernier film à ce jour, avec lequel il entretient une certaine continuité, notamment dans la description des conséquences de la guerre sur la psychologie de ceux qui la font et dont les destins se brisent. Cette envie d’écrire a-t-elle été concomitante à la réalisation du film ou est-elle venue plus tard ? Quelles correspondances y voyez-vous ?
J’ai commencé à l’écrire quelques semaines après avoir terminé mon film. Je n’avais pas pensé immédiatement à cette correspondance, bien qu’elle paraisse maintenant évidente et vous n’êtes pas le premier à la remarquer. Je suis parti sur l’idée d’écrire un film de genre, une chasse à l’homme, sur le modèle des Chasses du comte Zaroff en la modernisant. En effet, je n’avais pas envie d’une chasse à l’homme classique, non consentie par la victime, cela me paraissait important de changer ce critère. Il me fallait donc identifier un élément de modernité qui permettrait de justifier ce consentement, d’accepter ce qui n’aurait peut-être pas pu l’être autrefois. Je devais alors dépeindre mon personnage principal, Skender, en homme qui a tout perdu, qui éprouve un besoin désespéré d’argent (dans une société où il règne sans partage), qui est dos au mur et dont la vie n’a plus beaucoup d’importance. Et pour rendre cette chasse crédible, il fallait aussi le doter de compétences spécifiques pour être un bon gibier, savoir survivre en milieu hostile, se défendre et se cacher. Un peu comme dans un récit survivaliste.
Le début est très sombre et semble s’apparenter à un roman noir où la violence, le désespoir et l’absurde prédominent. Est-ce une référence que vous aviez à l’esprit ?
En effet. Quand j’ai commencé à l’écrire, c’était un roman noir dont je ne connaissais pas encore la fin. Au fil de l’écriture, je me suis dit que cet aspect de mon histoire, dont l’issue était censée être inéluctable et tragique comme dans tout roman noir, n’était plus si important que cela. L’évolution des personnages m’a convaincu de développer quelque chose de moins attendu. En quelque sorte, je sortais du cadre et, une fois sorti, il y avait un peu de cynisme à décréter que la fin ne pouvait être qu’un massacre. Parfois, les gens changent, ils peuvent découvrir les aspects plus lumineux de l’existence. Je le considère davantage comme un roman d’apprentissage avec des adultes. Il ne s’agit plus ici d’un enfant qui se rend compte de la réalité de la vie, qu’il avait idéalisée, et qui devient adulte en perdant sa naïveté, mais plutôt d’un récit où les personnages, qui sont déjà passés par tous les côtés sombres de la vie et ce, depuis leur enfance, apprennent, à travers l’expérience de la chasse, celle de la mort annoncée, à voir ce qu’il peut y avoir de lumineux et de beau dans la vie. On pourrait dire que c’est un roman noir lumineux.
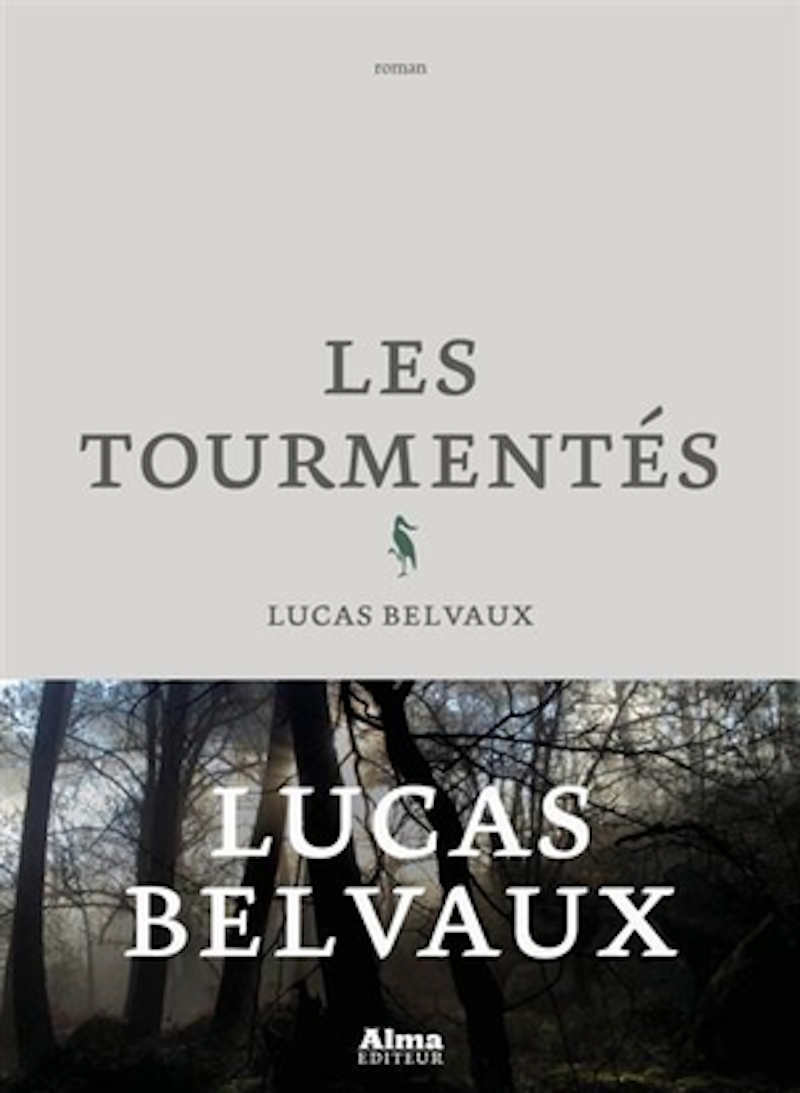
Pour former notre vision, nous avons deux yeux qui ne voient pas exactement la même chose : l’un est l’œil directeur et l’autre voit de manière un peu décalée. C’est ce qui donne le relief.
Multiplier les points de vue obéit à la même logique, qu’il s’agisse d’un film ou d’un roman. Mon récit est construit sur une suite de soliloques, il est raconté à la première personne par chacun des personnages, ce qui permet de multiplier les points de vue sur l’histoire, bien sûr, sur les autres personnages, aussi, qu’on voit de l’extérieur mais surtout, on a accès à leur l’intimité. On connaît les interrogations, le passé, les doutes, les angoisses de chacun d’eux. C’est cette introspection qui donne de la profondeur aux personnages et qui relativise les jugements qu’on pourrait porter sur eux.
Évoquons votre style d’écriture, qui est fait de phrases courtes, à la cadence hachée, avec très peu de dialogues, comme pour produire un effet haletant de suspense. Est-ce l’effet recherché ?
Bien sûr. Les personnages sont perpétuellement dans une urgence, ils doivent avancer. C’est donc une façon de rendre leur rythme. Mais plus on s’installe dans le roman, plus on plonge dans l’introspection plus les sentiments prennent de l’importance et plus les phrases vont s’allonger. Dans les chapitres qui décrivent les relations entre Skender et sa femme, par exemple, les phrases sont plus longues, « circonvolutives ». J’ai essayé de rendre le fil de la pensée qui peut passer du coq à l’âne, une réflexion en amenant une autre, une troisième ramenant le personnage dans son passé.
Les personnages suscitent tous a priori peu de sympathie : Madame est une femme sans scrupules et dénuée de toute empathie ; elle utilise son majordome Max qui lui est entièrement dévoué et qui semble réprimer lui-même ses sentiments ; quant à Skender, qui a perdu toute envie de vivre et se réfugie dans les regrets en attendant la mort, il n’hésite pas à monnayer sa vie. Cela dénote-t-il une vision pessimiste des relations sociales ? Le manque d’envie de vivre et d’aimer serait-il la source de tous les maux ?
C’est à la fois la source de tous les maux et un invariant du roman noir, un de ses moteurs. Il n’y a rien pour les sortir de la trajectoire qu’ils se sont fixée. Cette inéluctabilité est constitutive du roman noir et cela les conduit à la tombe. Je voulais faire ressortir cette impression-là, pour que le lecteur croie que la mort est inévitable, que ce soit celle du chassé, ou du chasseur, d’ailleurs. Et ce n’est que plus tard, vers le milieu du roman, que la ligne dévie finalement un peu. Les destins de chacun ne sont finalement plus si bien tracés que cela. Tout devient possible, la mort, la vie…
La toute première phrase est révélatrice. Skender dit : « La vie. La mort. La même chose. » La vie est donc désacralisée, tout comme la mort qui est relativisée. Donner un prix à sa vie, n’est-ce pas avoir perdu foi en l’humanité ?
Pas forcément. On peut dire que la vie est hors de prix, ce qui est encore autre chose. Mais si l’on réfléchit sur ce concept, « la vie, la mort, la même chose », on remarque que cela s’inscrit dans une chronologie. En effet, il n’y a pas de vie qui vaille sans savoir que la mort est au bout. On est conscient de notre mort et c’est ce qui donne du prix à la vie. Elle n’aurait pas du tout la même valeur si l’on était immortel. Mais cette phrase peut être interprétée de différentes façons et vous avez raison de voir aussi cet aspect de la chose. Je pense à cette séquence-clef du début quand Madame demande à Skender d’évaluer sa vie, de lui donner un prix. Ce dernier est en quelque sorte chosifié. Il devient un produit.
Cette phrase trouve son écho un peu plus loin, quand Max, en bon athée matérialiste, considère que la vie et la mort sont distinctes. Il y a l’avant et l’après, rien d’autre.
Ils sont tous athées et matérialistes. Madame le théorise dans ses propos mais pour Max et Skender, il s’agit de quelque chose d’intériorisé. La question de Dieu ne se pose plus. Ils ont été tellement confrontés à la peur, à la mort, à la guerre qu’ils se situent désormais au-delà du bien et du mal. Non seulement ils sont athées mais aussi amoraux. Pour eux, la morale n’a plus vraiment de sens. Elle n’est plus universelle. Ils ont leur propre morale et leurs propres limites.
Le roman porte une réflexion sur la guerre et ses conséquences : chacun des personnages est détruit et a souffert (du traumatisme, de la séparation, du déracinement). D’où une déshumanisation qui s’ensuit et qui les caractérise. Peut-on dire que la vie en société est la continuation de la guerre par d’autres moyens, pour parodier Clausewitz ?
Une guerre de classes, oui. Nous sommes en pleine lutte des classes, elle est très prégnante. Les personnages sont devenus ce qu’ils sont par l’histoire qu’ils ont vécue et qui les a rendus ainsi. Ils ne sont pas nés brisés, on les a brisés. Ils sont comme des bonsaïs : on ne les a pas laissé se développer ; c’est la raison pour laquelle ils souffrent de manques affectifs profonds qui les empêchent de croire en quoi que ce soit. Ils ont appris à survivre mais pas à aimer et puisqu’ils n’aiment pas, ils ne s’aiment pas eux-mêmes.

Votre roman s’attache à l’exploration de la psychologie des personnages pour en marquer l’évolution : par exemple, Madame passe de l’état bestial et sauvage (elle a le goût du sang et développe une relation fusionnelle avec ses chiens de chasse) à l’état de quasi-robot surentraîné et dénué de compassion pour finir peut-être par connaître la rédemption. Même si elle affirme ne pas croire en Dieu, n’y a-t-il pas là, inconsciemment, une manière de chercher et trouver le salut par la transcendance, qui serait alors l’amour ?
Concernant sa relation avec les chiens, elle ne fait pas du tout d’anthropomorphisme. Elle les laisse à leur place de chiens, même s’ils sont les seuls à qui elle reconnaît la capacité d’aimer sans rien attendre en retour. Quoi qu’elle fasse, ils l’aimeront toujours gratuitement et c’est cela qui est précieux pour elle. Elle n’accorde pas la même générosité à Max. Je ne suis pas sûr qu’il soit question de rédemption en ce qui la concerne. Elle s’humanise, oui, elle ne se rachète pas.
Mais, il y a en effet une transcendance qui serait presque animiste ou bouddhiste. Mais on n’est pas obligé de voir autre chose que ce qu’il y a. Un arbre n’est rien d’autre que du bois et des feuilles, il reflète la beauté de la nature, il n’est pas nécessaire d’y voir la main d’une force ou d’une volonté. On peut trouver cela encore plus extraordinaire du fait que c’est le hasard qui l’a créé. Je suis absolument matérialiste et je pense qu’il n’y a rien de plus beau que la nature sous toutes ses formes. Qu’elle soit le fruit du « hasard et de la nécessité » la rend encore plus extraordinaire et précieuse.
Paradoxalement, c’est Madame qui attache le plus d’importance à l’humanité : « Oublier ce qu’il est serait de la lâcheté. Pure et simple. La seule façon de reconnaître son sacrifice, c’est reconnaître son humanité. La célébrer. La nier réduirait l’acte à un fait divers insignifiant. Rien de plus qu’un crime. » En voulant tuer un homme, elle rehausse son humanité, la réhabilite. Là encore il y a un aspect presque métaphysique.
Bien sûr, il peut y avoir des références chrétiennes ou autres… On est influencé par le monde dans lequel on vit, par les réflexions des grands penseurs ou des religions. Je suis fait de cela aussi. Je pense que le fait que Madame soit la seule à réfléchir à l’Humanité et à théoriser ce qu’elle est et ce qu’elle fait est dû à son goût pour la culture, pour les arts. Son introspection ne consiste pas à analyser sa souffrance, car elle en a fait le tour, mais ses pulsions : « Pourquoi veux-je tuer cet homme ? En quoi est-ce plus intéressant que de chasser du gibier ? » La réponse réside dans le fait que c’est justement parce qu’il est un homme, et donc pas un animal comme les autres. L’Humain est conscient de sa mortalité et de son histoire, il est conscient qu’il laissera quelque chose derrière lui, une trace, ou un manque chez ceux qui l’aiment. C’est cette humanité qui l’intéresse en tant que gibier. Une fois qu’elle a compris ça, tout part à vau-l’eau.
Peut-on à votre avis voir en Madame une Lafcadio ou une Raskolnikov au féminin, dont l’obsession serait de commettre un acte gratuit, un « crime sans motif » pour reprendre l’expression de Gide ?
Oui, en quelque sorte. Raskolnikov aussi s’interroge et justifie son acte. La seule différence ici est qu’il s’agit d’une femme. C’est mon côté féministe : les femmes ont le droit d’être aussi noires que les hommes.
C’est en effet un personnage féminin fort, tout comme Manon dans un autre style. Toutes deux sont animées d’une forte volonté (tuer pour l’une, assurer le bonheur de sa famille pour l’autre), ce qui contraste avec la virilité en berne des hommes qui sont hésitants, en proie à d’incessants questionnements.
Manon, l’ex-épouse de Skender, est un personnage plus classique dans la représentation de la femme. Elle est stable et a les pieds sur terre. Quant à ma représentation des hommes, elle contredit le récit viriliste, qui est une idéologie en soi. Les soldats ont beau être endurants et surentraînés, ils sont aussi fragiles que les autres. Ils sont comme tout le monde. Et quand vient l’heure de la retraite, certains s’en sortent en faisant la part des choses, et d’autres ne s’en remettent pas. Cela vient aussi de la façon dont ils ont surmonté leur enfance, comment ils ont grandi et comment ils se sont construits. Les légionnaires sont des femmes comme les autres, pourrait-on dire.
La construction ou la reconstruction de l’amour est le grand thème du roman, avec une longue réflexion sur la notion de couple : il y a toujours un espoir de nouer ou renouer des liens. Le tableau n’est pas si pessimiste. Est-ce votre côté humaniste qui s’exprime ?
Skender réfléchit sur l’échec de son couple et prend conscience de ce à côté de quoi il est passé. Il l’impute à l’éducation qu’il a reçue. Il est le fruit d’une société clanique, violente, archaïque, qui ne laisse pas de place ou très peu aux enfants et à l’amour, considérés comme parts négligeables. On est d’abord un homme, un guerrier, un mâle, avant d’être un père et un mari aimant. Il va prendre conscience de cela au moment où il sait sa mort proche et commence à se demander ce qu’il va laisser derrière lui, à part de l’argent, ce qui est bien sûr loin d’être suffisant pour donner un sens à sa vie. C’est en cela aussi qu’il existe une transcendance, dans la volonté de laisser une trace derrière soi, un récit de son histoire, pour que ses enfants sachent d’où ils viennent.
L’anaphore « Skender a pris ma main. Ou peut-être ai-je pris la sienne », qui figure au début de chaque paragraphe dans un des chapitres, montre la relation devenue de nouveau fusionnelle entre Skender et Manon. Cela marque un tournant dans le sens où aucun retour en arrière n’est possible. Le bien-fondé de la chasse à l’homme est alors remis en question : peut-on risquer de tout perdre quand on a trouvé l’amour ? La vie peut-elle se jouer sur un coup de dés ?
Ils ont une histoire d’amour paradoxale : c’est un couple séparé qui n’a jamais cessé de s’aimer. Mais leur amour est toxique et impossible. Pour elle, aimer Skender est une souffrance. De même que ses enfants souffrent de l’avoir pour père ; c’est la raison pour laquelle elle le tient à distance, pour limiter et oublier cette souffrance qui est devenue son état naturel. Mais elle cède finalement à son besoin de l’aimer après l’avoir refusé pendant le premier tiers du livre. C’est en effet un tournant, car à partir de ce moment, il comprend que sa vie vaut la peine d’être vécue et qu’il ne faut pas la gâcher au risque de ruiner le nouvel équilibre qu’il a trouvé, ainsi que la vie de ses proches.
Un autre thème majeur porte sur l’apprentissage de la paternité. Quelle est votre conception de la famille ? Celle d’un noyau originel dont les liens du sang sont indépassables ? Ou une construction qu’il faut savoir entretenir ?
A mon sens, la famille traditionnelle tel qu’on l’entend généralement est une construction sociale et politique. Elle a été un objet de domination et de contrôle : les mariages n’étaient pas des mariages d’amour, les enfants se devaient d’être obéissants avant d’être aimants (et aimés) etc. C’était un des piliers sur lequel reposait la société. Cette conception de la famille ne m’intéresse pas, elle est dépassée et archaïque. Les liens, selon moi, ne peuvent être qu’affectifs et acceptés. On n’est pas obligé d’aimer ses parents ou ses enfants. On peut avoir des parents cruels. Madame a une mère que personne n’aurait envie d’avoir. Donc pour moi, la famille est une communauté qu’on se choisit, qu’on se construit. Si l’on ne l’aime pas, il faut s’en séparer. Le seul qui a tiré réellement les conclusions de sa propre enfance, c’est Max, en en renonçant à la famille qu’il aurait pu fonder pour sa carrière miliaire. Il a considéré que les deux n’étaient pas compatibles car sa famille aurait souffert de ses absences ou de sa mort. Il reproche d’ailleurs à Skender de n’avoir pas choisi, d’avoir voulu le beurre et l’argent du beurre.
Skender attache beaucoup d’importance à la transmission : il regrette de ne pas avoir légué sa langue maternelle (le bosniaque) à ses enfants. L’héritage, la transmission, sont-ce des notions primordiales pour vous ?
Il ne regrette pas tant le fait de ne pas le leur avoir transmis en tant que langue et culture que le fait de ne pas pouvoir leur communiquer toute la subtilité qu’il voudrait. Quand il essaie de leur écrire sa lettre, une sorte de testament sentimental et affectif, il se rend compte qu’il n’a pas les mots pour le faire correctement. Le français n’est pas sa langue maternelle, bien qu’on ne le voie pas dans le livre, c’est une licence que j’adopte.
Max est également intéressant car il est sans doute le personnage le plus pathétique : il perd un ami, ainsi que la considération de Madame. Il est tiraillé par les doutes et les interrogations sur les notions de loyauté, de fidélité aux idéaux, aux amis, à un éventuel amour.
Je ne dirais peut-être pas pathétique. En tout cas, il est le plus seul. C’est l’éternel problème de la double loyauté. Doit-il être loyal à son frère d’armes ou vis-à-vis de Madame ? Ces deux possibilités sont contradictoires. C’est le moteur de la tragédie classique, chez Antigone notamment : faut-il être fidèle au pouvoir ou à la mémoire de son frère ? Max n’a pas les outils théoriques pour sortir de cette contradiction, malgré ses efforts pour se cultiver. Il n’arrive pas à avoir une vision claire de la chose et manque de mots pour la formuler. La solution pour lui se situe entre la vie et la mort. Face à ce dilemme insurmontable, s’il veut sauver Skender, il n’a pas d’autre choix que se résoudre à tuer Madame.
L’évolution des personnages prime peut-être sur la trame du récit qui est secondaire. Vous vous attachez davantage à décrire la préparation de la chasse à l’homme que l’événement en lui-même. S’agit-il du fameux procédé cinématographique du MacGuffin ?
Bien sûr, ce sont des contraintes acceptées qui libèrent le récit. On raconte une histoire (celle de la chasse à l’homme) dont le lecteur n’a que faire, car il en a déjà lu et vu beaucoup. Mais elle sert de colonne vertébrale au récit. Une fois la mécanique de la chasse exposée dans ses grandes lignes, je n’ai plus vraiment à m’en occuper, je ne raconte que le strict nécessaire (la course, les chiens de chasse, le chasseur avec son fusil…). Le MacGuffin sert à accrocher le lecteur, à relancer l’attention ; il est le carburant qui fait tourner le moteur. Ensuite, on raconte ce qu’on veut.

On pense inévitablement à des références cinématographiques : par exemple, Skender tient un peu du Nick (incarné par Christopher Walken) dans Voyage au bout de l’enfer, pour son côté autodestructeur ; la réflexion sur le couple et la famille au retour de la guerre fait penser à American Sniper de Clint Eastwood. Sans parler d’influence, reconnaissez-vous cette parenté ?
En général, mes références, qu’elles soient cinématographiques ou littéraires, sont inconscientes, je ne m’en rends compte qu’après coup. Je ne me pose plus la question de savoir si, éventuellement, j’aurais plagié telle œuvre en écrivant tel passage ou en tournant telle scène. J’ adore Clint Eastwood au même titre que John Ford, Henry Hathaway, Alfred Hitchcock, Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard. Si ça se trouve, on pourrait, en creusant bien, peut-être même y trouver du Billy Wilder et du Blake Edwards. Un de mes films préférés est Diamants sur canapé mais je ne pense pas a priori qu’il y ait dans mon roman un lien quelconque avec ce film. Cela dit, il commence d’une façon très noire également et il va en s’éclairant. Il expose aussi une découverte de l’amour. Donc après tout, pourquoi pas. C’est la première fois que je pense à Diamants sur canapé en parlant de mon livre, mais en fin de compte, ce n’est pas absurde. C’est un faux film de genre, une fausse comédie, du maître de la comédie burlesque qu’était Blake Edwards. La scène de la fête est à mourir de rire mais elle reste d’une noirceur extrême. Il y a donc quelque chose qui relève du genre détourné.
On retrouve des échos dans votre propre cinéma : si l’on a évoqué votre trilogie pour la question de la multiplicité des points de vue sur une histoire, on peut également songer à Rapt, qui développe des thèmes similaires sur la mort omniprésente comme épée de Damoclès, la déshumanisation, l’éloignement de la famille…
Oui mais c’est normal de retrouver des thèmes dont on ne sort pas, qui reviennent toujours, des obsessions. Ça nourrit ce qu’on fait. C’est inconscient, mais je vais sans doute autant chercher chez Ford ou Fritz Lang que chez Hemingway ou Giono.
Justement, le personnage de Madame tient beaucoup de Langlois, le personnage d’Un Roi sans divertissement de Giono, qui organise des chasses (à l’homme et au loup) pour échapper à son ennui existentiel et qui finit par éprouver une fascination pour le Mal (symbolisée par les gouttes de sang d’une oie sur la neige, qui le fascinent et le poussent au suicide).
Je suis un inconditionnel de Giono et Un Roi sans divertissement reste probablement le plus obscur, le plus opaque, même s’il y a d’autres ouvrages qui sont tout aussi sombres. J’aime beaucoup Batailles dans la montagne pour sa célébration de la Nature, de sa beauté et de sa puissance.
Le processus d’écriture d’un roman est bien sûr différent de celui d’un scénario auquel vous êtes habitué. Il s’agit ici d’un exercice solitaire soumis directement à l’appréciation d’un lectorat. Comment avez-vous appréhendé cette indépendance nouvelle ? Est-ce un exercice plus difficile ?
J’écris mes scénarios seul ; ils ne sont lus tels quels que par le producteur, les financiers et les gens qui vont travailler sur le film, acteurs et techniciens. En revanche, quand on écrit un roman, on est toujours seul, parfois avec un lecteur privilégié, quelqu’un en qui on a confiance, un proche, un ami et puis, bien sûr, l’éditeur. Le lecteur voit donc ce que j’ai écrit en l’état alors qu’au cinéma, quand le spectateur voit le film terminé, il voit le produit d’un processus long de plusieurs mois, fait d’étapes successives, très différentes et plus lourdes. Il n’y a pas ce lien d’intimité (ou de proximité) entre l’auteur et le lecteur. Ce que voit le spectateur d’un film, c’est le produit d’une succession d’écritures différentes, parfois seul, parfois en équipe, souvent très techniques. Je pense qu’il est plus facile d’écrire un roman qu’un scénario car c’est une écriture moins contrainte, on jouit d’une liberté absolue. Je me suis senti très libre et heureux en écrivant ce roman. Il n’y aucune contrainte de temps, de budget… Dans un livre, si on veut écrire la bataille de Waterloo, ça ne coûte pas plus cher. Au cinéma, adapter La Chartreuse de Parme avec son débutserait compliqué eton essaiera d’éviter de représenter la guerre, pour des raisons de budget. En littérature, on laisse vagabonder l’imagination sans compter.
Avez-vous d’abord conçu l’histoire ou les personnages ?
L’histoire est venue dans un premier temps. Au début, j’avais l’idée d’en faire un film, noir, sec, le moins cher possible, avec trois ou quatre personnages. Je venais de terminer Des Hommes mais je ne ressentais pas forcément l’envie de me remettre à l’écriture d’un nouveau film. Je me suis contenté de prendre des notes pour plus tard. Puis, au bout d’un moment, je me suis rendu compte que ces notes ressemblaient à un début de roman et j’ai continué sur cette idée. La bascule s’est faite assez vite.
Serait-il envisageable d’adapter ce roman pour en faire un film ?
Je suis en train de travailler sur l’adaptation mais c’est difficile. En tout cas davantage que d’adapter le roman d’un autre écrivain. Dans ce cas-ci, la difficulté est de rendre l’introspection, de raconter ce qui s’y raconte. On peut avoir recours à la voix off, mais il ne faut pas en abuser, sous peine de lourdeur inutile. J’essaye donc de trouver un certain équilibre entre l’action et la réflexion, ce qui va m’occuper quelque temps.
Entretien mené par Guillaume Narguet
Crédit photo : (c) Olivier Dion






































