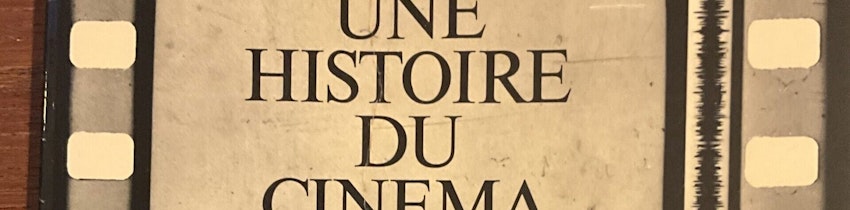Dans ce livre publié aux Editions Passés Composés, Gabriel Martinez-Gros poursuit la réflexion amorcée par sa Brève histoire des empires en prolongeant la pensée de son maître Ibn Khaldûn sur la vie et la mort de ces structures politiques. L’historien fait ainsi du tombeau de ces dernières le berceau des grandes religions universelles : l’empire agonisant perdant toute prise sur le réel, il compenserait son impuissance ici-bas par un discours tourné vers l’au-delà.
Il faut d’abord préciser au lecteur que l’ouvrage dont il est question est très dense, couvrant plus de deux mille ans d’histoire en deux cents pages, avec l’appui d’une érudition proprement ébouriffante. Aussi devrons-nous simplifier et, notamment, passer sous silence les développements pour ainsi dire latéraux expliquant les exceptions et variations de la dynamique que théorise cet ouvrage. Car, s’il présente un modèle, l’auteur précise à plusieurs reprises que l’épaisseur historique d’une part, la liberté humaine d’autre part, empêchent ce modèle d’être une partition millimétrée : il s’agit bien de décrire des logiques, et non de ramener l’histoire à un seul facteur.
L’empire, les sédentaires et les bédouins
Ceci étant précisé, commençons par rappeler la manière dont, partant de la réflexion de l’historien musulman Ibn Khaldûn (1332-1406), Gabriel Martinez-Gros définit l’empire : « Le point principal est la distinction des fonctions de violence d’une part, de production d’autre part. Le propre de l’empire, c’est que l’immense majorité de la population en est désarmée, productive, fiscalisée et relativement prospère, tandis que les fonctions de violence – et donc la souveraineté dont la violence est le privilège – sont assurées par d’infimes minorités issues de la ‘‘nature barbare’’ – une violence ‘‘barbare’’ qui est en fait construite par et pour l’empire. »
Avant l’ère industrielle – rupture majeure sur laquelle nous reviendrons –, le progrès économique, démographique et technique est extrêmement lent, et c’est l’Etat qui l’enclenche. En levant l’impôt, il concentre des richesses en sa capitale et en fait ainsi une grande ville, où la division du travail permet des gains de productivité ainsi que des innovations techniques et scientifiques – bénéficiant ainsi, dans un second temps, aux masses rurales sur lesquelles repose le poids de l’impôt. Plus l’empire est vaste, plus il organise un espace économique important, et plus la division du travail est poussée, permettant ainsi le développement du luxe, donc de la science et de l’art.
Mais l’impôt, héritier du pillage, n’est pas accepté aisément :
« le mouvement naturel des communautés humaines tend à le refuser, mais ce rejet enrayerait la mobilisation du capital dont dépend la prospérité. Il convient donc de briser ces résistances, par la force parfois, mais bien plus profondément par la persuasion du long apprentissage de la civilisation. » L’empire désarme peu à peu les populations passées sous sa coupe, physiquement en les privant d’armes, mais surtout psychologiquement : en brisant les solidarités claniques, si importantes dans la solidité des armées traditionnelles, et en dispensant les hommes du devoir de combattre, « ce que les hommes des tribus tiendraient pour une émasculation, mais ce que les sujets de l’empire, déjà acquis à la morale sédentaire, vivent comme un privilège. »
L’empire devient une oasis de richesses au milieu d’un monde pauvre, une oasis désarmée : cernée de tribus « barbares », « la société impériale ressemble à un corps dont on aurait abaissé les défenses immunitaires pour lui permettre de recevoir la greffe de l’Etat, de l’impôt, de la ville et de la prospérité. L’avantage écrasant du nombre est du côté de l’empire, mais il est annulé par la réduction [nécessaire] des sujets à la condition civile, par leur annihilation militaire. » Aussi l’empire recrutera-t-il des soldats parmi les tribus encore aptes à la violence, à des fins à la fois de protection extérieure et de maintien de l’ordre intérieur : ainsi, « les Turcs Xionghu dominent les effectifs des armées chinoises moins de deux siècles après l’unification de la Chine ».
Ces « barbares » qui rentrent au service de l’empire sont ceux qu’Ibn Khaldoûn appelle, par opposition aux sédentaires civilisés/désarmés, les bédouins.
L’empire, un pacificateur universaliste
A noter, que, souvent, cette les bédouins rentrent au service de l’empire en le conquérant – notamment en Chine, empire qui connut nombre d’envahisseurs – : car, s’ils décapitent alors la classe dirigeante, les nouveaux venus la remplacent et, par la violence qu’ils apportent, permettent le maintien de la perception de l’impôt, donc de l’empire. Un fois incorporés à l’empire ils connaîtront, eux aussi, la mécanique de la sédentarisation et, peu à peu, perdront leur capacité à la violence : ils feront à leur tour appel, sédentaires qu’ils sont devenus, à des bédouins vivant hors de l’empire – ou seront envahis.
L’empire est ainsi pacificateur afin de permettre la collecte de l’impôt, grâce au recours récurrent à une violence bédouine extérieure : mais il est aussi universel. S’étendant aux limites du monde connu, il « ne reconnaît pas d’autre souveraineté que la sienne. Il n’a pas de frontière, puisqu’il n’a pas d’égaux, mais seulement des confins. » Autour de lui se trouve « une frange d’ethnies dont il aiguise et sollicite la violence » et qui, infranchissables et tournées vers lui, l’isolent : les « systèmes barbares » qu’organisent les différents empires restent séparés. Ainsi, toutes les populations de chacune de ces sphères impériales (périphéries barbares incluses) identifient l’empire – leur empire – à l’humanité entière.
Paix et universalité : retenons ces deux valeurs de l’empire, qui seront celles des religions.
La religion, traîne de l’empire et revanche des sédentaires
Religions qui – c’est le grand apport de l’ouvrage – naissent de l’effondrement des empires sous leur propre poids. Le désarmement croissant de sédentaires sans cesse plus nombreux nécessitant des dépenses militaires croissantes et de moins en moins efficaces, l’empire est disloqué par sa contradiction interne entre besoin de violence et dynamique pacificatrice : ce moment est celui de l’impuissance du politique, donc de la naissance d’une « religion » ou, plus précisément, d’une « religion universelle ».
Rendues possibles par l’apparition d’une classe d’intellectuels (une conséquence de la division du travail permise par la dynamique de l’empire),
« les religions universelles subliment les valeurs sédentaires de l’empire, au moment où l’empire peine à les satisfaire, après les avoir posées en principes. Mais la religion achève surtout l’empire en ce qu’elle maintient la dualité du sédentaire et du bédoin, en réservant aux sédentaires, dont elle incarne la revanche, la pleine maîtrise des valeurs intangibles, et en rejetant dans l’à-peu-près du gouvernement quotidien la violence du monde, dont elle n’assume pas la responsabilité ».
A l’heure de la faillite de l’Etat, « la religion consacre la dissolution de l’action politique et des valeurs humaines ».
Il faut bien distinguer entre, d’une part, les religions universelles – christianisme, islam et bouddhisme – qui font du Mal une fatalité éternelle, et de la vie ici-bas une considération secondaire ; et, d’autre part, les « religions efficaces » d’avant les empires qui visaient, par le rituel – de la cérémonie de la pluie des Indiens Hopi aux sacrifices des cités grecques –, à obtenir une aide surnaturelle dans ce monde-ci, dans lequel l’action n’est pas perçue comme vaine.
Ainsi, par leur religion universelle, les sédentaires, au travers de la caste des clercs, vont reprendre les deux missions de l’empire. Elle fera tout d’abord de la paix et de la soumission à l’Etat une valeur morale. Et, en perdurant par-delà la fragmentation politique et linguistique née de l’effondrement de l’empire, voire en s’étendant au-delà de la sphère de ce dernier, elle maintiendra vivante la promesse de l’universalité.
Telle est la séquence historique présentée par l’auteur : sédentarisation – constitution d’un empire par la levée d’un impôt – recours cyclique à la violence des bédouins – chute de l’empire sous le poids de ses contradictions internes – naissance d’une religion universelle qui sublime l’impuissance de fait de l’empire en une valeur morale. Le cinquième chapitre s’attache ensuite à expliquer le déroulement de cette dynamique commune aux trois empires – romain, islamique et chinois – ayant engendré les trois religions universelles ; chapitre qui permet d’expliquer par les temporalités et les espaces différents dans lesquels se sont bâtis ces empires les différences qu’ils présentent dans l’incarnation de la séquence théorique générale.
L’Occident, un empire de « royaumes combattants »
Un chapitre central du livre est consacré à la modernité qu’ouvre la Révolution Industrielle, « retour de l’efficace », qui arrache l’Occident à l’impuissance chrétienne résignée – certes relative – qu’il connaît depuis la chute de Rome. Mais ce « retour » est avant tout un changement profond, qui altère la dynamique impériale qui avait cours précédemment. En effet, « l’alliance nouvelle des sciences et de la technique industrielle » devient plus efficace pour dégager des surplus que la prédation fiscale, et rend ainsi secondaire la violence nécessaire à la perception de l’impôt : désormais, « c’est la prospérité qui fait naître la force, et non la force qui autorise la prospérité ».
Les formidables innovations techniques redonnent à l’homme une puissance d’action et, partant, ravivent les espérances dans ce monde-ci : aussi la modernité déclenche-t-elle des phénomènes politiques extrêmes – révolutions et guerres totales –, toutes ces convulsions manifestant « l’hégémonie de la décision politique ». Elles permettent aussi à une région de « royaumes combattants », l’Europe (puis l’Occident), de dominer le monde comme un empire. Surtout, pour la première fois, les ravages de la guerre sont compatibles avec la prospérité, la hausse de la population et sa sédentarisation – comme le montre de manière si éclatante le XXème siècle –, là où, par le passé, seule la paix impériale permettait de sortir de la rusticité et des saignées démographiques.
L’avenir religieux de l’Occident impuissant
Une fois retracée la naissance de cet empire paradoxal qu’est l’Occident, Gabriel Martinez-Gros brosse ensuite le tableau, peu réjouissant, de sa décadence présente : démographie en berne, désarmement des populations avec la fin des services militaires, recul du pouvoir politique du fait de la mondialisation. Parmi les hypothèses qu’il évoque (et qui incluent celle de la permanence des Etats-nations occidentaux contre la logique impériale d’unification), il accorde un chapitre aux formes qu’une religion universelle à venir, traîne de l’empire occidental, pourrait prendre.
De ces possibles dogmes futurs (notamment l’antiracisme ou l’écologisme), relevons le tiers-mondisme, que l’auteur analyse comme une manière, pour l’Occident, de sublimer son impuissance politique en se maintenant, par le discours, au centre du monde. En effet, « le tiers-monde n’est ni l’Est, ni l’Ouest, ni le socialisme, ni le capitalisme. Le terme n’a d’autre sens positif que ce qu’il nie, c’est-à-dire l’Occident. Et donc il n’est pas d’autre histoire du tiers-monde que celle de l’Occident, rigoureusement inversée. » A mesure que de vieilles civilisations (islam, Chine) réémergent, « elles sont gagnées par une indifférence croissante envers la parenthèse de l’hégémonie occidentale, à laquelle le tiers-mondisme reste au contraire, pour le meilleur et pour le pire, et dans tous les sens du terme, passionnément attaché. » Aussi l’auteur imagine-t-il une communion de l’Occident, de l’Amérique latine et de l’Afrique non islamique dans ce dogme (combiné à d’autres, notamment l’antiracisme), qui préserverait la centralité de l’Occident tout en faisant oublier son inanité réelle – là où le monde islamique et l’Asie renoueraient avec l’action dans ce monde-ci.
Ce livre, tant dans sa partie historique que dans ses prospectives, est hautement stimulant, et bien trop dense pour être discuté ici, tant chacune des hypothèses finales sur notre avenir mériterait des articles entiers – a minima. Nous ne saurions trop en recommander la lecture : on y apprend beaucoup et, en même temps, on en ressort riche d’interrogations.
Référence : MARTINEZ-GROS, Gabriel, La traîne des empires. Impuissance et religions, Paris, Editions Passés Composés, 2022