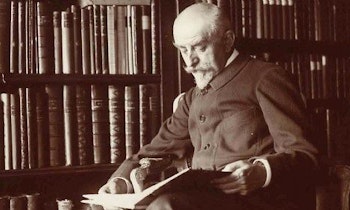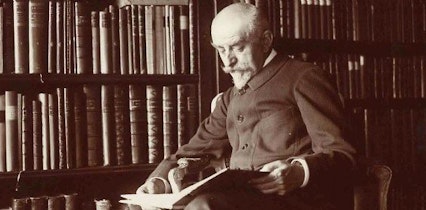Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor signent un nouveau documentaire sous la forme d’une errance à la fois hypnotique et politique dans la matière charnelle. Le titre cite le traité d’anatomie de Vésale, à raison : il s’agit de faire corps, à rebrousse-poil, par le cinéma.
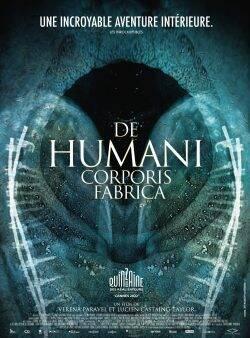
Si l’on considère la corrélation première entre étude de l’Homme et exploration anatomique, nul doute que Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor en reviennent aux fondements de leur discipline. Ainsi, après avoir exploré dans Leviathan (2012)les boyaux sanguinolents d’un chalutier, grand corps abritant les mille corpuscules de poissons éventrés, ils prennent ici pied, caméras endoscopiques au poing, dans le macrocosme a priori peu hospitalier… de l’Hôpital, et du microcosme qu’il abrite : le corps humain, fouillé par les outils optiques mis à la disposition du personnel médical. L’origine des plans est diverse : ceux de l’intérieur des entrailles proviennent des caméras scientifiques qui guident les chirurgiens ; d’autres, en salle d’opération, sont saisis par les cinéastes.
Une fois que l’œil du spectateur se glisse au sein du corps, il s’abreuve avec la joie d’un enfant des beautés du minuscule.
En dépit des apparences, le dégoût ou l’horreur ne sont que momentanés. De Humani corporis fabrica nous fait sentir pleinement humains : des humains qui partagent intensément du cinéma. Car nous palpons dans la salle obscure ce qui affole ponctuellement tel ou tel voisin : qui la césarienne, qui un tournevis vissé au cerveau, qui la trouée d’une pupille. Mais l’on s’aperçoit vite que c’est l’acte d’inciser ou de pénétrer (l’œil, le crâne, le ventre ou le côlon) qui suscite la répulsion. Une fois que l’œil du spectateur se glisse au sein du corps, il s’abreuve avec la joie d’un enfant des beautés du minuscule. Ce Monde sans Dieu est nourri d’une infinie curiosité, sans idéologie préconçue ni émotion facile face au fameux « miracle du vivant ». Nous sommes soumis par le montage aux exigences et au rythme des soignants. Lors de la naissance d’un enfant, la réunion attendue avec la mère est furtive, voire périphérique : il faut d’abord inciser les restes de l’épais cordon qui rattachait l’enfant aux limbes.
Conjuguer les infinis
Le film noue et renoue deux échelles, l’infiniment petit et l’infiniment grand, conformément là encore à un second élément topique du discours philosophique sur l’Homme : l’ordre du cosmos fait écho à l’organisation anatomique. À ceci près que dans De humani corporis fabrica, le cosmos est un corps politique en souffrance : celui des hôpitaux dans lesquels les cinéastes ont tourné. Il est fait d’artères, de nœuds, et de couloirs sans fin dans lesquels les malades errent, avec plus ou moins d’inquiétude. À cet égard, le rapprochement entre le corps et l’hôpital, quoique prometteur, paraît trop ébauché pour mener vers une réflexion véritablement politique, car l’assimilation du premier au microcosme et du second au macrocosme tend à gommer la différence de nature qui existe entre leurs failles respectives. D’autant que le film, assez long, n’évite pas tout à fait le risque d’un lisse égrenage de séquences d’opération.
Les plus belles séquences du film se jouent, par un contraste très réussi, auprès des corps dans lesquels la médecine n’entre pas.
Ici, des soignants éreintés par la crise sanitaire se plaignent explicitement de l’état de l’hôpital, au cours de discussions révoltées, anodines ou drôles qui font naître l’émotion et permettent au film d’éviter le piège d’une paradoxale et toutefois tentante… désincarnation. Car la plongée dans les tréfonds de l’anatomie pourrait revenir à n’exalter que la topographie paysagère en rose et rouge d’une carcasse humaine vidée de toute humanité : cette approche esthétique se cantonnerait à la fascination pour la richesse visuelle du biologique qui pulse dans un côlon ou un cervelet. Le visage des soignants apparaît tardivement et rarement mais leurs voix, présentes dès les premières minutes du film, accompagnent chaque opération et viennent rappeler le nœud qui se noue au sein de l’hôpital entre nature et culture, mais aussi trivialité et humanité.
Ces corps dans lesquels on n’entre pas
Les plus belles séquences du film se jouent, par un contraste très réussi, auprès des corps dans lesquels la médecine n’entre pas. Qu’ils soient dessinés, décédés ou fanés, ils donnent au documentaire son véritable propos. À la toute fin, ce sont ceux des soignants, représentés sur une fresque pornographique vitaliste lors d’une fête en salle de garde sur fond sonore de “I will survive”. S’y imposent des phallus disproportionnés et joyeux qui viennent remplacer le souvenir de la sonde introduite un peu plus tôt dans un triste pénis rabougri, à propos duquel un chirurgien rappelait la différence d’avec la verge – le premier n’est pas en érection, la seconde, si – avant d’ajouter : « Je n’ai pas eu d’érection aujourd’hui… Qu’est-ce qu’on se sent seul ». La séquence de fête nous plonge dans la part pulsionnelle de l’existence : celle qui fait tenir bon.
C’est que peu avant, dans l’avant-dernière séquence, la matière dans laquelle on n’entre pas est celle d’un cadavre à la morgue : on le rhabille au contraire, en tâchant de faire de l’humour tandis que la radio balance ses publicités (« Profitez des soldes chez Kiabi »). Enfin, et c’est là le plus déchirant : les corps en apparence préservés de l’intrusion endoscopique sont ceux des vieux et des fous, ceux qui n’habitent plus le monde de la rationalité scientifique dont tout le film nous expose la pertinence, mais un espace mental rempli d’incertitude et d’anxiétés. Les séquences de visite “chez les vieux” : voilà les virgules qui rythment secrètement le film et lui donnent une chair mélancolique. Un visage derrière une porte implore qu’on vienne le chercher rapidement. Chez cet homme, la parole s’enraye et s’enrage. « Pas la chambre, pas la chambre, pas la chambre » ; « Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée » ; « Ça c’est la façade. Je passe comme ça et je dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt ». Face à ce babil en roue libre, le seul repère possible réside par contraste dans la consistance des corps ouverts qui ont été exposés d’un bout à l’autre du long-métrage. Car la matière, en l’état actuel de la médecine, est globalement plus facile à soigner que l’esprit. Face aux mots du fou, il n’est pourtant pas question d’espérer le mutisme. Car on peut penser avec Pascal que le silence des espaces infinis n’a rien que de très effrayant. Or dans le corps, il n’est pas de silence : y battent paisiblement, rassurantes quoiqu’assourdies, les paroles des vivants.
De Humani Corporis Fabrica, un film de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor. En salles le 11 janvier 2023.