
Nombreuses sont les femmes aimées par des poètes qui ont été érigées au rang de mythes littéraires. Ainsi de Laure dans l’œuvre de Pétrarque, d’Hélène ou de Cassandre chez Ronsard, de Béatrice chez Dante… Au XXe siècle, le célèbre chant amoureux d’Aragon magnifie Elsa. Pourtant, si l’on connaît généralement Les Yeux d’Elsa ou Le Fou d’Elsa, il est difficile d’en dire autant des Chambres, Poème du temps qui ne passe pas, ultime œuvre du poète dédiée à celle qu’il aura aimée quarante années durant et qui, malade, devait mourir – comme tous deux le savaient – peu de temps après sa publication en 1969.
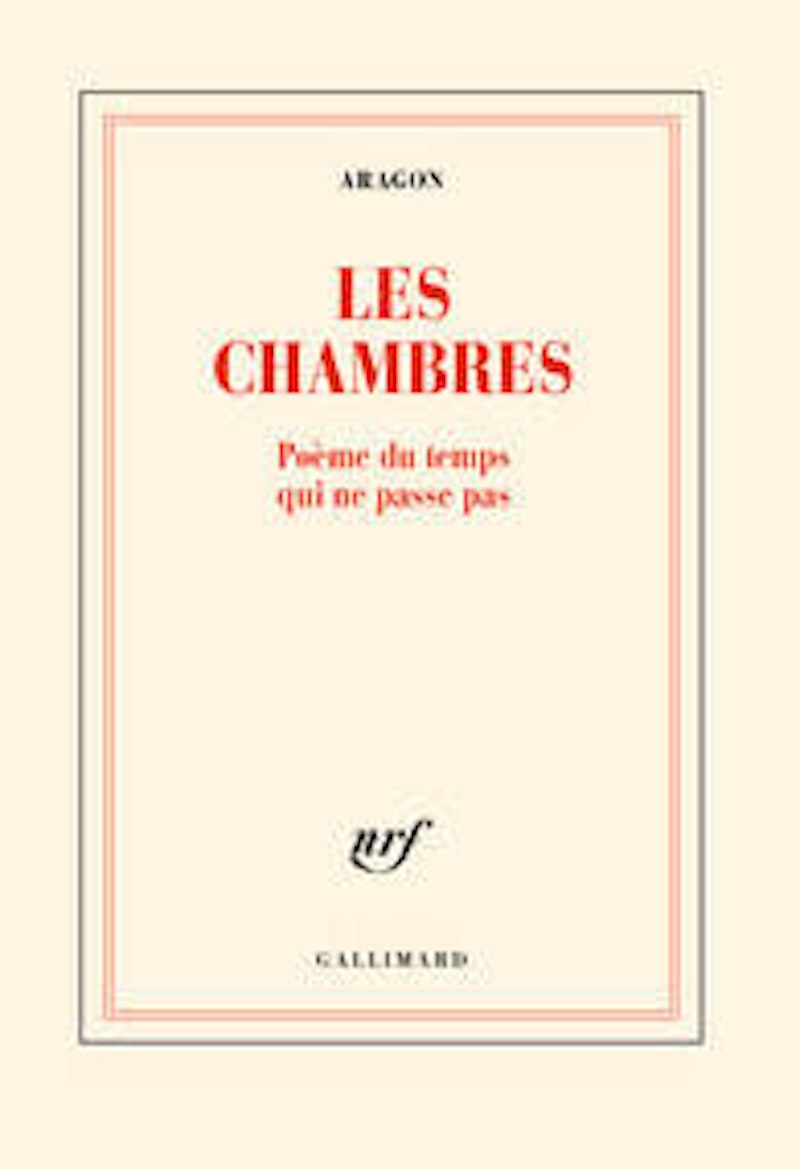
L’oubli dans lequel se trouve le recueil est d’autant plus regrettable – et l’invitation à le découvrir grâce à sa parution récente chez Gallimard d’autant plus heureuse – qu’il donne à entendre un nouveau chant [voir aussi à ce sujet le très bel entretien d’Olivier Barbarant]. Les Chambres est le lieu de la parole dernière, plus intime et plus vraie, dans laquelle le haut lyrisme a fait place à une poésie du murmure, qui n’exclut pas le cri et la voix étranglée. C’est l’œuvre du bilan, hantée par la disparition – du passé, de soi et de l’autre –, d’une bouleversante beauté.
Elsa Triolet, qui ne s’était pas reconnue jusque-là dans les poèmes d’Aragon (comme elle le dit notamment dans le court-métrage d’Agnès Varda Elsa la rose en 1966), écrit d’ailleurs à sa sœur au sujet des Chambres : « c’est notre vie à Aragon et à moi […]. Je les cite, les “chambres”, souvent dans Le Rossignol [NDLR : Le rossignol se tait à l’aube, roman d’Elsa Triolet], c’est étonnant, comme si ç’avait été écrit de la même main. Ce sont les chambres où nous avons vécu et ce qui leur est lié ».
« Elsa » s’efface
Ce qui frappe d’abord à la lecture est la quasi-disparition du prénom d’Elsa. Il ne figure cette fois ni dans le titre ni dans l’œuvre elle-même, hormis dans un poème où il se dérobe au moment même où il se dévoile : « Je perds de vue au loin ma voix ma vie / Le soir agite avec un mouchoir d’adieu / Sur cette scène immense où s’effacent les deux syllabes bleues / D’Elsa dans cet étonnement d’un baiser qui se brise ».
L’effacement du prénom préfigure ici bien sûr la disparition de la femme aimée – thème central de l’œuvre – mais permet aussi de faire advenir une parole où puisse affleurer, par-delà le mythe littéraire d’Elsa constitué par Aragon dans les recueils précédents, une plus grande vérité. Dès les premières pages des Chambres, Aragon annonce cette plus grande intimité qu’il s’apprête à livrer : « Je dirai les chambres de mots meublées / Où nous fûmes seuls / À vivre Ces quatre mots ces quatre murs / Le long siècle de nous qui n’est fait pour personne / D’autre ». Le temps passant, le poète se rapproche des paroles dernières, qui sont aussi les plus confidentielles : « Plus l’homme est vieux plus il est nu plus ce qu’il dit le quitte à regret de cette façon de quelqu’un qu’il le veuille ou non qui avoue / Un secret ».
L’imminence de la disparition
Si Aragon égrène rétrospectivement les chambres partagées avec Elsa dans le recueil, la logique adoptée n’est pas celle d’un parcours méthodique qui viserait à les inscrire et à les circonscrire sur la page pour en conserver la trace, les sauver de l’oubli en immortalisant un bonheur passé. Car, à la lecture de l’œuvre, on éprouve avant tout un sentiment d’inquiétude et d’urgence répété, lié à l’absence et à la disparition.
Ainsi Aragon évoque-t-il par exemple dans l’un des poèmes les plus explicites et lyriques du recueil la douleur de la séparation, un jour qu’Elsa l’avait quitté alors qu’ils habitaient rue Campagne-Première à Paris : « Ce jour que je t’avais perdue ». Ou ce souvenir d’un tournage qui avait accaparé Elsa et lors duquel le poète s’était senti tenu à l’écart, privé d’elle, dans le premier poème : « Eux veulent te connaître avant moi / Ils me tournent de leurs lumières / Ce n’est pas la première fois qu’on cherche à te prendre ». Ou encore ce basculement dans l’épouvante lorsque le sommeil d’Elsa pourrait être la mort : « Moi je restais les yeux ouverts à tes côtés sans savoir ou non / Si tu dormais déjà je ne sais jamais si déjà tu dors / Je surveille l’oiseau léger qui respire en toi comme un oiseau / Si faiblement parfois que je m’en épouvante ».
Le sommeil d’Elsa pourrait être la mort : « Moi je restais les yeux ouverts à tes côtés sans savoir ou non / Si tu dormais déjà je ne sais jamais si déjà tu dors / Je surveille l’oiseau léger qui respire en toi comme un oiseau / Si faiblement parfois que je m’en épouvante ».
Le recueil est ainsi parcouru de poèmes évoquant la séparation et l’absence, avant même la mort d’Elsa Triolet. C’est que le sentiment amoureux peut à tout moment basculer dans la douleur de la perte. Et que l’angoisse et la douleur de la disparition sont devenues lancinantes pour le poète depuis qu’il la sait condamnée et que, de ce fait, « le temps ne passe plus ».
De chambre en chambre, une transhumance universelle
Quand ce n’est pas le déchirement et l’absence au sein du couple qui sont évoqués, c’est la précarité de la vie et les changements de lieux sous l’Occupation : à Nice, où le couple installé dut plusieurs fois changer de logement. « Il y eut le temps des grottes / […] Nous allions de cambuse en cambuse », écrit ainsi Aragon dans ce très beau poème où l’évocation des lieux se fait précise et rend hommage à ce qui fut – malgré tout – des refuges, au moment où les deux amants étaient pris « dans la charnière / De l’histoire ».
Le parcours de chambre en chambre que propose alors Aragon dans le recueil revêt une portée bien plus grande, et se fait à la fois image et écho de la transhumance universelle par-delà les époques : « Chambres depuis la grotte aux bisons fléchés / Caves nids barques demeures de bois ou de paille / Et les veilleurs épouvantés des fauves à pas bleus / Chambres toujours abris de silence et de pierre / Où brûlent sans regard les parlers ténébreux […] / Toute ma vie aura redit de chambre en chambre / L’histoire à n’en plus finir des tribus ».
La nécessité d’une écriture, entre le murmure et le cri
L’écriture apparaît alors comme un geste à la fois nécessaire et désespéré : « Il y a des gens quelque part qui n’en peuvent plus de silence / Ils font des marques n’importe qu’on sache / Qu’ils passèrent ici D’autres signent un mur ou l’épaule d’une statue / […] Je suis comme vous les uns les autres / J’écris et je lis sans comprendre d’où / Me viennent où vont ces mots formés ».
Mais elle ne peut unifier un passé épars, dispersé : « Toutes les chambres de la vie au bout du compte sont / Des tiroirs renversés Toutes les / Chambres de la vie et celles dont / Je ne dis rien toutes les chambres maintenant / Muettes et pourtant / Murmurantes tous les murs sans mots les fenêtres / Mortes ».
Pour dire ces murmures – ce qu’il reste de ces chambres quand « Tout n’est plus que mémoire / À ce moment d’oubli / Dans la forêt du lit / Tout n’est plus que murmure » – Aragon abandonne les grands flots de la poésie lyrique dans le recueil : « Comme un amant quitté / Au bout de la jetée / Espère et désespère // Et les barques à sec / La grève à marée basse / Et là-bas de mer lasse / Echoués les varechs ». Mais la voix ne s’essouffle ni ne s’éteint peu à peu. Car ces murmures sont aussi éclats de voix brisés, cris étouffés : « Toutes les chambres de ma vie / M’auront étranglé de leurs murs / Ici les murmures s’étouffent / Les cris se cassent ». Et si le poète peut finalement se taire, c’est dans l’espérance enfin apaisée de leur mort envisagée comme ce « lieu de nous où toute chose se dénoue ».






































