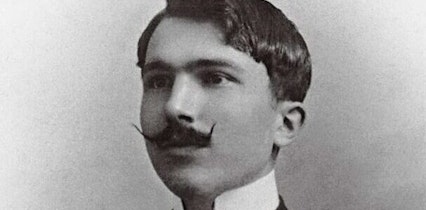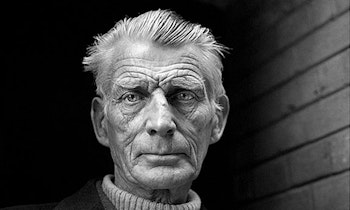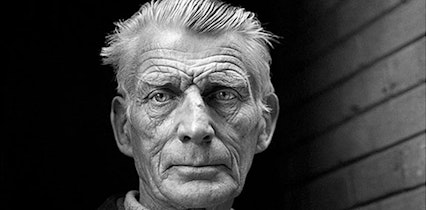Il est comme la panthère : si son pas feutré la rend difficile à observer, il est impossible de l’ignorer. Depuis vingt ans, Rabah Ameur-Zaïmeche impose finement sa patte de cinéaste, parmi les plus originales pour ce qui est de la représentation des cités. Net, percutant, rêveur, il libère car il autorise à s’emparer de la banlieue comme d’un territoire à la fois autre et comme un autre : politiquement quotidien. Avec Le Gang des bois du temple, il livre un polar tintinesque sur la justice des gens ordinaires.

Tendres banlieues
Par ses choix de mise en scène, Rabah Ameur-Zaïmeche est à contre-courant de son précédent film sur les banlieues, le passionnant Wesh, Wesh qu’est-ce qui se passe (2001). La différence entre les deux longs-métrages est à elle seule une preuve de son talent et la preuve que la banlieue, pour être représentée, doit avant tout être regardée comme un lieu et non comme un sujet. Au-delà de ce territoire matériel commun aux deux films, le rapprochement est appelé malicieusement par le réalisateur : ils débutent de façon rigoureusement exacte par un panoramique en hauteur qui balaye de gauche à droite le ciel et de blanches barres d’immeubles.
Ce film qui se déroule dans les cités n’est pas ou si peu, peut-être juste le temps d’un sanglot, un film « de cité ».
Mais dans Le Gang, pas de caméra mobile, pas de cadrages en légère diagonale afin de donner l’impression d’une vie saisie sur le vif par un caméra cachée, pas de rap non plus ; à peine un peu de semi-improvisation ici et là. L’approche ne vise plus à donner l’impression d’un vrai-faux documenteur. Le premier plan donne le ton, car la mise en scène procède selon le rythme calme d’une alternance entre panoramiques horizontaux ou verticaux sur les immeubles immaculés et plans fixes à la sobriété millimétrée permettant à la vie d’advenir en leur creux. La fiction s’impose royalement : ce film sur une cité de Clichy-sous-Bois a été tourné dans la cité du Grand Parc à Bordeaux. C’est en assumant cette fois des procédés opposés à ceux de la télé (cités avec ironie dans Wesh Wesh) que RAZ donne à voir la ville. Car les temps ont changé depuis 2001. Il filme la banlieue comme Demy filme Rochefort (le ravalement des façades en moins) : un pur lieu d’intrigue structuré autour de quelques repères symboliques. Il s’agit d’une réponse claire, nette, cinématographique au déferlement d’images télévisuelles produites sur la banlieue à partir des émeutes de 2005 et récemment subi à la suite de la mort de Nahel. Ce film qui se déroule dans les cités n’est pas ou si peu, peut-être juste le temps d’un sanglot, un film « de cité ».
RAZ et les ferrailleurs
Dans cette cité, les héros en bande habitent chaque plan fixe et font corps autour de Monsieur Pons, souvenir du Ponce Pilate joué par le même acteur dans Histoire de Judas (2015) : le signe que la question de la justice (sociale, politique, individuelle) est le fil rouge du cinéma de RAZ comme elle l’est des westerns de l’âge classique. Celui-là déroule un quotidien sans Indiens et sans shérif. La police est à peine présente, le règlement de comptes se fait directement entre l’implacable pouvoir financier et les héros. Le cheikh mutique, burlesque et glaçant, tout droit sorti de Tintin au pays de l’or noir, incarne à lui seul le poids des clichés du cinéma de genre. Il se transforme en chevalier blanc transi d’énergie le temps d’une scène de danse en boîte de nuit, parmi les plus belles et surprenantes du film. Comme la preuve fragile, gracile et sautillante d’un au-delà des sanctions manichéennes entre bons et méchants, entre film noir, western, film de banlieue et Rohmer’s touch.
Il y a du Sautet chez Rabah Ameur-Zaïmeche, mais un Sautet sans pathos, un Sautet revu par Howard Hawks, un Sautet qui laisse le temps de la joie, de l’espoir et de la liberté individuelle. Au café, Monsieur Pons regarde les courses de chevaux. Un des amis le rejoint, un second, un troisième, puis tous s’agglutinent autour de lui : “Comment ça va, Monsieur Pons ? Vous reprendrez bien un pastis, Monsieur Pons ?”. C’est au point qu’on ne sait comment le cadre fixe les contient tous, eux, leur confiance et leur amitié, dans ce plan anecdotique pour l’intrigue qui est le sommet du film. Le Gang des bois du temple est un vrai film noir en ce que c’est un film de bro’s, et pourtant quelle lumière et quelle générosité : on voit des voleurs nourrir les pigeons, on touche du doigt l’automne et, juste avant de mourir, on mangerait bien des crêpes de Monsieur Pons. Dans cette nouvelle agora sans lois recouverte de probité candide et de lin(ceul) blanc, le calme règne aussi souverainement que l’injustice sociale et les braqueurs s’esclaffent comme des enfants tandis qu’au loin s’en vont leurs rêves et que demeurent les nuages. Les quartiers sensibles n’ont jamais été si bien et si mal nommés.
Le Gang des bois du Temple, un film de Rabah Ameur-Zaïmeche avec Régis Laroche, Philippe Petit, Marie Loustalot, Salim Ameur-Zaïmeche, en salles le 06 septembre 2023.