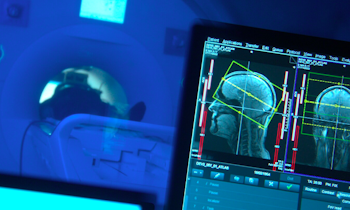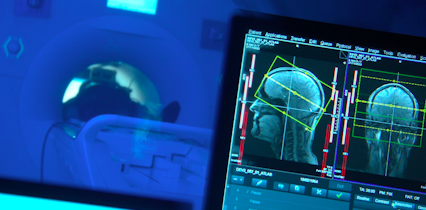Le 4 juillet 1845, Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain, s’isole deux ans et deux mois dans une cabane dans les bois au bord de l’étang Walden, dans le Massachusetts, à quelques miles de sa ville natale, Concord. Walden ou la vie dans les bois est le récit de cette expérience. Publiée pour la première fois en 1854, traduite en plus de 200 langues, cette œuvre est devenue un classique de la littérature américaine. Sa réédition, avec l’essai La Désobéissance civile, en avril 2023 par les Éditions Le Pommier dans la collection Les pionniers de l’écologie, laisse supposer un héritage politique dont nous pourrions nous saisir.
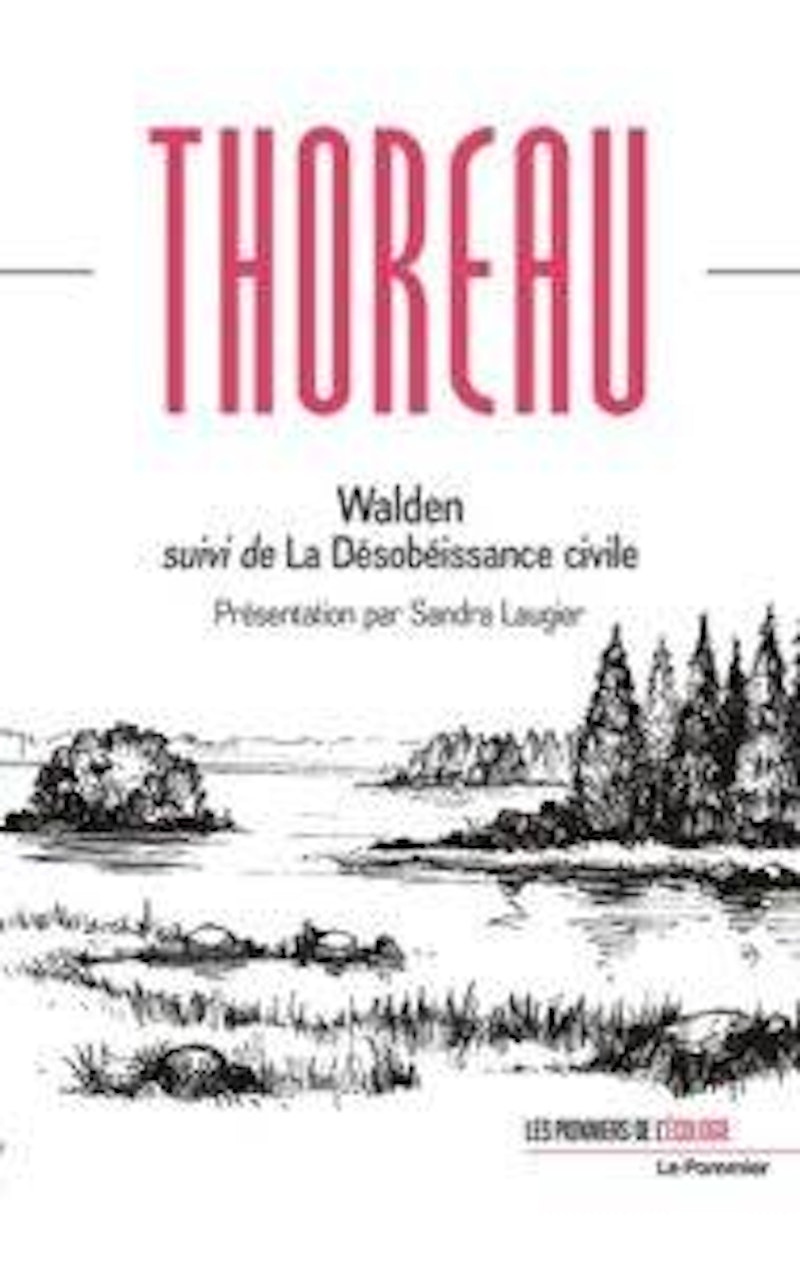
Thoreau se montre dur, méchant même, dans les sentences évoquant la vie menée par ses contemporains dans une société qui s’industrialise, vie de travail aveugle et machinique, dirigée par la possession, l’argent et l’opinion, suintant le conformisme, ne relevant d’aucun sacré. Il décèle dans cette « condition » a quiet desperation : « Comme si l’on pouvait tuer le temps sans insulter à l’éternité. L’existence que mènent généralement les hommes en est une de tranquille désespoir. Ce que l’on appelle résignation n’est autre chose que du désespoir confirmé. » En fuyant, auprès de Walden, ce désespoir silencieux, Thoreau ne rompt pourtant pas avec les hommes, qu’il continue de côtoyer – il reçoit de nombreuses visites, se rend fréquemment au village ou aux fermes alentour. Il leur tend plutôt le miroir inversé d’une existence qui les enchaîne à des choses qui ne sont pas essentielles, et pour lesquelles, pourtant, ils abandonnent leur autonomie et leur liberté.
À rebours du mode de vie matérialiste de ses contemporains, Thoreau vit, dans la cabane en pins qu’il construit de ses propres mains, à proximité du champ de haricots qu’il cultive, une expérience d’indépendance et de sobriété, qui le met aux prises avec la vie même, débarrassée du superflu, enfin nue : « Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n’affronter que les actes essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre ce qu’elle avait à enseigner, non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n’avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n’était pas la vie… » Il prend conscience de ce qui pour vivre est réellement nécessaire : s’abriter, se nourrir, se chauffer. Dans le dépouillement, au contact d’une nature vierge, le philosophe redécouvre sa part sauvage. L’envie subite et étrange de dévorer une marmotte le plonge dans une méditation sur ses instincts, qu’il convient non de fuir, mais de comprendre et d’apprivoiser : « Nous sommes conscients d’un animal en nous, qui se réveille en proportion de ce que notre nature plus élevée sommeille. Il est reptile et sensuel, et sans doute ne se peut complètement bannir ; semblable aux vers qui même en la vie et santé, occupent nos corps. »
Un héritage politique ambigu
L’homme moderne, qui croit se libérer de tâches ingrates en ne construisant plus sa maison, en ne produisant pas sa nourriture, se coupe en fait de l’expérience de la vie, rompt son lien avec le monde et s’aliène. Pourtant, le philosophe ne veut pas faire de sa propre expérience temporaire un modèle auquel se conformer : « Je ne voudrais à aucun prix voir quiconque adopter ma façon de vivre ; car, outre que je peux en avoir trouvé pour moi-même une autre avant qu’il ait pour de bon appris celle-ci, je désire qu’il se puisse être de par le monde autant de gens différents que possible ; mais ce que je voudrais voir , c’est chacun attentif à découvrir et suivre sa propre voie, et non pas à sa place celle de son père ou celle de sa mère, ou celle de son voisin » Thoreau en appelle en effet à la liberté individuelle, à la possibilité pour chacun de suivre l’inclinaison qui est la sienne, sans se conformer aux opinions communes qui rapetissent l’existence. Sa philosophie prend sa source dans une pensée de l’individu, qui doit se comporter vis-à-vis de soi-même comme un sculpteur avec sa statue. Plutôt qu’un modèle collectif, il prône l’autonomie morale.
Difficile donc de faire de Thoreau un penseur pleinement politique, même s’il inspirera quelques grandes figures de résistance comme Gandhi ou Martin Luther King. Comme il l’explique dans La Désobéissance civile, il exprime son aversion envers un état esclavagiste et belliciste par l’abstention et le refus de l’impôt, deux actes personnels. Cet « individualisme » lui fut reproché : Hannah Arendt fustigera par exemple l’idée d’une désobéissance comprise comme un acte individuel plutôt que collectif (On civil desobedience). Or, dans sa préface, Sandra Laugier s’intéresse presque exclusivement à l’héritage politique possible de Walden. Si le retrait temporaire de Thoreau est effectivement en partie dû à un refus de continuer à vivre dans une société viciée – dont la critique reste incroyablement actuelle, Walden n’est pas une œuvre de pensée politique. Sandra Laugier plaque, en mettant en avant un « esprit » commun entre La Désobéissance civile et Walden, une lecture réductrice et quelque peu universitaire, sur un texte extrêmement dense, riche, qui explore de multiples dimensions – y compris esthétiques et spirituelles – de l’existence humaine dans des pages parfois foudroyantes de beauté et de vérité.
Sandra Laugier plaque, en mettant en avant un « esprit » commun entre La Désobéissance civile et Walden, une lecture réductrice et quelque peu universitaire, sur un texte extrêmement dense, riche, qui explore de multiples dimensions – y compris esthétiques et spirituelles – de l’existence humaine dans des pages parfois foudroyantes de beauté et de vérité.
L’exploration de soi
Walden n’établit donc pas un modèle auquel se conformer et ne constitue pas une ode à la vie manuelle ou à la vie sauvage en tant que telle. Celles-ci n’ont de sens que par les perspectives nouvelles qu’elles ouvrent à l’individu. À l’homme d’esprit et de lettres qu’est Thoreau, elles dévoilent de nouveaux chemins de pensée. La vie intellectuelle n’est ainsi jamais rejetée au profit d’une vie plus simple – Thoreau consacre d’ailleurs un chapitre entier à ses lectures des classiques grecs et latins. Le philosophe cherche plutôt à trouver dans la nature et la simplicité un accord entre l’intellect et la vie, loin du triste académisme régnant dans les facultés du pays. Il s’en réfère aux premiers philosophes qui avaient le courage de vivre, et non d’enseigner, la sagesse : « Il y a de nos jours des écoles de philosophie, mais pas de philosophes. Encore est-il admirable de professer pour quoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d’indépendance, de magnanimité, et de confiance. »
Or, la nature est le lieu où peut se ressentir le plus intensément ce mystérieux accord entre la vie et l’esprit. Durant ces deux années et deux mois, Thoreau passe le plus clair de son temps à observer. En naturaliste, il est attentif au rythme des saisons, aux luttes végétales, au gel puis à la fonte du lac, aux allées et venues des animaux. Il est ainsi pleinement écologiste dans le sens premier du mot. Le terme « écologie » – du grec oîkos (« maison ou habitat ») et lógos (« discours ») – désigne aux origines la science des interactions des êtres vivants avec leur milieu. Le penseur devient même un protagoniste à part entière de cet écosystème complexe sur le rythme duquel il se règle, tissant des relations avec ses voisins, les espèces qui peuplent les bois et le lac. La nature pour qui vit en son sein se personnifie. Elle est une présence, Walden un personnage, les hululements des hiboux et des chouettes des états d’âme, les animaux des voisins qui l’arrachent à la solitude : « Encore l’expérience m’a-t-elle appris quelquefois que la société la plus douce et tendre, la plus innocente et encourageante peut se rencontrer dans n’importe quel objet naturel, fût-ce pour le pauvre misanthrope et le plus mélancolique des hommes. Il ne peut être de mélancolie tout à fait noire pour qui vit parmi la Nature et possède encore ses sens. » L’écologie de Thoreau accueille donc l’homme, corps et esprit.
L’imagination du poète est exaltée au contact de la nature, comme celle de l’oiseau qui chante à l’aube. Les pages consacrées à l’arrivée triomphale du Printemps ou à l’aurore en sont des exemples brillants. Dans les bois, l’homme réapprend à voir et à s’émerveiller du spectacle d’une vie dont l’abondance éclate partout jusque dans l’humus que foulent ses pieds « La terre n’est pas un simple fragment d’histoire morte, strate sur strate comme les feuilles d’un livre destiné seulement à l’étude des géologistes et des antiquaires, mais de la poésie vivante comme les feuilles d’un arbre, qui précèdent fleur et fruit – non pas une terre fossile, mais une terre vivante ; comparée à la grande vie centrale de laquelle toute vie animale et végétale n’est que parasitaire. » S’il observe son milieu en naturaliste, Thoreau le décrit ainsi en poète lyrique, qui pressent une correspondance intime entre les rythmes de la vie naturelle et les mouvements de l’âme. C’est en effet notre propre réflexion d’être doué d’une vie souterraine intense que nous renvoie la nature, à l’image du lac où l’on peut se mirer : « Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C’est l’œil de la terre, où le spectateur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature ». L’esprit reprend ainsi vie, retrouve son rythme immanent au contact des éléments. Certaines discussions avec un ami philosophe seront ainsi écrites à la manière de phénomènes naturels : « Nous avancions si doucement et avec tant de révérence, ou ramions de conserve avec tant d’aisance, que les poissons de pensée ne fuyaient pas effarouchés le courant plus que ne craignaient de pêcheur à la ligne sur la rive, mais circulaient noblement, comme les nuages qui flottent dans le ciel du couchant, et les flocons nacrés qui parfois s’y forment et dissolvent. »
Ce que nous perdons
La nature n’est pas pour autant transparente. Si elle est une langue à déchiffrer, elle garde une part de mystère, comme l’âme humaine. Elle retrouve sous la plume de Thoreau la dimension mystique, qu’elle possédait pour nos ancêtres Grecs ou Romains, qui ne touchaient pas aux forêts sans crainte ou qui tenaient l’agriculture pour un art sacré, comprenant que la nature devait être traitée avec respect et délicatesse. Le mystère de cette nature, de cette présence éclatante, qui reste pourtant en partie opaque, nous rapproche d’une pensée de Dieu, à la fois présent et absent, nous rappelant sans cesse à lui et se dérobant à nos regards: « Je ne peux m’approcher plus de Dieu que du Ciel qu’en vivant contre Walden… et sa plus profonde retraite de ma pensée est le faîte. »
En coupant son lien avec la nature, l’homme se coupe donc d’une part de lui-même et du lieu où l’éternité fait peut-être le mieux sentir son empire. « Notre existence au village croupirait sans les forêts et les prairies inexplorées qui l’entourent », écrit-il comme s’il s’adressait déjà à nous qui constatons avec impuissance et stupeur la disparition des milieux naturels sous le règne d’une technique aveugle. Le respect de la nature est donc un devoir politique, éthique, mais aussi spirituel. Thoreau avait pressenti dès la moitié du 19ème siècle, bien avant que nous commencions à nous inquiéter d’un possible réchauffement climatique, les dangers que représentait pour nous l’industrialisation de la société, tout ce qu’elle nous faisait perdre en vie et en possibilités. De nos jours, Waldenou la vie dans les bois ne doit pas se lire comme un essai politique – au sens où il nous présenterait un modèle de société écologique – mais comme une possibilité de fuite – face à la catastrophe d’une vie entièrement artificialisée – au bout de laquelle nous retrouverons, peut-être, un peu de nous-mêmes.
- Walden ou la vie dans les bois, Henry David Thoreau, 1854 [2023], les éditions Le Pommier