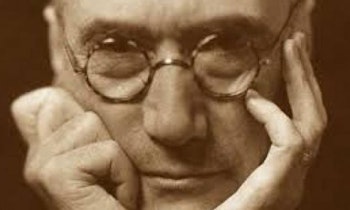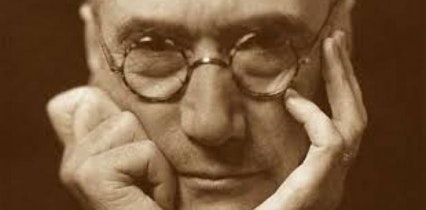Avec son dernier livre, La vie sans appui, le philosophe Marc Goldschmit étudie le retour du religieux à l’aune de sa philosophie marrane. Une investigation singulière, rigoureuse, essentielle, qui passe par trois figures incontournables de la “pensée sans appui” : Nietzsche, Freud, et Walter Benjamin.

David di Nota. Ton livre nous permet d’assister à la naissance d’un nouveau concept : « la vie sans appui ». Comment s’est-il imposé à toi ?
Marc Goldschmit. La première question d’un entretien appelle souvent un certain nombre de remarques préliminaires, sans lesquelles un auteur de « théorie » peut difficilement donner à entendre le cœur palpitant de son travail. Je vais essayer, pour commencer, de me limiter à un minimum de remarques.
Le travail philosophique consiste, quand il a une quelconque importance, en un interminable creusement des textes et de la langue des autres, des auteurs, par l’écriture. Un concept, une surprise peuvent alors surgir, peut-être, à force de frayage et de remémoration par l’écriture. Une telle « méthode » de travail, que je préfère appeler la voie de l’écriture, est aujourd’hui devenue en partie inaudible et clandestine, à cause de l’état de l’université, du journalisme et de l’industrie du livre. Cette voie n’est pas celle du discours porté par un sujet qui performe son identité, mais celle de l’écriture qui s’ouvre aux différences et à la venue de l’Autre ; elle n’est pas celle des choses mais des choses telles qu’elles sont prises, tissées dans des textes.
L’idée de « vie sans appui » s’est imposée à moi, comme tu dis justement, par la lecture d’une constellation de penseurs, Spinoza, Nietzsche, Freud, Benjamin, Derrida, qui ne dessine pas la genèse de mon concept mais plutôt sa généalogie différentielle, sans genos ou gender. Le concept de « vie sans appui » est inséparable de la nécessité pour la philosophie, telle que j’essaie de la pratiquer, d’avancer dans une écriture non du propre ou du soi, mais de la différence intime, de la blessure qu’on appelle l’âme ou l’inconscient. Les penseurs que je viens de citer sont tous, chacun à leur manière, des penseurs de l’inconscient, et hormis Spinoza, qui a interrogé « l’interprétation de l’écriture », ils ont tous exposé leur pensée à la chose littéraire.
J’entends par « vie sans appui » la métaphore (dans un concept) qui donne à penser le vivant comme suspendu au-dessus du vide : vivant sans substance qui le maintiendrait dans le temps sans métamorphoses ni altérations, vivant sans sujet (sans l’unité de la pensée et de l’existence), vivant sans genre unaire et identificatoire, sans Moi objet d’auto-idolâtrie mortifère et morbide, et sans appui religieux sur un Dieu transcendant.
Vivre et mourir sans appui, c’est être vivant gravitant dans la courbure d’un espace-temps fragile et ouvert par la césure de la modernité : celle de la démocratie européenne qui retarde et écarte la vie religieuse, la vie subordonnée à l’autorité théologique. La vie sans appui est une sublime possibilité, un rêve démocratique libéré de la monarchie, de la tyrannie et de la théocratie, de la structure religieuse des empires totalitaires. Cette idée n’est pas une réalité positive, disponible, présente, mais une fiction, un songe qui lie le travail philosophique à un frayage onirocritique.
DdN.Tu donnes un excellent exemple de ce que tu nommes “la pensée sans appui” en relisant les deux textes de Freud que sont « l’Avenir d’une illusion » et le « Malaise dans la civilisation ». En dévoilant l’importance du sadisme et du caractère indéracinable de la cruauté, Freud déconstruit toutes les utopies politiques (à commencer par cette utopie qu’il juge psychanalytiquement naïve : le communisme). Penser la cruauté devient infiniment plus important que de forger une solution religieuse – et le communisme en est une — quitte à rester, comme tu dis, suspendu au-dessus du vide. On sent par-là combien « la vie sans appui » est à la fois un concept, une méthode de lecture, et un programme politique.
MG. Je n’ai quasiment rien à ajouter à ta remarquable question. Freud et Benjamin représentent la modernité née de la modernité de Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, Flaubert et Nietzsche. À la fin du XIXesiècle, cette modernité précédant celle de Freud et Benjamin, a interrompu et césuré, blessé, brisé le programme romantique de l’absolu du sujet dans l’œuvre. C’est pourquoi il faut inscrire l’hypothèse freudienne de l’inconscient et la naissance de la psychanalyse, cet événement extraordinaire qui reste peut-être encore à venir, dans les paradoxes de la modernité postromantique.
« L’Avenir d’une illusion » et « Malaise dans la culture » permettent de comprendre combien Freud, après Nietzsche, aura inventé la psychanalyse comme une lutte interminable contre la religion, il aura cherché à libérer la vie de la religion par la psychanalyse. La méchanceté hypercultivée de Freud à l’égard de la religion travaille au renouvellement des Lumières allemandes par la modernité, renouvellement qui est aussi crépusculaire.
Le texte de 1927, « L’Avenir d’une illusion », analyse la religion dans la perspective de la vie humaine, il affirme que le gain d’une vie soumise à la religion est négligeable : les croyants parviennent à peine à se garder de la souffrance névrotique, et leur « bonheur » se paie d’une régression psychique infantile qui refuse tout compromis avec la réalité, tout travail d’éducation à la réalité. Du point de vue politique, la religion représente le plus grand danger, parce qu’elle s’apparente à une « démence de masse ». Freud compare alors l’antisémitisme du régime communiste à l’inquisition religieuse du Moyen-Âge, il déduit de cette comparaison que les communistes seront emportés dans un mouvement d’extermination hyperbolique « après avoir exterminé leurs bourgeois ».
En 1929-1930, « Malaise dans la culture » s’inscrit dans la perspective de la découverte de la pulsion de mort, après l’extraordinaire spéculation des années vingt intitulée « Au-delà du principe de plaisir ». Le malaise dans la culture ne provient pas seulement de la cruauté indéracinable et inextinguible de la psychè humaine, de l’inhumanité inscrite dans l’âme des vivants humains, mais d’une configuration plus labyrinthique et démoniaque, fatale.
Freud décèle en effet le piège fatal dans lequel sont prises les pulsions érotiques de création artistique ou culturelle. Il se demande comment les pulsions condensées par le nom du dieu Éros, peuvent résister aux pulsions morbides et mortifères (Thanatos) d’agression et de destruction, de déliaison des représentations psychiques inconscientes. Cette question fait surgir dans la culture un malaise inapaisable, parce que la pulsion de mort relève non seulement des mouvements d’inertie psychique commandés par la souveraineté du principe de plaisir (le plaisir psychique provient de la diminution inconsciente de la quantité d’excitation déplaisante provoquée par tout événement, toute rupture, toute perte, toute altérité).
Les pulsions de mort qui conduisent au malaise dans la culture sont des pulsions morbides et mortifères de conservation du Moi. Freud aperçoit le concept de pulsion de mort après le tournant que représente dans sa pensée la découverte de l’investissement narcissique de l’énergie libidinale sur le Moi. Là encore, la fiction d’un mythe, celui de Narcisse, permet à Freud de saisir une « structuration » psychique.
Les pulsions de mort qui conduisent au malaise dans la culture sont des pulsions morbides et mortifères de conservation du Moi.
En un certain sens, même s’il ne faut pas simplifier l’analyse freudienne, le masochisme, le plaisir inconscient pris à la souffrance, est lié au narcissisme et à la pulsion de mort tournée contre soi pour diminuer la quantité d’excitation déplaisante. Le masochisme est peut-être primitif par rapport au sadisme, qui serait une sorte de supplément, de détournement du masochisme sur autrui. La cruauté haineuse, inextinguible, est peut-être en ce sens dérivée des pulsions d’autopunition masochistes et du culte que le vivant humain voue à la culpabilité. Il ne faut alors pas s’étonner qu’aujourd’hui la culpabilité soit redevenue un dieu majeur, que les innombrables procureurs à son service soient hantés par la haine de la psychanalyse qu’ils rêvent de liquider. En un sens freudien, la vie sans appui serait la vie sans cruauté ni culpabilité, la vie qui ne laisserait pas la pulsion de mort se déchaîner comme dans la religion, mais qui retarderait l’arrêt de mort en liant et en détournant la destruction dans la création, dans la pensée et dans l’art.
DdN.Une vie sans culpabilité, dis-tu. Voilà qui nous amène tout droit à Nietzsche. Tu montres combien les écologistes actuels passent complètement à côté de sa pensée écologique. Nos écologistes entendent régenter les conduites en jouant, qui sur la peur, qui sur la faute, ce qui n’est pas le cas de Nietzsche. D’où la question « inactuelles » suivante : que serait une pensée écologique non religieuse ? Une pensée écologique qui ne s’appuierait pas sur la notion d’apocalypse, de salut ou de culpabilité ?
MG. L’idée d’une vie sans appui, sans substance, sans sujet, sans Dieu, libre, suspendue à une fiction (dans le dernier chapitre de mon livre, on découvre que la fiction de la vie sans appui s’avance sur une scène et joue la comédie) ne peut pas ne pas rencontrer la question de la terre et de l’emportement du développement humain qui détruit les conditions de vie sur terre.
À force d’écouter les militants et les partis écologistes, d’observer les mouvements activistes et de lire certains penseurs de l’écologie (Anders, Bourg, Descola, Hache, Jonas, Jouzel, Larrère, Latour, Morizot, Naess, Zask, etc.), des convergences problématiques me sont apparues au-delà de toutes les différences de ces penseurs. Et c’est à ce moment-là que je me suis tourné vers Nietzsche, pour exhumer la possibilité d’une tout autre pensée de la vie et de la terre, une grande « écologie » inactuelle contenue dans la modernité postromantique qui lie sa possibilité et sa liberté à une critique radicale de la religion.
J’ai cru en effet déceler, à tort ou à raison, chez les militants et les penseurs de l’écologie certaines tendances à mes yeux problématiques : des discours néoromantiques qui s’articulent à une nostalgie, à un retour à un certain nostos, au chez soi et au propre constitué par la terre ou par la biosphère (à l’articulation complexe de différentes sphères). Un tel mouvement de réappropriation nostalgique est presque fatal, il est contenu dans le noyau du mot oikos qui donne son nom à l’écologie : la demeure ou la maison.
La teneur romantique ininterrogée des discours écologiques m’inquiète d’autant plus que je m’intéresse depuis longtemps à la manière dont le programme romantique de présentation du sujet, porté à l’absolu dans et par l’œuvre littéraire, s’est trouvé traduit de manière catastrophique dans la religion nationale-esthétique et spirituelle inventée par Wagner, qui a accouché ensuite de la fiction nazie du politique.
L’affirmation antimoderne systématique des écologistes confirme en l’aggravant le diagnostic de néoromantisme. Cette affirmation réduit la modernité à une caricature de Descartes, accusé d’avoir fondé la techno-science dans le cogito, et l’aspiration à « devenir comme maître et possesseur de la nature ». Les penseurs écologistes ne vont alors pas chercher les ressorts d’une nouvelle pensée de la terre et des vivants dans l’analyse des différentes époques de la modernité : dans la révolution galiléo-cartésienne et l’invention de la possibilité de la démocratie moderne par Spinoza, dans les Lumières critiques kantiennes qui démontrent l’impossibilité pour le sujet de se représenter et de se saisir, d’unir sa pensée et son existence, dans la modernité postromantique que j’ai nommée précédemment dans notre entretien, et dans la dernière modernité, celle de Benjamin et Freud, qui naît à l’instant du plus grand danger et pense le crépuscule des anciennes Lumières.
La méconnaissance de la modernité par l’écologie contemporaine, la position antimoderne systématique – analogue à celle de cet immense antimoderne qu’aura été Heidegger – est inséparable de la liquidation du travail de la critique, du paradoxe, et de la césure de l’absolu qui aura constitué la teneur de l’écriture moderne. Le prix à payer d’un tel antimodernisme militant c’est aussi l’amnésie au lieu de la critique radicale de la religion par la modernité.
La méconnaissance de la modernité par l’écologie contemporaine, la position antimoderne systématique […] est inséparable de la liquidation du travail de la critique
On ne sera alors pas étonnés de lire des appels à la communion, des discours téléologiques et apocalyptiques du type « la maison brûle » qui annoncent qu’une vérité absolue va se manifester dans une parousie. Rares sont les penseurs de l’écologie (ne parlons ni des activistes, ni des militants, ni des partis politiques) qui parviennent à ne pas donner à leur discours une tournure morale ordonnée à une culpabilité générale.
C’est cette culpabilité et la dimension religieuse de l’écologie que je cherche à interroger à travers mon détour par le vieux Nietzsche. Il me semble que sa pensée ouvre la possibilité d’une tout autre écologie : inactuelle, fidèle au pas gagné de la modernité qui césure le romantisme et se tient à l’écart de la négation de la vie par la religion, et résistant à la communion autour de la célébration de nouveaux sacrifices. Cette inactualité et cet écart nietzschéens me semblent aujourd’hui nécessaires pour devenir responsable de la terre sans culpabilité, ni morale, ni religion, et pour engager une critique radicale de ce qui détruit la terre et ses vivants: le Capital comme religion et la Religion comme religion.
J’aimerais ajouter qu’il n’est peut-être pas impossible que certaines idées écologistes en apparence innocentes (apprendre à penser au-delà de l’opposition nature/culture, communier dans une religion de la vie sensible, devenir animal) soient travaillées par un mouvement de régression masochiste, c’est-à-dire sadique, et commandées par des motions morbides et mortifères très peu créatrices, mais très complices de ce qui nous a conduits là où nous en sommes.
DdN. J’aimerais revenir, si tu veux bien, sur ton approche riche et complexe du politique. Politique : voilà un mot que tu utilises parfois de façon nettement péjorative – il devient alors synonyme d’enfermement – et, à d’autres endroits, de façon neutre ou positive. Quelle ligne de démarcation tracerais-tu entre ces différents usages ?
MG. Ici ma réponse sera brève et peut-être trop elliptique. Je dirais, pour reprendre encore une fois une formulation de Walter Benjamin, que je ne vois pas de différence essentielle entre l’engagement religieux d’un croyant et l’engagement politique d’un militant, d’un intellectuel ou plus généralement de nombreux citoyens : dans les deux cas, on retrouve le fanatisme, la certitude dans l’opinion, la soumission à l’autorité de dogmes, l’absence d’écart critique aux discours automatisés et reproductibles de l’idéologie. Le travail philosophique au contraire ne commence que par le dissensus, le frayage minoritaire et le paradoxe. Ce travail doit résister à la puissance d’attraction irrésistible de l’idéologie politique, comme à celle de la croyance religieuse, ou il n’est pas un travail philosophique.
Pour cette raison, ce que je tente – écrire une fiction non mythologique et impolitique : l’hypothèse du Marrane – ne relève pas de la philosophie politique, dont la tradition me paraît ressembler souvent aux querelles théologiques de la scolastique. Je cherche par cette hypothèse une pensée de la vie échappant et défiant le tout de la politique et la politique comme tout. L’hypothèse du Marrane n’est ni politique, ni apolitique, ni métapolitique. Elle est impolitique parce qu’elle n’est pas une réalité politique, mais la condition de possibilité inconsciente de la politique.
L’hypothèse du Marrane ne relève pas du « théorème de la sécularisation » que Blumenberg décrypte chez Carl Schmitt, d’après lequel « tous les concepts significatifs de la doctrine moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés » (Théologie politique de 1922, chapitre III). Si le Marrane est la figure forclose de l’inconscient politique, son hypothèse doit rester invisible dans la théorie politique, parce qu’elle est non théorisable et impolitique. La démocratie dans laquelle s’inscrit la figure du Marrane et dont cette figure est l’allégorie, est l’impolitique de la politique : elle échappe au « tout est politique », et césure le trait ou le nœud du théologico-politique.
Dans sa lecture du Contrat social, Althusser met au jour une série d’apories que Rousseau résoudrait par des déplacements de structure, qui l’obligeraient à sortir de la politique et à passer dans la littérature. Tout se passe comme si la politique rousseauiste, telle que la lit Althusser, était contrainte par ses propres apories à se traduire et se métaphoriser en littérature. Je dirais, en partie pour jouer, que la littérature devient dans mon livre, et dans les traces des textes que je traverse et que je soumets à l’anamnèse, la continuation de la politique par d’autres moyens : la continuation de la politique par la césure du discours et par le passage de la théorie politique dans l’écriture.
DdN. “La vie sans appui n’est pas une réalité positive, disais-tu tout à l’heure, mais une fiction”. S’il s’agit d’une fiction, cette fiction permet de saisir le réel avec une acuité inédite. Je pense au magnifique développement que tu consacres à Benjamin à partir de sa description de la vie universitaire. En quoi Benjamin est-il un penseur de la vie sans appui ? Quel parallèle ferais-tu entre ce texte de 1914 et la situation actuelle ?
MG. L’acuité de la fiction, de la feinte littéraire fabriquée, permet de percer, de saisir une teneur. C’est un des traits qui connecte en une constellation les philosophes et les penseurs dont j’ai cité le nom précédemment.
La nécessité de la fiction pour le travail philosophique surgit, par exemple, avec l’hypothèse de « l’état de nature » chez Rousseau, avec la fonction allégorique de la figure du « Surhomme » chez Nietzsche, avec la nécessité de l’hypothèse et de l’hypothétique dans l’analyse et la spéculation freudiennes. Pour cette raison, le dernier chapitre de mon livre trace une figure allégorique et fictive dont j’hérite de Derrida, la figure hypothétique du Marrane.
Pour répondre à ta question je dirais que Walter Benjamin est un « philosophe » extraordinaire de la vie : dans « La Tâche du traducteur » en 1923, préface à sa traduction des Fleurs du mal de Baudelaire en allemand, il pense les œuvres d’art comme des vivants et la traduction comme la survie des œuvres qui précède paradoxalement leur vie et les rend possible. Mais cette survie n’arrive qu’à échouer, elle ne parvient à faire survivre l’œuvre originale que brisée, morcelée.
Dans « Pour une critique de la violence » en 1921, Benjamin cherche à briser ce qu’il appelle depuis 1916, dans les traces de Kafka, « le langage maudit » du droit qui enferme les vivants dans le cercle de la violence conservatrice et de la violence fondatrice. Ce texte de 1921 débouche sur une distinction surréaliste entre la violence grecque, tragique, fondatrice, qui sacrifie les vivants au nom de la vie sacrée, et la violence divine « non sanglante » et « non cruelle », écrit étrangement Benjamin, qui ne sacrifie aucun vivant. Le seul exemple de la violence divine qui libérerait les vivants de la violence du droit est « le pouvoir éducateur ». Cette notation humoristique, qu’aucun interprète ne semble avoir remarquée, éclaire rétrospectivement le texte de 1914 « La Vie des étudiants », sur lequel portent ta question ainsi que le premier de mes deux chapitres consacrés à la pensée de Benjamin.
Dans « Pour une critique de la violence », l’enseignement est déterminé comme « divin » par opposition au langage « maudit » du droit, et par différence avec la confusion « ignoble » des deux types de violences, la fondatrice et la conservatrice. Ce qui est divin, c’est aussi le sauvetage des vivants par le « pouvoir » de l’enseignement (le mot Gewalt, « pouvoir », est aussi traduit par « violence » dans le titre du texte). Mais il s’agit là d’une fiction messianique : les vivants sont sauvés mais seulement en rêve. Ils échappent ainsi, en rêve, au langage maudit du droit et au déluge fasciste fondé sur le sacrifice religieux et la violence tragique qui frappe les vivants comme un destin à travers la peine de mort.
« La Vie des étudiants », écrit en 1914 au début de la Première Guerre mondiale, présente une hypothèse en partie ironique : la vie des étudiants et des professeurs, asservie à l’État et à la religion, est complice de l’affaiblissement du grand et bel Éros. Benjamin montre en effet comment l’Éros majeur dépérit dans le mariage et la prostitution. Le conformisme érotique et sexuel des professeurs et des étudiants se traduit alors par le dépérissement de l’étude, et par la mise à l’écart des étudiants des lieux de production de l’écriture, de la pensée et de l’art.
Dans ce texte et dans celui consacré au Trauerspiel, au jeu baroque du deuil que j’analyse au chapitre suivant de mon livre, Benjamin apparaît comme un penseur de la vie sans appui, qui s’inscrit dans les traces de Kafka lorsqu’il parle du passage de la vie dans l’écriture, du devenir écriture de la vie, et du Messie comme du salut qui n’est accordé aux désespérés qu’en rêve, comme quelque chose qui n’est « pas pour eux ». Dans son dernier texte de 1940 « Sur le concept d’histoire », la vie sans appui est représentée par les oubliés de l’histoire, ceux qui sont ensevelis par le déluge du progrès, effacés de la mémoire et du récit. Ces sans noms ne peuvent revenir comme des spectres – survivre – que dans une écriture de l’histoire, une remémoration messianique, mais sans messianisme : sans récit théologique et téléologique de l’histoire.
L’actualité de ce texte de 1914 tient peut-être à trois schèmes se répétant aujourd’hui dans un écho cauchemardesque :
1/ Benjamin articule le conformisme des professeurs et des étudiants à ce qui arrive à l’écriture. Dans la veine de cet étrange paradoxe, il faudrait montrer comment l’université, aujourd’hui en position de quasi-monopole des collections éditoriales en « sciences humaines », et engagée dans des relations de collusion avec les médias culturels, est devenue un haut lieu du conformisme. Dans ces conditions, elle est un lieu où l’écriture est reconduite à la performance des discours idéologiques, moralisateurs, automatisés et dogmatiques. L’hostilité et l’allergie de l’université française pour les travaux et l’écriture de Derrida, après que Nietzsche a fui l’université allemande, et que Benjamin en a été tenu à l’écart (grâce aux bons soins de Max Horkheimer), cela plaide en faveur de la justesse et de l’actualité du texte de 1914.
2/ La trahison de ce que Benjamin appelle le « grand Éros », prive la pensée et l’écriture de ses forces, et prend aujourd’hui la forme non plus de la complicité du mariage et de la prostitution, mais de la guerre à la séduction et à l’érotisme déclarée par l’alliance du puritanisme religieux et de l’industrie pornographique. Le ressentiment conjugué à la mise en accusation d’Éros et de la différance sexuelle prend la forme d’un immense culte voué au dieu Culpabilité.
3/ Benjamin écrit que les professeurs d’université, au lieu d’avoir l’enseignement pour tâche divine, apprennent aux étudiants à traverser la rue comme eux, en les singeant. Ce conformisme des corps bannit les étudiant des lieux où se rencontrent les créateurs et les écrivains.
Ce texte étrange de Benjamin daté 1914 nous adresse la question générale suivante : la vie des étudiants peut-elle s’émanciper de la servitude et retrouver la dimension « divine » de l’étude, en se remémorant le pas gagné par la modernité, celui de devoir continuellement arracher la vie libre à la vie religieuse sous toutes ses formes, y compris politique ?
DdN. Freud, Nietzsche, Benjamin… trois penseurs d’une exceptionnelle puissance. L’anglophile en moi serait tenté d’ajouter : John Keats. Je me demande dans quelle mesure son extraordinaire approche de ce qu’il nomme “capacité négative” (“negative capability” : soit la capacité de s’en tenir au paradoxe et à l’incertain sans jamais clôturer un texte sur un pseudo-dogme, capacité portée à son point d’incandescence par la littérature) ne constitue pas une première formalisation de la vie sans appui. N’est-ce pas cette “capacité négative” qui porte et traverse ton livre ?
MG. Ma fréquentation de Keats est trop insuffisante pour pouvoir répondre à ta question avec probité. Si les textes de langue anglaise sont rares dans La Vie sans appui, tu pourras par contre en trouver dans un livre plus ancien, La Littérature, l’autre métaphysique, paru en 2020 aux éditions Manucius. Dans le dernier chapitre de ce livre, j’ai analysé la manière dont la figure d’Ulysse (Odusseus) et le mouvement d’une Odyssée qui ne parvient pas à revenir à son origine, sont liés à la teneur de l’écriture littéraire de Conrad (dans Au cœur des ténèbres), et à celle de Joyce (dans Ulysse). Ta question me donne à penser que j’ai sans doute cherché, dans ces deux immenses livres, l’esquisse d’un concept de la vie sans appui, de la vie libérée par la littérature de la métaphysique onto-théologique, celle de la philosophie et de la religion.
En deçà de Joyce et de Conrad, c’est aussi à Shakespeare que je reviens sans cesse, notamment quand je m’intéresse à l’importance du théâtre et au retour baroque de la tragédie. Il me semble que c’est d’ailleurs à Shakespeare que Keats fait référence (dans une lettre de décembre 1817 envoyée à ses frères depuis Hampstead, le quartier de Londres où Freud vivra brièvement cent-trente ans plus tard) comme à celui qui porte à un « degré considérable » la « capacité négative » qu’a l’homme de parvenir « à un fait et à la raison », quand il se trouve « au milieu d’incertitudes, de Mystères, de doute ».
Je dirais qu’à mon sens la vie sans appui est peut-être la vie qui n’est plus capable de nier le négatif, et qui reste suspendue, comme Hamlet le Prince mélancolique du drame baroque, à l’indécision : la vie sensible des spectres et aux spectres, la vie des vivants qui n’acceptent pas d’abandonner les morts sans sépulture et ont pour cette raison vocation à écrire.
Je dirais qu’à mon sens la vie sans appui est peut-être la vie qui n’est plus capable de nier le négatif, et qui reste suspendue.
Si par contre on comprend la « capacité négative » de Keats, non comme je viens de la faire (comme une capacité dialectique de dépasser le négatif de la vie en le niant), mais comme une persévérance ou une endurance de la pensée et de l’existence dans le doute, à la manière de Wilfred Bion (psychiatre et psychanalyste britannique), alors j’inverse ma réponse : il s’agit de la faculté poétique de la vie humaine, de son imagination créatrice au sens de Kant, dont je dirais qu’elle est une nécessité pour la survie de la vie sans appui.
DdN.Dans le dernier chapitre de ton livre, alors que tu commentes la destruction, par Moïse, des Tables de la Loi, nous lisons: “cet épisode signifie notamment que l’écriture est la voie et la condition de la fin de l’idolâtrie. C’est par l’écriture que les Juifs ont un rapport au sans rapport, au Dieu irreprésentable et imprononçable. Abandonnés et sans appui, il leur reste l’écriture comme signe divin, à étudier infiniment”. Ce qui donne lieu à ce commentaire que je crois essentiel : “Le peuple juif ne se réduit pas à la religion juive. Il y a une différence infime et infinie entre un peuple et une communauté religieuse organisée autour des sacrifices consacrés par les prêtres. Il y a en ce sens excès du peuple et de sa multitude différentielle sur l’unité de la communauté reliée par le recueillement religieux. ce qui m’autorise à penser qu’il y a Juifs et juifs, qu’il y a donc une judéité, un être-juif irréductible au judaïsme et à la religion. Cette part du peuple qui reste en excès (…) je l’appelle Marrane”.
MG. Le dernier chapitre de mon livre entre dans une relation paradoxale avec tous les chapitres précédents, il tente de les éclairer de manière différente et étrange : j’ai en effet soutenu que la résistance interminable à la religion constitue le pas gagné de la modernité, de Kant à Freud et Benjamin, et que l’écart entre la vie et la religion arrive dans la dimension de l’écriture comprise comme mouvement de la liberté. Mon dernier chapitre, consacré à ce que j’ai appelé dans un livre de 2014 paru aux éditions du Félin (je salue ici la mémoire de l’admirable fondateur de cette maison d’édition, Bernard Condominas), L’Hypothèse du Marrane, semble alors renverser toutes ces avancées modernes, les rendre méconnaissables.
J’engage dans ce dernier chapitre une réinterprétation des Juifs à partir d’une relecture de leur histoire et de certains passages de Tanakh, la Bible hébraïque : j’essaie de montrer qu’ils forment davantage un peuple qu’une communauté (davantage une multitude plurielle et étoilée qu’une unité), que leur foi est sans croyance et qu’elle est rigoureusement athée pour autant qu’elle prend la forme de l’étude d’un livre. Cette substitution du livre à Dieu est rendue possible par l’idée que Dieu ayant écrit les Tables de la Loi est le premier écrivain. Dieu écrit, et son écriture a été brisée, mise en morceaux par Moïse. Dieu écrit, mais son écriture première, originaire, a été perdue, il ne reste que l’écriture seconde.
L’enseignement (Torah) du Livre est la Loi (Torah) des Juifs, Loi des lois, Loi de la liberté, qui permet de penser qu’il y a chez les Juifs un noyau ou une teneur qui constituera la condition de possibilité, le transcendantal de ce régime politique révolutionnaire : la République. D’autre part, je réinterprète aussi la figure historique des marranes, ces Juifs de la péninsule ibérique obligés de se convertir au christianisme pour échapper à la mort. La « loi de la pureté du sang » a été promulguée en 1492 en Espagne pour discerner les « vieux chrétiens » des Juifs et des musulmans convertis par contrainte au christianisme, elle a été inventée contre les marranes. Cette loi articule l’antijudaïsme chrétien hyperbolique (emporté par un mouvement de dépassement et de fuite en avant) à une conception raciale qui vise les marranes dans la teneur théâtrale de leur vie.
Les marranes ont non seulement été contraints de jouer la comédie du christianisme, mais aussi d’imaginer, de rêver leur judaïsme, loin des synagogues, dans les greniers et les champs. Ils ont en quelque sorte réécrit les rites par « capacité négative ». Les Marranes sans marranisme, ces Juifs exclus du judaïsme, inventeurs d’une hérésie intérieure au judaïsme, deviennent pour moi la figure métaphorique et l’allégorie ironique de la possibilité, en Europe, d’une vie sans appui, d’une vie libre, non sacerdotale et irréligieuse. Je distingue alors l’être juif du judaïsme (de la religion juive), et j’essaie de penser cet être juif comme une dissidence intérieure à travers la figure fictive du Marrane, ce Juif sans substance, sans judaïsme, ni même peut-être sans judéité, qui représente la condition de possibilité allégorique d’une vie démocratique renouvelée, vie aujourd’hui vouée à la clandestinité et au secret, à cause de la nouvelle terreur portée non plus par l’inquisition catholique, mais par l’islamisme et par tous ceux qui se font les complices de cette terreur antisémite et antidémocratique, qui ont intériorisé sa rhétorique, se laissent ventriloquer par elle.
Je pense la fiction du Marrane comme une hypothèse de l’inconscient politique européen, comme le refoulé de la pensée politique, et le transcendantal de la vie démocratique à venir, la Démocratie n’étant pas d’abord un régime politique étatique, mais une vie imaginaire, une vie d’écriture qui affirme la liberté, la multitude, la pluralité, le dissensus, une vie peuplée et divine parce que peuplée. J’essaie de déplacer et de renouveler ainsi le geste philosophique de ce grand marrane portugais, Spinoza, qui aura pensé au milieu des guerres de Religion et de l’inquisition, la séparation nécessaire des autorités religieuses et des autorités politiques. Cette séparation constitue la condition et le principe de l’État démocratique et d’une vie européenne libre, sans peur et sans espoir, une vie qui ne serait plus menacée par l’assassinat religieux, ni par la guerre civile apportée par les religions, ni par la guerre de religion.
L’hypothèse du Marrane est à ce titre une fiction critique qui ne va pas sans une résistance aux penseurs antidémocratiques qui prétendent repolitiser la politique en la rethéologisant et en légitimant une réécriture religieuse de la politique. Je laisse les lecteurs de Zone critique et de notre entretien lire mon livre et son dernier chapitre, pour découvrir comment j’engage une polémique contre l’admirable livre de Jean-Claude Milner, Les Penchants criminels de l’Europe démocratique, dont je montre la fausseté des conclusions et des réponses. Je récuse dans le même geste le livre d’Alain Badiou, Portée du mot juif, qui se présente comme une réponse impardonnable, mais peut-être aujourd’hui majoritaire, au livre de Milner.
- Marc Goldschmit, La Vie sans appui, 2023, éditions Kimé
Entretien réalisé par David di Nota