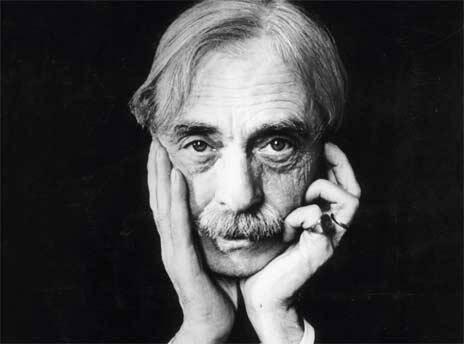Commençons par rappeler l’évidence : Ernst Jünger est un écrivain polémique dont l’œuvre est marquée par un ultranationalisme qui lui a été très souvent reproché. Cependant, trop contemporain pour être déjà oublié, trop fascinant pour être évité, il a joui en France d’une popularité sans égal en Europe. Traduit par Julien Hervier qui lui a consacré une biographie, Henri Plard et Henri Thomas, proche de Heidegger comme de Carl Schmitt, admiré de Gracq ainsi que de Mitterrand, les études à son sujet fleurissent. Jean-Michel Palmier, Bernard Maris, Jean-Luc Évard, Maurice Blanchot ont notamment consacré d’excellents travaux à l’auteur. Contrairement à de nombreux autres écrivains allemands de son époque non moins brillants que lui, Jünger est entré dans la prestigieuse collection de la Bibliothèque de la Pléiade (ce qui n’est pas le cas de Thomas Mann, ni d’Hermann Hesse). Jünger est un fabuleux tremplin qui regarde vers Bloy autant que vers Gracq, vers le romantisme, dont il méprise les applications politiques dans Le Travailleur, autant que vers le roman moderne, dont ses romans à lui, qui se développent en réseau, par circonvolutions et approches multiples, forment un merveilleux exemple. Zone Critique a décidé de dépasser les polémiques pour rendre compte de l’itinéraire intellectuel d’un homme qui divise.
« Sombre assaut contre l’infini ! Un cœur vaillant doit-il avoir honte de s’y être joint ? […] La pensée aime s’attarder le long de cette frontière où le nombre se fond dans le signe, aime tourner autour des deux pôles symboliques de l’infini, l’atome et l’astre, et se plaît à trouver son butin dans le champ de bataille et ses virtualités infinies. » Ernst Jünger, Lettre de Sicile au bonhomme de la Lune
La vie contre la vie

Nulle vie n’est plus pauvre que celle qui n’affronte que la mort, quand l’esprit n’a d’autre antagoniste que le néant de l’esprit.
Dès l’œuf s’institue le combat. « Exister, c’est combattre ce qui me nie » a écrit l’un des jüngeriens français les plus forcenés qui soit. La biologie nous apprend que la nature ne produit naturellement que des femelles ; la naissance d’un mâle demande la présence du gène SRY, produit par la molécule appelée TDF, et une fois ce gène fixé sur l’ADN bicaténaire, il induit une courbure de celui-ci de 70° à 80°. Cette modification génétique entraîne la différenciation du sexe gonadique (développement des canaux de Wolff et dégénérescence de ceux de Müller) . Dans ce combat prend racine toute la structure du monde : « Tout d’abord, qu’est-ce qui distingue l’homme de la femme dans ce modèle minuscule ? Nous trouvons le noyau, la substance rayonnante, aussi bien dans la semence que dans l’œuf. Le plasma, au contraire, qui dans l’œuf se fait foisonnement de tissus immobiles et nourriciers, prend dans le sperme la forme d’un fouet, d’un instrument de mouvement et d’action agressive. Dans le plasma, il nous est permis de reconnaître l’élément terrestre, et surtout l’héritage neptunien dont nous sommes pourvus. Il nous offre l’image de la mer : en tant que matière cosmique dans l’œuf, immobile en globes de cristal, puis dans le sperme, en tant que force cosmique, dont la vague est l’archétype. » (Héliopolis). Naît aussi dans l’origine le questionnement sur l’origine : qu’est-ce qui m’a amené ici ? Am I my brother’s brother ? « Qu’est-ce qui me pousse à m’assurer avec nos moyens de ce qui fut, dès l’origine, objet de foi, sans place pour le doute ? » (ibid.).
Entre ici le père castrateur et son funeste cortège. Dans Eumeswil, sans doute le plus beau roman de Jünger, où jamais l’intrigue ne se noue, le père de Manuelo n’a eu de cesse de comploter contre la naissance de son fils. Pour celui-ci, sa mère était le monde et son père, son holocauste. « Il tenta de réfuter mon existence — tout d’abord en théorie, dès la troisième semaine, alors que j’avais déjà pris la forme d’une mûre et commençais à me différencier subtilement. Je n’étais encore guère plus gros qu’un grain de riz, mais je savais déjà distinguer la droite de la gauche, et un cœur battait à l’intérieur de moi, comme une pointe d’épingle, point tressautant. […] tandis que je flottais dans les eaux amniotiques, j’étais, tel Sindbad le Marin, menacé d’aventures périlleuses. » (Eumeswil, chap. 8). Toute l’œuvre de Jünger est traversée par ce hasard de la naissance, par la possibilité vertigineuse du non-engendrement. Ces enfants non-engendrés nous apparaissent, comme l’esprit de Dorothée, ange gardien du jeune héros des Jeux africains qui vient le visiter une dernière fois[2] dans les dernières lignes du roman, lorsqu’il se couche, de retour au foyer. « Je m’amusais ensuite, à table, avec un bel enfant de trois ans pour lequel je m’étais pris de tendresse. Pensé : c’est l’un de tes enfants non engendrés et qui n’est point venu au monde. » (Premier journal parisien, 27 juin 1941). L’ordre plus haut dont nous mouvons les rouages ne nous est pas nécessairement accessible, comme sous l’empire du géomètre maistrien (« Chacun de ces êtres occupe le centre d’une sphère d’activité, dont le diamètre varie au gré de l’éternel géomètre, qui sait étendre, restreindre, arrêter ou diriger la volonté, sans altérer sa nature. » Considérations sur la France, chap. I), ce que Jünger résume dans sa formule : « nous sommes de passagères combinaisons de l’absolu » (Premier journal, 14 octobre 1942), ou encore « l’homme naît de la plus extrême possibilité » (Second journal parisien, 29 mars 1943).
Toute l’œuvre de Jünger est traversée par ce hasard de la naissance, par la possibilité vertigineuse du non-engendrement.
Le père a comploté contre nous, et l’existence commence non avec l’écriture de notre histoire, qui est cursive, mais par l’étude de sa préhistoire. Où fus-je conçu ? Remontons au-delà de l’expérience sensorielle (nous croiserons le compagnon de voyage de Jünger, Julien Gracq, dont Le Rivage des Syrtes est le versant romantique des romans de science-fiction du corpus de Jünger (Héliopolis, Eumeswil et, dans une moindre mesure, Sur les falaises de marbre)), au moment crucial, à l’heure de la première tristesse.
Manuelo, dans Eumeswil, fut conçu dans le « bureau des cartes à l’Institut d’Histoire ». Sa naissance est à elle seule une représentation du monde. Éjaculé parmi les cartes, jeté entre Terre et Mer, son être est façonné par cette condition, cette prédestination. On se souvient que, dans Le Rivage des Syrtes, le destin de Aldo se scelle lorsqu’il est surpris en train de consulter les cartes du territoire ennemi. Le passage de la frontière, de la ligne maritime (l’amity line définie par Schmitt dans Le Nomos de la Terre, au-delà de laquelle est circonscrit un espace de non-droit, soumis à la conquête et au droit d’occupation), le dépassement de cette limite fait basculer le récit. Les êtres et les nations vivent en-deçà de certaines lignes. Les lignes géographiques (raya ou amity line) sont aussi des lignes spirituelles. « Un Méridien décide de la vérité, ou peu d’années de possession. Les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques. Plaisante justice qu’une rivière ou une montagne borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. » Dépasser la ligne, franchir la limite… en pensée. La pensée moderne peut-elle franchir la ligne du nihilisme, son point zéro, son méridien ? La métaphysique peut-elle être dépassée ? Ou, comme Heidegger le suppose, ne faut-il plus tant penser « le franchissement métaphysique « de » la ligne (trans lineam), mais […] revenir, grâce à l’autre pensée, en-deçà « de » cette même ligne (de linea), de telle sorte que le nihilisme, qui ne saurait être dépassé [comme le supposait Jünger dans son essai Au-delà de la ligne, justement (dédié à Heidegger)], puisqu’il est lui-même le mouvement de dépassement instauré par la métaphysique, soit réinséré dans son propre sol. »[3]
Œdipe en armes

Détaché du père, l’enfant se détache de ses devoirs, à commencer par l’école. L’école de Jünger fut la guerre (Orages d’acier, Feu et sang, Boqueteau 125), « expérience intérieure » comme il l’écrit dans Der Kampf als inneres Erlebnis qu’un traducteur français avisé a rendu par « la guerre, notre mère ». Le jeune héros des Jeux africains fuit également le foyer pour s’enrôler dans la Légion étrangère, et Jünger lui-même, âgé, assénera à l’institution scolaire un dernier coup dans Trois chemins d’écolier (1991), « Précédé des intiales “Sp. R.” que Liselotte Jünger interprète comme une abréviation de “Späte Rache” (tardive vengeance) », comme nous l’apprend l’édition Christian Bourgois.
L’anarque est une évolution de l’anarchiste, une excroissance machiavélienne qui peut se fondre dans le changement et prendre la forme de n’importe quel bouleversement politique.
Jünger est un réfractaire, un « anarchiste conservateur » (selon la formule de Hanz Peter Schwarz). Le rapport à l’école et au père incline son âme vers un tempérament supérieur, ni aristocratique ni révolutionnaire. Ce sont les contours de la figure (Gestalt) trouble de l’anarque qui se dessinent. « Glose sur l’obligation scolaire : l’anarque apprend à lire et à écrire, si et quand c’est son bon plaisir. Bien des enfants y sont entraînés par une curiosité de naissance. Charlemagne était analphabète, et n’en avait pas moins longtemps régné sur son immense empire. » (Eumeswil, chap. 27). En cela, il n’est pas fort éloigné de Ernst von Salomon, son petit-frère littéraire (Les Cadets). Jünger définit l’anarque en partant de l’anarchiste, sur lequel il écrit de sublimes passages, mystiques, toujours dans Eumeswil. Mais l’anarque est une évolution de l’anarchiste, une excroissance machiavélienne qui, un pied dans les arcanes du pouvoir (comme Manuelo, barman et proche du Condor, le chef d’Eumeswil), un pied hors, prêt, comme un caméléon, à se fondre dans le changement et à prendre la forme de n’importe quel bouleversement politique. Le recours face à la menace — recours que l’anarchiste, qui, tel le partisan schmittien se définit par l’intensité de son engagement politique, n’a pas — est la forêt, recours du Rebelle. Le germaniste le moins minutieux aura remarqué la proximité sémantique du Rebelle (Waldgänger) dans le Traité du Rebelle de Jünger et du Partisan (Parteigänger) dans la Théorie du partisan de Carl Schmitt. L’anarque est pragmatique quand l’anarchiste est idéaliste. Les idéalistes de Jünger finissent toujours, par manque de distance par rapport au réel, par succomber, tel le voleur de valise, Dalin, dans Eumeswil, qui finit par exploser avec une valise piégée. Leur comportement indique une différence fondamentale dans la structure de leur être, comparée à celle de l’anarque. L’anarchiste est totalement inapte à la contemplation, ne peut distinguer l’action de cette contemplation, qui est aussi com-préhension. De ce point de vue, Clamor est un jeune anarque : « Une fois encore, la dissociation totale des facultés actives et contemplatives le saisit… le paralysant d’autant plus violemment qu’il importait plus que jamais d’agir, de parler, de se mouvoir. Au contraire, ses perceptions s’affinaient. » (Le Lance-pierres, fin). Clamor devra apprendre à équilibrer ces facultés pour se fondre dans le mouvement de l’Histoire. Grâce au Luminar d’Eumeswil, l’anarque se meut dans l’Histoire comme dans un élément, de l’eau, percevant l’Histoire comme une sensation. Jünger a d’ailleurs mené une analyse linguistique et philosophique très séduisante du rôle des cinq sens dans la construction de l’individu dans Langage et anatomie.
Pro-vocation

Le nihilisme entache la physionomie de celui qui s’y laisse sombrer (on cite souvent la rencontre terrifiante entre Céline et Jünger, le 7 décembre 1941, Céline dont l’écrivain allemand contemple avec effroi le regard assassin (« Il y a, chez lui, ce regard des maniaques, tourné en dedans, qui brille comme au fond d’un trou. »), qui « exprime la monstrueuse puissance du nihilisme ».
« Il y a, chez lui, ce regard des maniaques, tourné en dedans, qui brille comme au fond d’un trou. » Jünger à propos de Céline.
Mais le nihilisme est un véritable engagement, auquel Jünger ne répondra pas par un engagement contraire mais par un désengagement ; c’est le mythe de l’ « exil intérieur », le chemin de l’anarque et le retour aux forêts. Paradoxalement pour un opposant silencieux au nazisme, l’éthique de Jünger s’apparente beaucoup au stoïcisme politique d’Evola, qui déclarait dans son interview à Gianfranco de Turris (« Il Conciliatore », 15 janvier 1970), que « La chose possible et importante est l’action de défense intérieure individuelle, pour laquelle la formule adaptée est : “Fais en sorte que ce sur quoi tu n’as pas prise, ne puisse avoir de prise sur toi.” »
Sur le politique (Schmitt et Jünger)

La vision du politique de Jünger croise celle de Schmitt (et celle de Heidegger, peut-être davantage) mais ne s’y mêle jamais. Leurs comportements face au régime nazi en répondent. Ils partagent, en partisans de la Révolution Conservatrice, une haine du rationalisme et glorifient le mythe comme fondement du politique. Chez Schmitt, de La Théorie politique du mythe (1923) à Ex Captivitate Salus (1947), ce fondement annonce une lente démarche de substantialisation, d’essentialisation et d’existentialisation du critère du politique, à savoir la distinction de l’ami et de l’ennemi ; parallèlement, la conception schmittienne du mythe, en tant qu’accession du Volk à sa conscience historique, s’enracine dans les théoriciens anarchistes ou anarcho-syndicalistes du XIXe siècle (ou du début du XXe), en particulier Sorel et Proudhon, qui l’aide à déconstruire le concept d’humanité comme concept politique (voir notamment La Notion de politique, 1932). Progressivement, le politique chez Schmitt se détache donc de l’État moderne, devenu impuissant à régénérer le politique pour se verser dans une excroissance supérieure de l’État, qui recroise l’évolution politique de Jünger, puisqu’il s’agit de l’État total, forme de politisation totale, intégrale et inévitable de toutes les sphères de la vie. Destruction de la Gesellschaft libérale que Jünger déteste tout autant au profit de l’érection d’une Gemeinschaft, refondation de la loi (Les Trois types de pensée juridique, 1934) sur le modèle hyperanalogique des Lois de Nuremberg et désignation de l’ennemi. Après 1945, le politique se reconstruit dans la théorie géopolitique mondiale de Schmitt, élaborée principalement dans son essai Le Nomos de la Terre, autour du Großraum, ou « Grand Espace », unité culturelle dont l’hémisphère occidental donne un bon exemple. Cette théorie est ordonnée à l’évolution d’un usage de la Terre (nomos) sourdant d’une triple �étymologie (prendre / partager / paître), partant de l’ordre du monde préglobal et de la Respublica Christiana jusqu’à la dissolution du droit public des gens européens dans un nouvel ordre (celui de la SDN et de l’ONU) sans aucune attache spatiale, tellurique, qui réinstitue une guerre discriminatoire au dépend de la guerre juste et mène l’ordre du monde à sa perte.
Jünger est le contraire d’un intellectuel, le contraire d’un militant, laissons-le se retirer dans « la sécurité du silence » sans l’introduire dans les querelles partisanes entre négationnistes et nazificateurs.
Le constat géopolitique qui clôt Le Nomos de la Terre (avec la conquête de l’espace aérien, analysé dans les dernières pages et qui augmente la séparation fondamentale Terre/Mer qui avait structure jusqu’alors le droit international) est partagé par Jünger, à qui Schmitt reprend, avant Nolte puis Arendt, le terme de « guerre civile mondiale », qui résulte de la dissolution du Nomos de la Terre et fait apparaître de nouvelles formes de conflit politique (le partisan). Pour Jünger, dans La Paix (1942), la guerre donne effectivement un sens à la Terre, un « sens nouveau » (I, 3). Mais la guerre elle-même, pour Jünger, a changé de nature : elle est devenue guerre d’anéantissement, d’extermination, permise par des théories abstraites (« Et l’on vit qu’elles étaient l’œuvre de la réflexion froide… », I, 4) et l’avènement de la Technique. Cet avènement a notamment permis les pires crimes de guerre (dérogation au droit international selon Schmitt, le droit international ayant toujours prohibé les crimes de guerre, dès Grotius, qui traite dans Le Droit de la guerre et de la paix, II, I, XII, §4, de la question du viol), c’est-à-dire les camps de concentration, avènement de la Technique pour Heidegger (Beiträge, comiquement traduits par François Fédier par De l’avenance), termes de celle-ci pour Jünger (La Paix, I, 4). L’avènement de la Technique dans l’extermination, dans le crime automatique nihiliste, met toutes les forces vitales au service de son accomplissement, y compris la botanique, science chérie par Jünger qui s’adonnait à la « chasse subtile » (chasse des insectes), comme le découvre Lucius dans Héliopolis.
Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale amplifient la responsabilité de la nouvelle génération, qui verra la mise en place d’une nouvelle Constitution (II, 12) respectant la liberté de chacun dans l’unité de tous (« Uni dans ses membres, le nouvel empire doit respecter les particularités de chacun. »), tempérant l’État autoritaire que Schmitt défendit dans les années 1920. Les dernières pages de La Paix, pour celui qui a été élevé à l’école du réalisme de Machiavel, de la rigueur de Hobbes et de l’amoralisme de Schmitt ainsi que de Freund, sont désarmantes de naïveté : Jünger en appelle à une solution théologique qui attirerait les plus fervents et les plus raisonnables à la fois. Cette religion, regain spirituel, apparaît dès lors comme un katechon nouveau, quiétif du nihilisme et du vide spirituel qui, comme le diagnostiquait Toynbee dans Guerre et civilisation, est à la source du tempérament belliqueux auquel l’Europe a succombé en 1939. Jünger et Schmitt dépassent donc l’État comme ultime unité du politique, mais l’approche de Jünger manque de rigueur politique. Car ce n’est pas, pour Jünger, dans la Constitution, dans la politique que se manifeste la maîtrise par l’homme de son destin. La « vraie politique » dépasse le plan des actions humaines, elle n’est possible que si la poésie lui a préalablement « frayé sa voie » (Héliopolis).
La différence fondamentale entre Jünger et Schmitt est l’accent qu’ils portent sur la liberté
La différence fondamentale entre Jünger et Schmitt est l’accent qu’ils portent sur la liberté. Dans l’État autoritaire cauchemardesque de Héliopolis, le « matériel humain » est fondu dans un « ordre abstrait » dirigé par le « bailli », c’est pourquoi, pour Jünger et son héros, Lucius, l’homme doit rester le maître, maître de l’État qui doit strictement garantir la protection de ses biens et l’appellation d’ « anarchiste conservateur » prend alors tout son sens. Schmitt, lui, n’est ni anarque (son engagement total dans le nazisme le montre) ni anarchiste, à aucun degré. L’étrangeté (la ressemblance) vient du fait que les deux auteurs honnissent l’État libéral et son économisme (fustigée par Jünger dans Le Travailleur, qui paraît la même année que La Notion de politique). Le politique est dissous dans le bien-être et le culte de la santé économique. Pour Jünger, la reconquête de l’humanisme en politique doit coïncider avec son dépassement, chercher la perfection humaine, et non plus se centrer sur la perspective anthropologique. Jünger, toujours oscillant, se rapproche ici de la Lettre sur l’humanisme de Heidegger et sa séparation de l’homme et de l’être humain.
Jünger lutte pour le recentrement autour de l’être humain car la Technique, dans le déploiement de ses ères successives (« L’étagement des trois grandes révolutions de l’âge moderne menait, selon lui, de la religion à la technique en passant par la politique. » Héliopolis), a fini par faire perdre à l’homme cette dimension (celle de l’être humain, du Mensch), dans un grand mouvement d’indifférenciation qui réduit les êtres à des molécules ne se distinguant que par l’intensité de leur mouvement. L’invasion de la raison statisticienne et de l’économisme explique cette déshumanisation que seul l’univers de la science-fiction pouvait rendre tangible. Dans La Paix, Jünger prévoie donc la fin de l’ère du Travailleur et de l’ordre du paysage technique. « Le torrent impétueux s’est creusé le lit où il deviendra paisible. »
Lotharingie spirituelle
« Balthus Klossowski de Rola appartenait à cette petite élite qui, débarquant à Paris, apportait avec elle son cosmopolitisme. On vit dans ses premiers tableaux du fantastique, une étrangeté, une bizarrerie, quand ce n’était jamais que les échos de ses propres origines. Enfant déambulant entre Paris, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie, il était, loin de Paris, l’héritier d’une Lotharingie spirituelle, irriguée par le Danube, le Tibre et le Rhin. »
Jean Clair, « De La Rue à La Chambre. Une mythologie du Passage » in Jean Clair (dir.), Balthus, Flammarion, 2001, pp. 17-19.
Le politique n’a de sens que s’il élève l’homme. Le politique schmittien s’enracine dans une lutte existentiale (l’ennemi est la figure de ma propre question) ; le politique jüngerien y aboutit aussi. L’expérience politique fondamentale atteint son plus haut degré d’intensité dans la guerre, dans l’élan d’une poignée d’hommes sur lesquels plane la possibilitéréelle, dans le vocabulaire schmittien, de leur mort, et qui donnent leur vie pour l’État, avec une dévotion que l’État libéral, faute de mythe, ne saurait attiser.
L’expérience politique fondamentale atteint son plus haut degré d’intensité dans la guerre
La décadence de cet État, qui allégorise l’Europe bourgeoise, si elle a été théorisée par Schmitt, ne fut jamais mieux mise en récit que par Jünger. Sur ce point, le Gracq du Rivage des Syrtes et sa « barbarie vivifiante »[4] lui doivent tout. La parenté romanesque qui lie Jünger à Gracq mériterait d’être creusée à fond. Elle est patente dans Héliopolis[5], lors de la rencontre avec l’Imperator, qui évoque à s’y méprendre la conclusion du Rivage[6], et l’entretien d’Aldo avec Danielo. Tout y est : augmentation soudaine de la luminosité, insistance sur les gestes de l’Imperator, dont le physique rappelle par bribes le passé de sa race dégénérée (Rivage : « La lumière de la lampe effleura obliquement le visage de l’homme qui s’asseyait, y accrocha d’une arête luisante le nez célèbre et impérieux des Danieli, si insolemment reconnaissable que j’en ressentis un choc, comme si j’avais identifié un roi en promenade dans la rue au profil gravé sur les pièces de monnaie. » ; Héliopolis : « Des traces de beauté étaient restées sur son visage, reflet orgueilleux du passé des Titans. »). Gracq et Jünger partagent l’esprit du site, qui réveille dans le lieu (la plage d’Un beau ténébreux, le chemin des haies ou le moulin du Lance-pierres) sa force de suggestion, son être mythique, sa signification, la puissance littéraire dont il est gros.
L’œuvre de Jünger présente, nous espérons l’avoir indiqué, plus qu’un monde littéraire : elle est aussi la mise en récit d’une certaine philosophie conservatrice qui s’échelonne de Schmitt à Heidegger. En tant que romancier, il anticipe le roman moderne, dont ses romans à lui, qui se développent en réseau, par circonvolutions et approches multiples, sans jamais nouer l’intrigue, sans jamais se détacher de la contemplation du récit qui se forme presque indépendamment du romancier qui l’arrête selon son bon plaisir sur une odeur, une couleur ou une vision (le clocher de la cathédrale d’Henri le Lion dans Le Lance-pierres) qui fait inopinément poindre une nouvelle perspective dans le roman, unité narrative organique et tumultueuse, constituent un parfait exemple, incomparablement plus vrai et pur que les jérémiades sociotripotantes de la clique sartrienne.
Jünger philosophe ? Polémologue ? Poète, diariste (Mircea Eliade ne tarit pas d’éloge sur son Journal) ? Étrange Jünger (Sollers dixit), protéiforme. Oui, Jünger est un nouveau Protée, fils de ce géant invincible qui donna son nom à la « guerre Protée » que Jules Monnerot théorisa. On a souvent divisé Jünger en plusieurs périodes (je ne les compte plus ; c’est toujours la même salade que les commentateurs semi déficients ruminent pour Céline (l’homme et l’œuvre) et pour tous les autres géants ayant commis l’erreur de vivre un peu), le Jünger soldat des années 1910, le nazi des années 1930, l’exilé intérieur des années 1940, le réconciliateur franco-allemand des années 1950, le bouffeur de haschich des années 1970 et le vieux chasseur de papillons des années 1980/90. Cette manie de découper les écrivains en rondelles est irritante, tant il va de soi que le jeune homme qui bondit de la tranchée des Orages d’acier ne fait qu’un avec l’auteur de l’État universel, que nous ne suivons qu’une seule destinée, que j’ai essayé de traverser par un seul biais, qui strie son œuvre d’une manière sans l’empêcher, une fois ma plume passée, de reprendre sa mystérieuse forme originelle, irréductible, comme une fraction mathématique.
À suivre : deuxième partie, Ernst Jünger, le guerrier Protée. Exergue de Monnerot : « J’appelle “anciens enjeux” l’acquisition de provinces, de moyens de production, de matières premières, etc. Mais comme on disait autrefois, et cela se comprend encore parfaitement aujourd’hui, l’enjeu de la guerre Protée d’aujourd’hui, c’est l’empire sur les âmes, dans le concret, la politisation intégrale des conduites individuelles, la soumission intellectuelle et morale. Nous pouvons — hélas ! — nous former une idée assez nette de ce que serait une décérébration par les médias, et par des enseignants sociologiquement et politiquement “pervertis”. » (« Le “Nouvel art de vaincre” », Défense, revue de l’union des associations d’auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale, n°45, octobre 1987).
[1] Gilbert Merlio, « Figures de l’homme chez Ernst Jünger », in Ernst Jünger, dossier H, p. 376.
[2] Elle réapparaît à Jünger, ressuscitée de l’enfance, dans le premier volume de son Journal parisien (8 décembre 1941).
[3] Jean-François Mattéi, Heidegger et Hölderlin. Le Quadriparti, Puf, 2001.
[4] Fares Gillon, « La barbarie vivifiante de Julien Gracq », Philitt, n°5.
[5] Le Livre de Poche, 1975, p. 279 sqq.
[6] José Corti, 2014, p. 302.