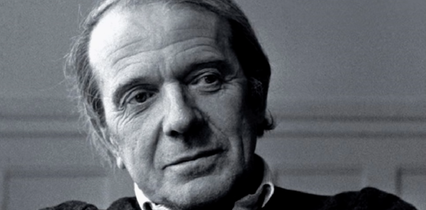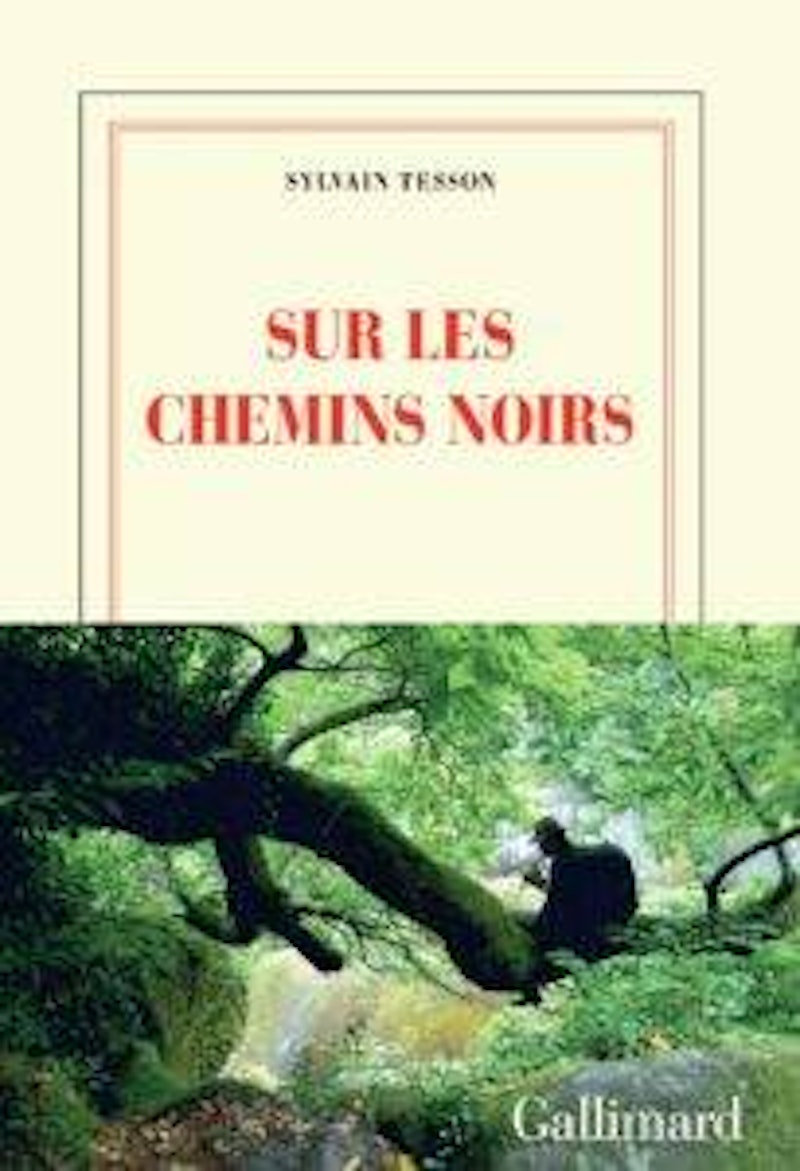
Si Sylvain Tesson ne prétend pas être tombé de la lune, il a les traits altérés du Cyrano de Rostand
Si Sylvain Tesson ne prétend pas être tombé de la lune et si le retrait est dans son cas moins un sacrifice qu’un refuge, il a les traits altérés du Cyrano de Rostand, témoins d’une solitude choisie dans ce qu’elle a de bizarre et de noble, dans ce qu’elle peut avoir de douloureux aussi. Il en va dès lors de l’affrontement avec de Guiche, homme puissant, comme de l’affrontement avec le corps médical, instance influente. Dans ce « ficher le camp » qui apparaît comme une nécessité faite art de vivre se dresse la destinée solitaire de l’écrivain qui se rend imperméable au monde amer et confus dans lequel il évolue.
La maladie du rêve comme genèse de l’œuvre
« Un rêve m’obsédait » écrit Sylvain Tesson. « J’imaginais la naissance d’un mouvement baptisé confrérie des chemins noirs. Non contents de tracer un réseau de traverse, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l’époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l’esquive. » Le rêve est annoncé : « suivez-moi » dit ici l’écrivain. Non seulement il partage avec le lecteur son rêve en en faisant un lieu commun par le langage, mais il invite le lecteur à le rejoindre et lui tend la carte de ce refuge. L’écriture devient le tracé d’une géographie du rêve que l’on parcourt par la lecture. Sylvain Tesson s’inscrit par cette dimension dans le sillage de l’écrivain au « front éclairé » selon l’expression de Victor Hugo dans le recueil Les Rayons et les Ombres (1840) qui a charge d’âmes et mène le lecteur loin des « hommes d’équipage » (Baudelaire, « L’Albatros »), vers « L’Azur ! l’Azur ! l’Azur ! l’Azur ! » (Mallarmé, « L’Azur »).
Un lecteur convié à suivre le chemin noir de l’écriture comme voie de salut
Sylvain Tesson se fait peintre des paysages qu’il rencontre et défenseur de la beauté simple du monde. « Je jetais quelques lignes sur un carnet si le spectacle d’un chêne dans un champ blond m’inspirait un salut affectueux (…). Le soir, je m’endormais et les images de la lanterne magique défilaient derrière mes paupières. Était-ce là une vie réduite ? Oui. Mais réduite à sa plus simple expression. La plus belle, peut-être. Le défi était de faire durer cette douce tension. » De même que l’écriture, le rêve est un mouvement et les deux s’associent ici dans l’image du « chemin noir » dont Sylvain Tesson fait de la réalité fantomatique une idée de l’esquive. On retrouve là une tension philosophique entre le monde de la nature et le monde idéal, dans un chassé-croisé où le tracé réel du chemin noir géographique évoque en fait une géographie oubliée, comme une réalité fantasmagorique, et où au contraire le rêve évoqué par l’écrivain (celui de la fondation d’une confrérie des chemins noirs qui s’attacherait à ne rien avoir en commun avec la société) vient du fantasme vers la réalité par le langage et par le tracé noir que constitue l’écriture, qui devient dès lors carte du rêve. Le rêve est élevé à l’éternité par l’écriture qui le fait émerger de la pensée pour le faire advenir sur le papier.
Le tracé du chemin noir se superpose à une géographie oubliée et l’écriture constitue une passerelle entre le réel et le rêve.
« J’imaginais la naissance d’un mouvement baptisé confrérie des chemins noirs » écrit Sylvain Tesson. On trouve ici l’évocation de la naissance, du baptême, et d’une zone d’ombre qui deviendrait voie de salut. En somme, l’écriture de la solitude apparaît ici dans la dimension spirituelle d’une résurrection, du moins d’une épiphanie. « Entre moi et le monde, écrit l’écrivain, il n’y avait que quelques rafales, des herbes échevelées, l’ombre d’une bête. Et pas d’écran ! Aucune information, pas d’amertume, pas de colère. Ma stratégie du retrait distillait sa jouvence dans mes fibres ». L’écrivain propose une renaissance associée au cycle lent de la nature, dont le passage est en soi une élévation, contrairement à la spontanéité néfaste de l’information, de l’amertume et de la colère : bref, de la société. Cette renaissance tient à quelques « menus impératifs » que Sylvain Tesson résume ainsi : « Il ne s’agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l’outrecuidance de le changer. Non ! Il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. L’évitement me paraissait le mariage de la force avec l’élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. » Les mots sur la page blanche sont comme les notes sur la partition : fuir le monde devient sous la baguette de l’écrivain une musique constituée de mouvement(s).
La musicalité du style
Il semble que la singularité de Sylvain Tesson réside dans la grande musicalité de son écriture. Les mots constituent un voile dont il faudrait lisser le pli et le repli pour porter dans la mélodie et la cadence du texte la transparence d’une âme libérée de mouvements parasites. « Panta rhei » déclare Héraclite : tout coule, tout est mouvement. S’extraire du mouvement suppose donc déjà de s’ancrer et de l’ordonner pour lui donner une consistance, celle dans le texte du rythme ternaire qu’on trouve dans ce tétramètre interne, alexandrin scandé en quatre pieds : « Orchestrer le repli me semblait une urgence ». L’écrivain joint le geste à la parole et donne par cet alexandrin tout le programme qui est le sien et qu’il expose dans Sur les chemins noirs. Ce programme, le voici : il s’agirait « En somme, [de] se détourner. », « Mieux encore ! », précise l’écrivain : « [de] Disparaître. Dissimule ta vie » disait Epicure dans une de ses maximes (…). Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. ». L’écrivain se pose en solitaire et apparaît ici comme celui qui « souille le contrat social » écrit Sylvain Tesson, et qui préfère aux soubresauts de l’actualité le spectacle de la vie dans sa manifestation essentielle. En somme, l’écrivain incarné par Sylvain Tesson est ce rêveur un peu fou qui choisit de se « nourrir de sa propre substance » pour paraphraser Rousseau dans les « Rêveries ».
Alors, que vaut vraiment Sylvain Tesson ?
L’écriture de Sylvain Tesson se nourrit de la contemplation de la beauté et rejette l’amertume d’un monde de la performance technique
En définitive, l’écriture de Sylvain Tesson dans Sur les chemins noirs retrace l’itinéraire même d’un auteur à qui la place dans le champ de la littérature française semble acquise par la musicalité d’une écriture refuge, attachée à montrer la beauté d’une nature sauvage et authentique oubliée. L’écriture est une épiphanie qui se nourrit de la contemplation de la beauté et qui rejette l’amertume d’un monde de la performance technique. Il s’agit, pour citer Dans les forêts de Sibérie de « s’asseoir devant la fenêtre le thé à la main, laisser infuser les heures, offrir au paysage de décliner ses nuances, ne plus penser à rien et soudain saisir l’idée qui passe, la jeter sur le carnet de notes ». C’est une vision de l’écriture assez romantique que propose Sylvain Tesson, mue par l’appel d’un ailleurs recréé par le langage. « C’étaient mes chemins noirs. Ils ouvraient sur l’échappée, ils étaient oubliés, le silence y régnait, on n’y croisait personne et parfois la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques uns à préférer disparaître dans la géographie. » p33-34 NRF