Trois quarts de peine de Camille Paule est un recueil de poèmes au récit éclaté, une série de moments suspendus qui se lisent comme autant de respirations étouffées. L’œuvre, par sa structure morcelée, saisit le lecteur et le retient dans des fragments de quotidien marqués par une tension sourde et une violence en sourdine, celles causées par le deuil et les souvenirs venus se coucher sur la page. Paule explore ainsi les limites de la communication humaine, de l’expression de soi au sein d’un environnement hospitalier où la parole devient aussi dure que précieuse.
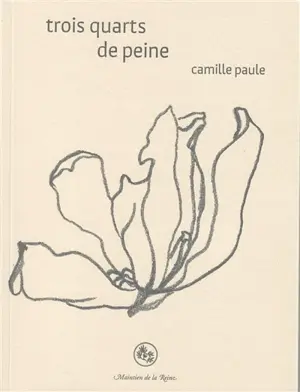
La poétesse insuffle aux scènes décrites une étrangeté qui révèle l’inconfort des routines aliénantes qu’elles soient domestiques, médicales ou liées à l’enfermement — en dissociant gestes familiers comme le sifflement d’une cafetière, la fermeture d’un bureau ou le passage au portique, de leur vide émotionnel, révélant par la fragmentation et la répétition l’absurdité oppressante de ces rituels. Dans « En septembre je récupère le courrier dans l’escalier de service, je mets le coin de l’enveloppe rose à la bouche exprès », l’enveloppe, féminine et rose, devient l’instrument d’un échange muet et subversif. « La cafetière siffle, hier j’ai laissé les SMS en vu » nous plonge dans la monotonie des jours, où chaque silence choisi signale une érosion intérieure. Les « vases vides » et « fleurs fanées dans l’évier » incarnent une rupture lente et amère avec la vitalité. « Hier j’ai fermé le bureau, j’ai pas lavé les tasses » suggère un détachement de ces rituels, une négligence teintée d’épuisement. Les réminiscences, comme « 17:45, tu prends mon sac quand je descends du car », mettent en contraste un passé de petites attentions avec un présent dégradé. Par de tels détails anodins mais évocateurs, Paule démarre cette œuvre en tissant une trame de désenchantement et de résistance, où l’abandon et l’ancrage émotionnel se confondent. Répétition, fatigue et lutte pour la communication émergent ainsi derrière son rapport complexe au passé et au présent, mondes en collision face au quotidien et à la vie intérieure perturbés.
Deuil, souffrance et retrait du monde
La solitude se manifeste d’abord dans l’expression du deuil : « maman dit que je ne suis pas obligée d’assister à la fermeture du cercueil » pour garder une « belle image » de sa grand-mère, de son grand-père, de sa tante, « elle », « lui » et « toi ». Ce premier contact avec la perte porte en germe une tempête et le recueil permet de rendre par le langage la réalité de cette douleur : elle « crie fort » alors que cela n’émeut « personne », « suffoque », « se laisse glisser contre le mur et le sol », jusqu’à trouver un apaisement dans la chute. Ce glissement, la voix poétique le traduit en une simple, poignante affirmation : « je déborde ». Mais comment figurer aux autres ce débordement, cette saturation intime, comme leur dire l’impossible d’un corps qui déborde ?
La routine, les gestes automatiques, les anxiolytiques se substituent alors à la voix poétique, marquant un contraste déchirant entre la maîtrise apparente et l’ouragan intérieur, entre l’indifférence des autres et l’intensité d’un ressenti en suspens : « on apprend à être bibliothèque, pas plus ».
Une cellule à soi : survivre à la solitude
Dans Trois quarts de peine, la poétesse déploie une vision troublante de l’hôpital psychiatrique, que l’on se sent emprisonné dans une métaphore carcérale, tissée avec soin du titre au moindre fragment du texte. Elle interroge sans relâche l’ambiguïté de cet espace : une enclave où le désir de solitude se cogne sans cesse aux parois d’une surveillance omniprésente. Cette imbrication de la métaphore carcérale au sein de l’hôpital psychiatrique invite à une réflexion poignante sur la tension entre intimité et contrôle, où la liberté individuelle s’effrite lentement sous la contrainte d’un regard permanent, imposant une étrange proximité entre le corps confiné et la solitude impossible. Les poèmes alors deviennent une peinture implacable d’un univers où l’enfermement psychologique se mue en routine mécanique, presque clinique. Les mentions de l’heure – « 9:15 : allo surveillant », « 10:30, parloir deuxième tour » – scandent un quotidien morcelé, rythmé par les appels, les surveillances, et les actions répétées, tout en soulignant la rigidité d’un espace institutionnel tenu au secret. Cette vie réduite à des « bips sourds » et des « briefings » crée une ambiance oppressante, qu...

















