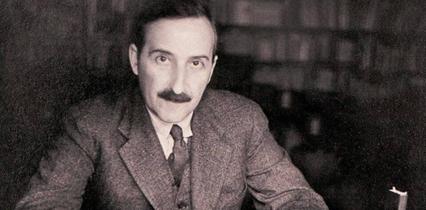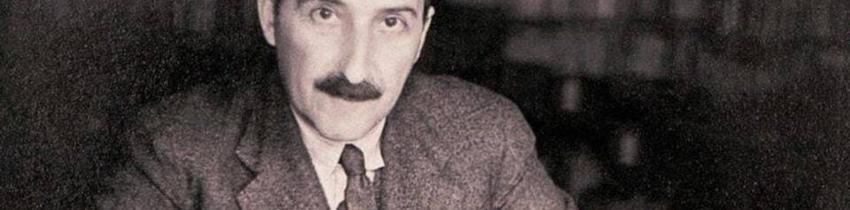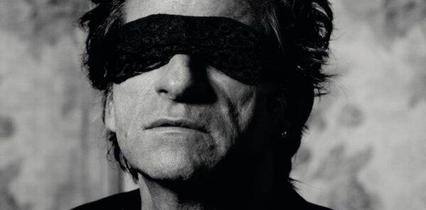Qui n’a pas déjà songé à la littérature comme à un déversoir — ou un réservoir — des blessures enfouies, ces cicatrices que l’écriture rend soudain visibles sur la page ? Décharge, de Séverine, s’impose comme le manifeste poétique d’une entreprise de réappropriation de soi, traversant la réalité des symptômes post-traumatiques qui reviennent à la charge, qui chargent la mémoire, qui déchargent enfin le silence.
Dans cette traversée, le texte ne panse ni ne colmate : il pense, puis fracture pour faire advenir. Parallèlement, la prose, saturée de poésie, éclat et écluse, éclate et retient tout à la fois — digue fêlée d’où jaillit la mémoire en crue.
Comment Décharge fabrique-t-il une parole capable de reprendre le corps à celleux qui l’ont confisqué ?
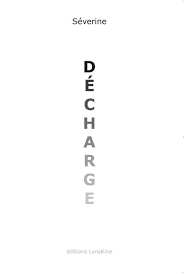
Politique des noms/nons : effacement des patronymes et dévoilement des actes
Nommer, quand le silence a tout englouti, devient un acte condamnatoire : dans cette écriture des noms et des nons, les patronymes s’effacent, les masques se brisent, et ne subsistent que les actes — crus et sonores dans leur insoutenable clarté.
Ceux du père incestueux et de la mère abusive, complices dans leur monstruosité.
La monstruosité parentale s’exprime surtout par la perversion des rôles protecteurs. L’ironie tragique est un outil dont Séverine use pour dénoncer ces inversions. Par exemple, le père est constamment désigné par sa fonction médicale puisqu’il est le « papa-médecin », l’« obstétricien », le « docteur » pour ainsi dire, ce qui rend son comportement d’autant plus terrifiant.
Lorsqu’il examine sa fille de treize ans et proclame : « Tu as un utérus rétroversé ! », la scène bascule dans l’absurde grinçant : le ton enjoué de ce diagnostic latin, en apparence anodin, cache un viol incestueux. On frissonne devant le cynisme du personnage, capable de légitimer son crime par un jargon médical et d’en faire une anecdote presque comique.
Notons que la mère accueille la nouvelle « d’un air enjoué », comme si la situation était normale.
Ainsi, Décharge renverse l’ordre symbolique : là où le langage paternel servait à masquer la prédation, la parole poétique le dénude et le condamne — restituant à la victime le pouvoir de nommer et donc de juger.
L’infanticide organisé : la banalisation du mal parental
Cette banalisation du mal, révélée par l’ironie, contribue à peindre un tableau d’inhumanité absolue : les parents apparaissent dénués d’affect, comparables à des monstres froids. Séverine les condamne d’ailleurs en ces termes :
« La prestance immortelle des bourreaux […] intouchée. Ils continuent à chercher à te tuer. »
Le mot bourreaux inscrit les parents dans une lignée de tortionnaires historiques, et l’idée qu’ils cherchent à la tuer n’est pas qu’une image : il y a dans le texte l’idée récurrente d’un infanticide latent, tant physique que psychique, comme en témoigne la formule « infanticide organisé » utilisée pour qualifier l’ensemble de son enfance.
Ce syntagme, oxymorique (comment un infanticide pourrait-il être organisé et laisser l’enfant en vie ?), est chargé de sens : chaque acte violent tuait un peu l’enfant en elle, tout en la laissant respirer — supplice prolongé, pire que la mort.
En exposant cette mécanique d’inhumanité, Séverine dévoile une horreur sans sursaut : celle d’une cruauté méthodique devenue ordinaire.
Dans Décharge, le mal se manifeste justement dans la répétition glaciale d’a...