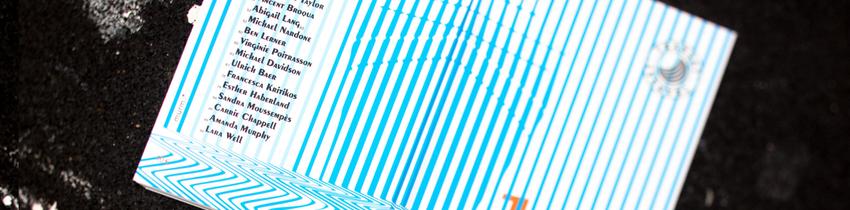Ce texte ne se veut pas un jugement du dernier ouvrage de Bégaudeau Comme une mule (Stock 2024). J’en laisse le soin à des lecteurs plus avisés que moi et sans doute plus intéressés par son œuvre. Je me contenterai de relever ici une petite erreur, une facilité peut-être, et de m’interroger brièvement à partir de celle-ci sur le crédit que l’on peut donner au reste de ses thèses.
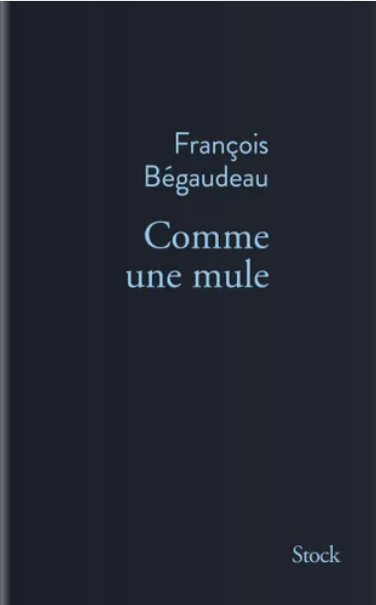
Je connais guère Bégaudeau. Il m’indiffère assez. Mon préjugé est peu favorable. J’avoue néanmoins éprouver une certaine ambivalence. Il est loin de m’être tout à fait détestable. Il me reste par exemple en mémoire une soirée fort chaleureuse. Elle avait été organisée par Zone critique. L’auteur de Notre joie était venu répondre aux questions de Sébastien Reynaud. C’était à la Maison de la médiation, rue de la Chine, près de Gambetta. On a quand même fini au bar. Il m’avait donné, de loin, le sentiment d’être d’une grande éloquence. Et en même temps avec quelque chose de trop brillant pour être honnête. Car, hélas, je me méfie des gens intelligents. Il y a dans leurs phrases tant de bruits et de lumières. Les pensées courent dans tous les sens comme des enfants criards lors d’une immense fête foraine. Je songeais donc, ce soir, là, en quittant cette première et unique rencontre, à ces propos de Barbey d’Aurevilly au sujet de Rivarol :
« Il avait en lui deux génies fraternels : le génie de la conversation, qui a besoin des autres pour exister, et le génie littéraire, qui n’a besoin que d’étude et de solitude pour chercher son idéal et pour le trouver.
Or, comme toujours, ce fut ce qui valait le moins qui tua ce qui valait le plus en lui. Caïn a tué toujours Abel. D’écrivain éternel qu’il aurait pu être, il devint cette charmante, mais éphémère chose, un causeur, dans une société de la corruption la plus raffinée. Il fut cette flamme qui s’éteint lorsque la vie a quitté nos lèvres. »
— Jean-Marie Jeanton Lamarche pour un Portrait de Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, L’Harmattan, 2000.
D’un auteur l’autre
Les mois, suivants, qu’il m’excuse cette faute, j’ai oublié de songer à Bégaudeau. La vie était là avec ses obligations, mon travail, l’ennui. J’ai des livres que j’essaie de faire publier. Mon podcast littéraire, « Je tiens absolument à cette virgule », qui me prend du temps. Et puis je m’imagine toujours la mort un peu partout. Alors Bégaudeau était redevenu un nom flottant dans ma mémoire, sans importance particulière. Jusqu’à ce qu’un ami cher cite son dernier ouvrage, Comme une mule. Voilà qu’il le loue. Il exhorte à le découvrir. Tire par la manche les badauds. Quel penseur exceptionnel ! assure-t-il. Quelle prestance ! Nous tutoyons les cimes ! Le Christ est revenu parmi nous et il publie des essais. Mon ami en révèle quelques bonnes feuilles sur Facebook, comme on vend le poisson à la criée. Je lis donc distraitement les passages de notre nouvelle Bible. Bon, pourquoi pas. Il ferait un merveilleux éditorialiste. Il faudrait glisser son nom à Hanouna. Mais soudain, quelques lignes me réveillent :
« Dans Le Style réactionnaire, Vincent Berthelier rapporte que Maurras définit le “style de décadence“ comme “celui où l’unité du livre se décompose pour laisser place à l’indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser place à l’indépendance de la phrase, et la phrase pour laisser place à l’indépendance du mot“. “Style anarchique“ aurait convenu aussi dans l’esprit de Maurras, c’est tout un, puisque le désordre de l’anarchie fait d’écho à la société.
Dans la société, cet ensemble organique et homogène où, chacun est prié d’occuper la place qu’on lui désigne, le militant autoritaire Maurras, ne veut pas d’électrons libres. Dans les livres, l’écrivain autoritaire Maurras ne veut pas de phrases indépendantes, de mots émancipés. Chaque élément du texte sera attaché à un tout nommé œuvre sur laquelle l’auteur a autorité comme un père sur sa fille, un berger sur son troupeau. Surtout qu’aucun mot ne s’égare dans des sentiers imbattus et ne se régale seul de baies cueillies sans frais entre ses dents. »
— Comme une mule, François Bégaudeau, p. 350-351.
Ah, d’abord, cela mérite d’être souligné, quel immense courage faut-il de nos jours pour s’attaquer à Maurras ! On trouvera sans doute une armée entière pour le défendre ! Et non seulement pour le défendre, mais pour rétablir les faits, seulement les faits. Car comme l’a relevé aussi Maxime DesGranges, la citation attribuée à Maurras sur la décadence n’est pas de l’auteur de L’Avenir de l’intelligence mais de Paul Bourget, lequel écrit :
« L’organisme social n’échappe pas à cette loi, et il entre en décadence aussitôt que la vie individuelle s’est exagérée sous l’influence du bien-être acquis et de l’hérédité. Cette même loi gouverne le développement et la décadence de cet autre organisme qui est le langage. Un style de décadence est celui où l’unité du livre se décompose pour laisser la place à l’indépendance de la page, où la page se décompose, pour laisser la place à l’indépendance de la phrase, et la phrase pour laisser la place à l’indépendance du mot. »
— Paul Bourget, Essais psychologie contemporaine.
Paul Bourget qu’on peut lui-même rapprocher de Nietzsche, lequel affirmait :
« Je ne m’arrête cette fois qu’à la question du style. À quoi reconnaît-on toute décadence littéraire ? À ce dont la vie n’anime plus le tout. Le mot devient souverain et ressort dans la phrase. La phrase l’emporte sur la page et en obscurcit le sens, la page devient vivante aux dépens du tout, le tout n’est plus un tout. C’est là une définition pour tout style de décadence : toutes les fois, anarchie des atomes, désagrégation de la volonté. Liberté de l’individu, pour parler moralement, pour en faire une théorie politique. »
— Le cas Wagner, Nietzsche.
Je précise que tout cela est vérifiable sur internet en quelques clics. Plus embarrassant encore pour notre sémillant baudet, cette citation de Bourget est en revanche correctement sourcée dans l’ouvrage de Berthelier, que cite Bégaudeau :
« Clarté de la pensée, unité de la forme et du fond (au profit du second), subordination de l’écriture à la conception d’ensemble : c’est là l’essentiel de l’esthétique classique de Maurras. Celle-ci doit aussi beaucoup à Paul Bourget qui, dans les Essais de psychologie contemporaine (1885) a proposé une définition du style décadent. »
— Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, Vincent Berthelier.
Begaudeau, tout frétillant de la plume, après une mauvaise lecture de Berthelier, croit donc critiquer Maurras, en lui attribuant une citation Paul Bourget, pour une pensée que l’on trouve aussi chez Nietzsche. Autant dire que, contrairement à Baudelaire, Bégaudeau ne semble pas tenir absolument à ses virgules, du moins pas à celles des autres.
À vieille mule, frein doré
Détail que cette anicroche dans un ouvrage de 450 pages, clameront certains. Broutilles ! Vous chipotez, monsieur ! Certes, certes. Admettons que je sois mauvais et que cela se réduise à une malheureuse bagatelle perdue dans un fleuve d’or et de diamants. Je ne prétends d’ailleurs pas juger l’édifice entier sur cette seule erreur, encore moins l’œuvre de Bégaudeau dans son ensemble. Néanmoins, une question, si vous permettez : si Bégaudeau se trompe, non par un raisonnement que l’on peut toujours discuter ou étudier, mais se trompe de la manière la plus basse qui soit, dans les faits, parce qu’il se plaît à attaquer un auteur à partir d’une citation de seconde main, piochée dans un ouvrage qu’il n’a pas même été capable de lire correctement, si Bégaudeau se trompe avec tant de légèreté à ce sujet, dès lors quel crédit accorder à l’ensemble de son texte sur des thèses qu’on ne maîtrise peut-être pas ? Ce n’est pas l’erreur en elle-même qui est grave, c’est ce qu’elle révèle de l’éthique et des principes de l’auteur. Car certes, la superficialité n’est pas le mensonge même, mais c’est déjà le mensonge qui vous salue d’un signe de la tête.
Enfin, tant pis, et allons encore plus loin. Jouons le jeu. Prenons Bégaudeau au sérieux, un instant. Considérons qu’attribuer les propos d’un auteur à un autre n’est pas bien grave, au fond, puisque, n’est-ce pas, tous ces réactionnaires ne forment qu’une unique et méprisable engeance. Qu’importe les citations pourvu qu’on ait l’ivresse. Oui, affirmons que seule la thèse doit être examinée. Cessons de passer dessus légèrement sous prétexte que Bégaudeau n’est qu’un habile rhéteur, un phraseur de fin de soirée, qu’on ne lit que pour le plaisir de penser sans réellement penser et de mieux goûter ainsi, telle une aimable brise vespérale courant de phrase en phrase, cette impression de pensées qui est son grand style. Étudions cela comme si nous tenions, entre nos frêles mains, le véritable livre d’un véritable écrivain.
Ce n’est pas l’erreur en elle-même qui est grave, c’est ce qu’elle révèle de l’éthique et des principes de l’auteur.
Que soutient notre intellectuel dans ce court extrait ? D’abord qu’il lui plaît de « décréter la littérature anarchiste ». Très bien. Hourra ! Et ensuite que :
« Carburant à la seule humeur réactionnaire, la littérature de Dostoïevski, Balzac, Flaubert ne serait pas allée loin. Deux généralités, trois aphorismes, quatre piques bien senties contre la racaille progressiste et on aurait fait le tour ».
Alors, j’ignore comment se caractérise une « humeur réactionnaire » (on devine qu’elle ne doit pas tout à fait ressembler, dans l’esprit de Bégaudeau, à un samedi de fête), ni pourquoi elle ne pourrait aller loin, mais comme nous sommes rentrés avec son livre dans une sorte d’immense camp naturiste de l’esprit où les idées se succèdent déshabillées de toute définition ou articulation logique, au point où nous en sommes, ne nous attardons pas sur ces menus détails.
Non, allons au fond du sujet. Car mises de côté ces infimes frictions notionnelles, le propos de Bégaudeau, c’est son indéniable qualité, peut se résumer aisément : l’anarchisme de la littérature excéderait l’intentionnalité politique des auteurs, ici réactionnaires, ce qui sauverait les œuvres de ces derniers. Il prend pour exemple le style de Dostoïevski dont il commente prestement les traductions, sans doute grâce à ses connaissances approfondies de la langue russe, n’en doutons pas un instant, qui doivent au moins égaler ses talents pour la citation de seconde main.
Est-ce tout ? Oui. Était-ce la peine de convoquer Maurras de travers pour de telles platitudes ? Nullement. Mais puisqu’il est là, retenons un instant encore le théoricien du nationalisme intégral.
Le romantisme politique, le vrai sujet raté de Begaudeau ?
Si Maurras s’inscrit dans le sillage de Paul Bourget, son propos peut-il se réduire à l’expression caricaturale qu’en livre Bégaudeau ? Je ne suis point un immense lecteur de Maurras. Je ne le connais que de loin. Assez tout de même pour me garder d’appeler à sa réhabilitation politique. Cependant, dans les limites de ma maigre science, je souhaiterais, par exemple, examiner ce passage, qui fait écho aux discours de Bourget et qui annonce le surréalisme pour déjà mieux le réfuter :
« L’office littéraire de Victor Hugo peut se résumer en fort peu de lignes. Héritier de Chateaubriand, il a procédé à l’affranchissement de la phrase et surtout du mot. En demandant qu’on abolisse toute tradition ; en écrivant que le caprice du moindre poète (vates) doit l’emporter toujours sur le génie des langues et sur l’ordre des styles ; en substituant à l’idée de la beauté l’idée de caractère, à la notion de perfection celle d’originalité, Victor Hugo n’est pas seulement arrivé à se priver de certains concours magnifiques que le passé d’une nation et l’histoire de la civilisation elle-même apportent à leurs derniers-nés ; il ne s’est pas seulement contraint à beaucoup renier de ses prédécesseurs et à mimer l’œuvre brutale des ignorants et des primitifs : son malheur est plus grand. Il dresse contre lui et contre tout poète égaré par sa théorie et par son exemple, une armée d’ennemis profonds et redoutables. Victor Hugo, par son esthétique, suscite contre l’écrivain français la coalition de tous les éléments du langage : ce qui n’était qu’une matière obéissante ou tout au moins domptée, ou qu’on était convenu d’avoir à dompter, les mots déliés de leurs attaches traditionnelles, de leurs chaînes logiques, et ainsi des rapports qu’ils soutiennent avec leurs sens, les mots se soulèvent pour s’imposer à l’imagination de l’écrivain. Ce n’est plus lui qui écrit sous la dictée de sa conception ou de son amour : c’est la tourbe confuse des outils révoltés qui se combine en lui par le jeu machinal, de leur rencontre physique et de leur agglutination spontanée. Sa volonté de fer, au lieu de les réduire, appuiera ces insurrections. »
— Lorsqu’Hugo eut les cent ans, Maurras, novembre 1901.
La question soulevée dans cet extrait n’est pas celle de l’intentionnalité de l’écrivain par rapport à un sujet, même politique. Il n’y est pas davantage défendu l’idée d’une « œuvre, sur laquelle l’auteur a autorité comme un père sur sa fille », pour reprendre la formulation de Bégaudeau. Ce serait plutôt un contre-sens de la présenter sous ces termes. Au contraire, le propos de Maurras peut se résumer ainsi : la langue, loin d’être un objet inerte, accueillant mollement la subjectivité de l’écrivain, est une force vivante, appartenant à la mémoire et à la vie collective d’un peuple et qui a ses principes propres. À travers la figure de Victor Hugo, Maurras combat donc l’exaltation du génie singulier promu par le romantisme, qui dresse contre elle le « génie des langues », c’est-à-dire, dans ce contexte, leur essence. Aller contre une langue par caprice, sans la considérer comme une force vivante dont l’écrivain est d’abord le serviteur, c’est, de générations en générations, s’aliéner les mots, lesquels « déliés de leurs attaches traditionnelles, de leurs chaînes logiques, et ainsi des rapports qu’ils soutiennent avec leurs sens, se soulèvent pour s’imposer à l’imagination de l’écrivain ».
Comment ne pas reconnaître dans ces lignes des notions utiles pour mieux saisir une crise du langage, tout à fait contemporaine, qui excède notre littérature.
De là, l’auteur moderne, progressiste, hériter du romantisme, qui cherche à imprimer au langage sa pure subjectivité, auteur dès lors réellement autoritaire sous couvert d’anarchisme, devient en fait l’expression de forces désarticulées, qui se jouent en lui par des rapprochements hasardeux. Il est pensé bien plus qu’il ne pense et son livre s’écrit suivant le simple mouvement de mots coupés de leurs racines et aussitôt asséchés de toute nuance. Comment ne pas reconnaître dans ces lignes des notions utiles pour mieux saisir une crise du langage, tout à fait contemporaine, qui excède notre littérature, quand, accompagnant l’exacerbation de tous les particularismes, les néologismes militants se succèdent avec un grand flou, selon les passions du moment, et que la langue ne cesse de s’atomiser en de multiples jargons, dans des tournures syntaxiques de plus en plus approximatives ? Comment ne pas y reconnaitre aussi, ironiquement, une critique par avance de la prose mal bâtie d’un Bégaudeau ? Peut-être même qu’un homme comme lui, cloué au pilori par certains de ses compagnons de route, pourrait tirer intellectuellement profit d’une lecture plus attentive de cette charge contre le Romantisme. Car n’en déplaise à notre insurgé des belles-lettres, que nous sommes loin, chez Maurras, du brouet maigre qu’il nous inflige, lorsqu’il s’emmêle les pinceaux avec les citations des uns et des autres pour n’en rien dire ! Et certes, on peut tout à fait réfuter l’argumentation de Maurras, ou la discuter. Là n’est pas la question. Mais encore faut-il en être à la hauteur.
- François Bégaudeau, Comme une mule, Stock, 2024.