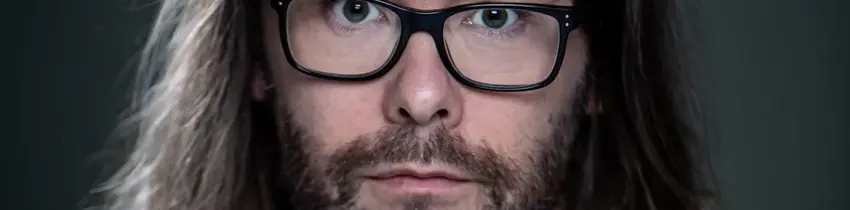Ce printemps, la Cinémathèque Française a choisi de mettre à l’honneur Gus Van Sant. L’exposition rend compte à la fois des films de ce cinéaste anticonformiste, mais aussi de ses œuvres plastiques. Une rétrospective à la fois dense et intense.

Il s’agit bien de cinéma, mais pas seulement. La Cinémathèque française rend hommage à tout l’ensemble de l’œuvre de Gus Van Sant qui comprend photographies, dessins, musique. Ses productions personnelles rencontrent celles de sa collection, et se tisse alors autour de notre déambulation une constellation d’artistes. Le cinéma est là, partout. On le retrouve dans le classement alphabétique des acteurs pris en photo par le polaroïd de Gus Van Sant. On le retrouve, plus discret, dans l’écho des tableaux. Il s’impose à nous dans la succession de story-boards mêlant dessins et polaroïds. C’est le cinéma qui guide nos pas et irrigue les 500 m² d’exposition.
L’artiste, fidèle à sa formation aux arts-plastiques dès ses 14 ans, ne réduit pas son art à un unique et restrictif médium. Il manipule et transforme différents médiums comme autant de matières plastiques malléables de la mémoire. Et, à travers cette démarche, il élargit le champ du cinéma. Il ne se réclame pas seulement de cinéastes comme Béla Tarr, Wong Kar-Wai, Chantal Akerman ou Bernardo Bertolucci (cinéastes projetés à la Cinémathèque dans le cadre de sa carte blanche), il inscrit sa pratique dans les pas d’écrivains, musiciens, plasticiens…
Les polaroïds tapissent quatre murs qui se font face. Ils ne répondent à aucun projet artistique intentionnel. Leur rôle, à l’époque, était de capturer l’image des acteurs des castings pour les visualiser pleinement et tester des combinaisons pour un film. Alors, nous fouillons les photos, chapelets de visages et de corps – certains embarrassés, d’autres cherchant vainement à se donner une contenance, d’autres encore posant fièrement – guettant le moindre trait connu. À chaque présence familière, un film de Gus Van Sant apparaît dans le sillon de nos souvenirs. Drew Barrymore, Keanu Reeves, Matt Damon, Nicole Kidman, Minnie Driver… Sourires, regards, expressions qui nous happent. Ces acteurs, dans leur jeunesse, hantent les couloirs de la Cinémathèque. Gus Van Sant a su saisir l’instant, et charrier avec lui, la permanence de ces physiques, sur lesquels pourtant, le temps a laissé la trace de son passage.
Expérimentations artistiques et filmiques
Elles n’ont rien d’un trophée fétichiste ces photos. Ce qui frappe c’est leur fragilité, et à travers elle, la fragilité des acteurs (ce petit éclat d’âme qui leur échappe). Si le but de ces images est de combler les failles de la mémoire, cependant elles n’ont rien d’éternel. Le polaroïd est par essence un médium fragile. Si la plupart des photos sont intactes et semblent esquiver les effets du temps, d’autres sont en voie d’effacement. Les lignes contrastées des visages s’usent dans les angles et disparaissent sous des halos de lumière excessive. Les polaroïds matérialisent malgré eux la disparition de ces corps, dévorés par le temps.
Parmi les expérimentations artistiques, on en compte une, clairement dans la continuité de la pratique littéraire de la Beat Generation, qui annonce le processus du montage filmique : le cut-up. Au lieu de textes tranchés puis assemblés, comme le faisait William S. Burroughs, ce sont les photographies que Gus Van Sant découpe puis réunit. On découvre des collaborations avec William S. Burroughs : expérience performative « The hipster be-bop junkie », écrit et interprété par l’écrivain, composé musicalement par Gus Van Sant ; les autres sont des expériences cinématographiques où Gus Van Sant y adapte et dirige l’écrivain. Le lien avec la Beat Generation se concrétise également à travers la réalisation d’un film-poème qui met en scène Allen Ginsberg déclamant « The Ballad of the Skeletons ». Les premiers liens avec le courant artistique remontent à une rencontre en 1977 avec Walt Curtis dont un récit est la base du premier long métrage de Gus Van Sant : Mala Noche.
Cette exposition ne se perçoit pas dans le montage mais dans le plan-séquence ; les yeux se baladent sans discontinuer, happés par ici, interpellés par-là,
Gus Van Sant a travaillé pour la publicité et réalisé des clips sur commande qui résonnent avec ce travail d’expérimentation esthétique. Travailler pour les studios répond autrement plus durement à des contraintes économique et donc, artistiques. Le cinéaste ne va pas hésiter à rendre hommage à un film mythique tout en remettant en question le système économique des studios. Il se verra en effet proposer de réaliser un remake sur la base d’un catalogue. Il choisit Psychose d’Hitchcock et effectue le même montage dont les scènes se distinguent par d’imperceptibles détails. Gus Van Sant, à travers ce travail, révèle l’impossibilité de réaliser une copie identique et critique le désir des studios de conserver la « recette » d’un film avec des stars interchangeables en fonction des époques.
Mais il ne faut pas oublier que le cinéaste a réalisé des films avec de nombreux plans-séquences (dont il est d’ailleurs le monteur) : Gerry, Elephant, Last days. Cette exposition ne se perçoit pas dans le montage mais dans le plan-séquence ; les yeux se baladent sans discontinuer, happés par ici, interpellés par-là, tandis que les pas suivent la ligne courbée de l’espace muséal où chaque visiteur forme son parcours singulier entremêlé parfois à celui des autres, comme l’illustre le schéma du déplacement des personnages d’Elephant dont les trajectoires sont matérialisées par des lignes de couleurs, dessin qui invite au rêve.
- Gus Van Sant, exposition et films à la Cinémathèque française du 13 avril au 31 juillet 2016