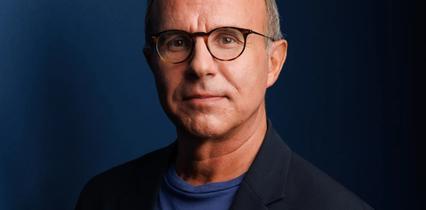On sait à quel point Murakami a percé. Pressenti pour le prix Nobel depuis plusieurs années, adapté au cinéma (Drive my car, La Ballade de l’Impossible), il fait partie des auteurs incontournables estampillés «phénomène éditorial ». L’encart rouge aux formules dithyrambiques souvent accolé aux couvertures des best-sellers signale, à propos de son nouveau roman, La Cité aux murs incertains : « Une atmosphère inoubliable », « La sensation d’être à la maison, depuis toujours » ; ou encore « Une magie splendide ». Et c’est vrai. Beaucoup de jeunes lecteurs situent, je pense, comme moi, leurs premiers émois dans les événements oniriques qui affleurent sur fond d’univers parallèle à la lecture de 1Q84 et Kafka sur le rivage, ses best-sellers. Mais les années ont passé. Et s’il y a magie, c’est qu’il y a magicien ; et que nous, on ne veut plus tomber dans le panneau : celui du « réalisme magique ». Quelle est alors la formule de Murakami, son petit secret d’écriture ?
Murakami, dans Portrait de l’auteur en coureur de fond, se fait un peu plus décevant. Il dit qu’il n’y a pas de secret pour l’écriture de romans si ce n’est la banalité de quelques habitudes, la lecture, le travail, une alimentation saine, et le jogging. S’il ne s’en fait pas gloire, il le répète avec assez d’insistance pour que ce ne soit pas une coquetterie : c’est l’homme le plus normal, et le plus conformiste du monde et il fait du jogging. Ce qui ne nous avance pas beaucoup. Mais quand même de quelques enjambées, si l’on fait un crochet par un autre sportif : Hemingway.
Celui-ci est souvent mentionné comme une influence majeure. Qu’est-ce que Murakami tire d’Hemingway ? L’exigence de rythme, la virilité d’un silence ? Le jazz ? Le sport ? L’émasculation ? Qu’on n’en doute point ! Mais tout cela irrigue souterrainement. Retenons seulement qu’Hemingway est boxeur et que Murakami est joggeur, c’est-à-dire que ce dernier travaille l’endurance. Pratique qui demande peut-être plus de régularité que l’intensité d’un match de boxe, c’est-à-dire aussi plus de relâchement des tendons et des nerfs. Le jogging est un travail de respiration : une respiration qu’on saurait retrouver, imperceptiblement, dans ses phrases ; un travail de relâchement, enfin, car dans la sérénité de son écriture, on sent aussi un effort de vide.
La rêverie comme remède à l’aliénation
Or, peu d’écrivains s’attachent à la fatigue, à l’effort et au vide, comme Murakami (ou comme Hemingway). Rien ne semble plus loin en effet, de la littérature que ce qui harasse le corps, empêche et frustre le cerveau et nous dérobe à « l’expérience intérieure ». Cela dit, la fatigue exprimée, le côté « lessivé » de sa phrase (comme si elle en ressortait propre, douceâtre et lisse) n’est ni une affaire de sport, ni de blanchisserie, et encore moins a fortiori de style. Elle nous parle, je crois, plus platement, du monde dans lequel on vit, qui est le monde pénible du travail. Telle est, selon moi, la perspective de Murakami, par-delà le côté « onirique » : la pénibilité du monde qu’il décrit, et de ses personnages. L’humilité face à cela. Qu’ils viennent des marges de la société ou de ses hyper-centres tokoïtes (cf. Le Passage de la nuit), de l’île de Shikoku, des montagnes du Hokkaïdo ou de la banlieue cossue de Tokyo ou d’Osaka, les personnages de Murakami sont ou paraissent, quelle que soit leur classe sociale, toujours au ban de leur société.Et s’ils sont à l’instar du profil récurrent du jeune narrateur un peu autiste, promis à cette lassitude nerveuse, ce n’est pas parce que c’est eux, mais le monde qui est aliéné.
Les personnages de Murakami sont ou paraissent, quelle que soit leur classe sociale, toujours au ban de leur société.
Si Murakami nous « parle tant », c’est bien qu’il a un petit truc en plus. Mais il ne s’agit peut-être pas seulement de la fatigue contemporaine. Que ce soit dans le registre de la ballade rétrospective, comme La Ballade de l’Impossible, ou dans celui du voyage, comme dans Kafka sur le rivage, il s’agit de panser, je crois, un mal-être plus profond ; quelque chose comme un mal du siècle. La formule peut paraître bien vague, mais un silence est gardé, dans chaque roman sur les origines du mal des personnages. Ce silence n’est pas un voile de pudeur, ou une coquetterie. C’est un lieu de l’âme où le suicide, le trauma du deuil, de la disparition affleurent sans se verbaliser. Et si la phrase, comme une très légère fièvre, allège et soulage ce mal indicible, elle ne permet pas de le guérir, ou de le sauver par une quelconque rédemption stylistique. Force est de constater pourtant que les romans de Murakami opèrent quelque chose de cette plaie insituable. Comment ? En l’ouvrant dedans, le temps d’un voyage initiatique. C’est un trick banal et un peu éculé, issu des contes. Mais qui marche. Car il suffit d’ouvrir cette plaie béante comme un lac ou une forêt intérieure et de partir à la découverte de ces lieux en tant qu’ils sont le reflet d’une réalité invisible, ou symbolique. Ça peut être une...