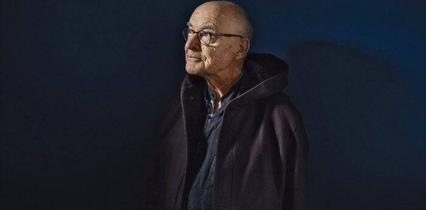Laura Chomet, professeure de Lettres Modernes et Philosophie, nous livre avec La pulpe et le jus (Gallimard, 2025), un premier roman à l’humour corrosif mêlant hypocondrie, agrumes et télé-réalité. Un Truman Show revisité qui flirte avec le développement personnel et la paranoïa.

Estelle Normand : Dans La pulpe et le jus, vous racontez l’histoire de Jenna, une jeune femme hypocondriaque et dévoreuse d’agrumes, qui se passionne pour un programme de télé-réalité, Les Nouveaux Guérisseurs. Mais ce programme est d’un genre très particulier puisqu’il est réalisé à l’insu du candidat, avec la complicité de son entourage, pour le guérir de ses phobies. Comment vous est venue cette idée de télé-réalité poussée à l’extrême ? N’est-ce pas en contradiction avec notre société actuelle très vigilante au respect du consentement ?
Laura Chomet : L’émission Les Nouveaux Guérisseurs offre la guérison all inclusive à une hypocondriaque. Un traitement sur mesure. C’est en imaginant ce que la protagoniste pouvait désirer que l’idée m’est venue.
Si les participants aux Nouveaux Guérisseurs ne sont pas prévenus au moment du tirage au sort, au départ, ils sont quand même libres de candidater et dès lors, s’engagent à se plier aux règles du jeu en connaissance de cause. C’est le cas de Jenna. Alors, évidemment, les méthodes employées sont discutables. Mais quand on est empêtré dans un état de détresse mentale, morale, ou affective, le désir de s’en remettre à de prétendus experts apparaît extrêmement séduisant et salvateur.
Je crois qu’on peut facilement accepter de s’aliéner, même dans une société très regardante sur la question du consentement. Ne le fait-on mille fois par jour en recourant à des technologies – dont l’écrasante majorité des utilisateurs ignore le fonctionnement – pour résoudre nos problèmes et prendre des décisions à notre place ?
E. N. : Vous soulignez à plusieurs reprises avec humour l’ambivalence, pour ne pas dire la schizophrénie, de notre société post-covid ultra hygiéniste et pourtant extrêmement polluée, notamment par les microplastiques (dans l’air, dans l’eau, dans la nourriture), est-ce une source d’angoisse pour vous ?
L. C. : Oui, c’est effrayant : si on y pense, on devient paranoïaque et si on n’y pense pas, on est dix fois plus exposé. La question alimentaire évoquée dans le roman incarne cette difficulté à vivre sainement. On nous conseille de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, de ne pas manger trop tout court ; mais suivre ces recommandations à la lettre n’empêche pas de s’intoxiquer au cadmium ou d’ingurgiter des résidus de matières fécales en se désaltérant à l’eau minérale. On peut consommer bio, faire du sport, éviter l’alcool, utiliser un purificateur d’air et une crème de jour excellemment notée sur Yuka, mais se retrouver diagnostiqué d’un cancer du pancréas à la veille de ses 40 ans.
E. N. : Votre premier roman traite également du désir de contrôle, du corps et de l’esprit. L’épigraphe donne tout de suite le ton puisque vous citez Epictète: «Tu souffres ? Trouve l’endurance», mais aussi le présentateur de la télé-réalité qui n’a de cesse de répéter : «Vous êtes le remède». Est-ce que vous avez souhaité dénoncer les dérives des médecines alternatives qui donnent l’illusion aux gens de pouvoir contrôler leurs maux, quitte à les mettre en danger ?
L. C. : Dénoncer, non car je n’ai pas les connaissances suffisantes là-dessus, mais questionner peut-être. Soigner un cancer par une cure de blettes ou un ulcère en analysant ses vies antérieures peut laisser perplexe. Je dis cela mais, si le discours est bien rodé, je ne serais peut-être pas la dernière à y souscrire. Plus sérieusement, avec le développement personnel très en vogue ces dernières décennies, il est vrai qu’on nourrit la croyance qu’il est possible de reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre corps et au fond, pourquoi pas ? Je pense que c’est un message plutôt positif et stimulant, plus encourageant que les thèses déterministes par exemple, mais de là à se croire entièrement responsable de son destin, n’est-ce pas illusoire et source de culpabilité ?
E. N. : On peut qualifier notre époque de société du divertissement, vous le montrez bien d’ailleurs en mettant en scène la maladie et la mort dans un contexte de télé-réalité. Selon vous, le divertissement est-il sans limite ?
L. C. : J’aurais tendance à penser que, comme dans le domaine des nouvelles technologies, tout ce qui peut être fait en matière de divertissement sera fait, peu importe les implications. Avant l’arrivée de Loft Story par exemple, personne n’admettait qu’il oserait regarder une émission aussi amorale. Aujourd’hui, qui peut prétendre ne pas avoir cédé à la tentation ? On s’...