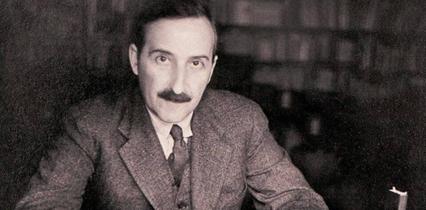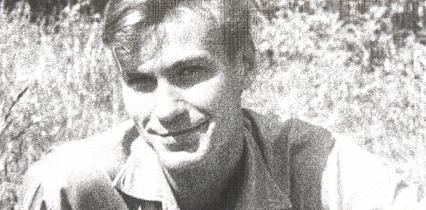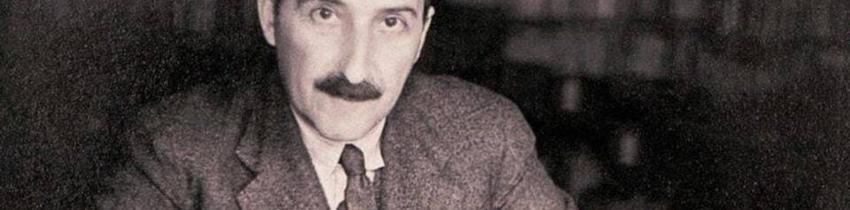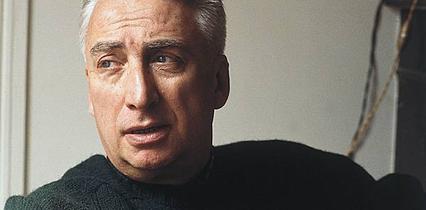Comment écrire l’indicible ? Comment l’écriture peut-elle contenir en elle la multiplication des violences qui s’acharnent sur le corps, sur celui des femmes ? Mes pieds nus frappent le sol de Laure Martin, largement autobiographique, est un ouvrage d’utilité publique, pas uniquement en tant qu’il est l’incarnation d’un récit de violence, mais également car il met la lumière sur la réalité de la mémoire traumatique, de la dépossession du corps et de la survie après elles. L’inceste, l’autodestruction, l’effondrement psychique, la maternité réduite à un épuisement, la révolte contre un système oppressant : la voix narrative les déploie avec force et netteté.
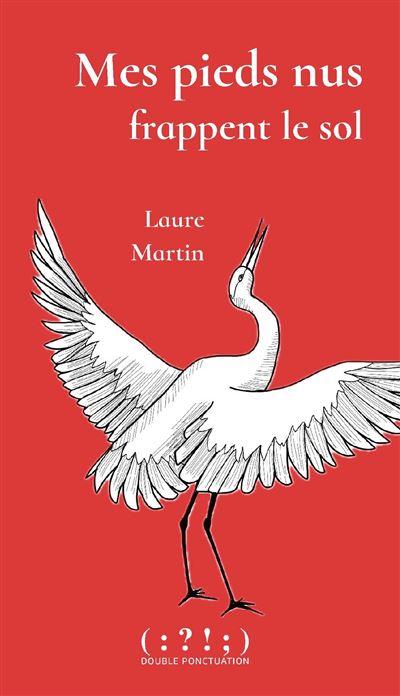
Mes pieds nus frappent le sol retrace une existence marquée par les violences sexuelles, l’inceste étant à l’origine d’un cycle de dépossession du corps. Les tentatives de reconstruction se heurtent à de nouvelles formes d’asservissement d’un monde structuré comme une prison patriarcale à ciel ouvert. L’écriture, sans concession, épouse les ruptures causées par la mémoire traumatique dans une succession de fragments qui disent l’enfermement, la sidération, la dissociation, mais aussi la rage et la survie. Rythme saccadé, phrases brèves, images tranchantes : la voix narrative rejette l’apitoiement comme la facilité, projetant le lecteur dans une existence dominée par l’injustice, mais traversée par la nécessité de se relever. De l’enfance brisée à l’errance adulte, de l’autodestruction à la maternité contrainte, le texte trace une trajectoire où l’intime rejoint le politique. L’ultime basculement, porté par la révolte féministe au Mexique, transforme la douleur en un cri collectif. L’écriture devient alors un dernier rempart contre l’anéantissement, manière de reprendre possession de ce qui a été arraché.
L’inceste : sidération sans fin
« La limace, c’est le zizi de Papi. » L’incipit rend compte de manière directe de l’horreur qui surgit avec cette image tant organique que dérangeante, car l’intrusion s’inscrit dans la matière même du corps de l’enfant. L’humidité, la viscosité, l’irréversibilité du contact imposé : l’écriture les révèle, la violence s’exerçant sous couvert d’autorité familiale. Cette dernière instaure un silence écrasant, enfermant la victime dans une prison intérieure dont elle ne peut s’extraire.
Le texte étouffe volontairement, mimant l’enfermement propre au fonctionnement systémique et silencieux de l’inceste : le quotidien lui-même reconduit l’inéluctable. La maison familiale se fige alors, verrouillée par l’omniprésence du bourreau, dont la seule manifestation sonore annonce la menace : « J’entends le bruit de ses pas dans l’immense couloir et la panique me fait tourner la tête. » L’attente, tout autant que l’acte lui-même, exerce sa puissance destructrice. Le silence, maître dans le corps et l’esprit des victimes, condamne, tout comme la nuit ne promet pas le repos, mais la terreur latente d’une attaque. La peur imprègne donc le quotidien, régit l’espace et ronge le temps.
Le texte étouffe volontairement, mimant l’enfermement propre au fonctionnement systémique et silencieux de l’inceste.
Le langage, cru et direct, répète la cruauté des gestes subis et perpétrés contre une enfant : « Papi ouvre ma zezette et farfouille dedans avec son nez et sa bouche, comme un chien qui cherche des trucs dans la forêt. » L’image animale efface toute trace d’humanité de cet homme, la comparaison avec le chien réduisant l’acte à une prédation aveugle, dénuée de toute ambiguïté. Rien ne vient tempérer la brutalité de la scène : ni faux-semblant, ni illusion de douceur, seulement la violence dans sa nudité la plus absolue, rendue par une écriture encore marquée par la douleur ravalée. Car, face à elle, la dissociation devient l’unique refuge : « Quand Papi fait ça, je pars très loin dans ma tête, je m’en vais dans un monde de coton, poupée de chiffon, paix éternelle. » L’éloignement mental supplée à l’impossibilité de fuir physiquement. L’enfance ne se réduit pas seulement sous la violence, elle s’efface dans ce mécanisme de survie. Devenir « poupée », c’est s’anesthésier, cesser de ressentir, renoncer à toute réaction, puisqu’une poupée ne souffre pas. Une poupée ne lutte pas. Comment même des enfants pourraient-ils lutter face à une telle violence ?
Le rejet du corps : mutilation et négation du féminin
L’enfance volée cède la place à une adolescence marquée par l’autodestruction ; le corps est décrit et pensé comme territoire hostile, matière non-vivante à mutiler, à nier dans ses moindres failles. L’automutilation prolonge l’agression initiale : « Je n’arrive pas à m’en empêcher, j’arrache mes cheveux. Je les tire et je mange leurs racines gluantes. » La douleur est donc outil, outil qui permet de reprendre le contrôle : ce n’est plus l’autre qui impose sa marque, mais...