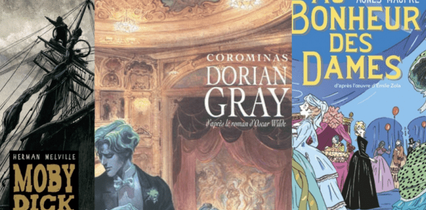Avec Gaudriole au Golgotha, Louis-Henri de la Rochefoucauld passe en trombe du berceau au tombeau, quand il ne fait pas station au bistrot. Un programme libre aussi réjouissant qu’imparfait.

Le péplum biblique ferait-il les beaux jours de la rentrée littéraire ? A peine dissipé le Royaume d’Emmanuel Carrère, voilà qu’il nous faudrait escalader le Calvaire ? Le Golgotha, sous ses faux airs de crâne arasé par le temps, n’est pourtant pas avare en distractions. Songeons un instant à la basilique du Saint-Sépulcre et sa grotte à l’entrée de laquelle se chamaillent prêtres et diacres des différents cultes chrétiens. Au milieu de ce tumulte de tirage de barbichettes, on ose à peine imaginer ce que donneraient les Dupondt, férus de costumes folkloriques, en goguette, si d’aventure ils promenaient de ce côté-là leur inénarrable sens des proportions. Et voilà qu’un jeune auteur voudrait y pratiquer la gaudriole au risque de friser l’incident schismatique ? Rassurons-nous, s’il est un farceur spirituel, Louis-Henri de la Rochefoucauld (L-H. L. R. dans la suite de cette chronique) n’est en rien un imprudent. Son nouvel ouvrage, publié cet automne, malgré son titre de polar mystique et désinvolte, se cantonne à une ligne Paris-Normandie abondamment arpentée, ne ménageant en fait d’exotisme qu’un bref détour par Grasse et la Méditerranée.
Genèse d’un écrivain français
Avec déjà quatre romans au compteur, il impose lentement son univers espiègle dans lequel la noblesse (qui n’en a pas fini de son agonie) apparaît plus que jamais comme une prodigieuse anomalie de notre âge atomique. De la rencontre heurtée entre us et coutumes désuets et obsolescence programmée, il tire des situations enjouées où domine l’incompréhension et s’amuse avec irrévérence de comportements en apparence inadaptés. Pour autant, il n’est pas un guide à monocle et lavallière qui, quelque part entre le Pré Catelan et les serres d’Auteuil, inaugurerait une réserve naturelle pour les passants encore ahuris par ces monstres marins naguère fixés par Proust en leur éternité. Face à ce qui pourrait s’apparenter à un ressassement des splendeurs perdues, il privilégie les figures de frêles excentriques et de ratés loufoques, contrepoints salvateurs aux délires de l’époque.
Il privilégie les figures de frêles excentriques et de ratés loufoques, contrepoints salvateurs aux délires de l’époque.
Puis il a creusé son sillon, celui d’une autofiction insolite à sa façon, tour à tour décalée, décentrée voire effacée. Un éloge paradoxal de la pudeur et de la discrétion. Il procède en ce sens à un habile mélange des genres, en héritier des écrivains libertins (davantage d’ailleurs que des prosateurs classiques du Grand Siècle tel son ancêtre le duc François, sixième du nom) qui ne s’embarrassaient plus guère des conventions. En candidat tout indiqué à un premier prix d’humour anglais, il avait débuté par un récit, Les Vies Lewis, teinté de mélancolie mais qui n’était pas sans rappeler les divagations de l’oncle Oswald de Roald Dahl. Dilection prolongée jusque dans son précédent roman, La Révolution française, paru l’an dernier, étonnant ouvrage de généalogie intime et foutraque dans lequel il semblait lorgner du côté de Swift et Sterne autant que de Gombrowicz.
Un jansénisme déjanté
Mais interrompons ici le test de paternité littéraire pour nous intéresser au présent ouvrage. De quel étrange objet livresque s’agit-il là ? Un narrateur, célibataire invétéré, jeune écrivain sans succès (toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite…), vivant de ciels et d’eau fraîche additionnée de single malt, nous convie au banquet de la longue admonestation qu’enfin il hasarde d’adresser à son ami Grégoire. Ce dernier, loup-cervier immature en costume de flanelle, amateur de la bagatelle devant l’éternel, ayant déniché un bon partie, entreprend soudainement de se marier. Il choisit son complice pour témoin et, à l’issu d’un quiproquo échevelé, lui réclame de prononcer un discours. Le mariage (inéluctable puisque nous sommes en territoire tragi-comique) aura lieu malgré les réticences, le discours sera expédié en quelques mots, s’ensuivront tromperies et divorce. La boucle est bouclée. Encore effaré, égaré par ce cadeau empoisonné, le narrateur aplanit enfin par écrit, dans ce qui prend la forme d’un impitoyable réquisitoire autant que d’une rupture sans sommation, le trouble et les prémonitions qui l’ont traversé au cours des mois précédant la cérémonie fatidique. En janséniste déjanté, il balance ses fredaines à la figure de Grégoire et détaille par le menu les affres qui devraient le hanter.
On avait pressenti que ce funambulisme des grandes occasions tiraillait l’auteur depuis la lecture d’une brève nouvelle (publiée dans le n°174 de Technikart, parcourue dans le Brive-Paris de 10h03 un jour d’août 2013) dans laquelle s’épanchaient les états d’âmes d’un jeune homme au moment de prononcer l’éloge funèbre de M. Gastonnet, grand éditeur désœuvré, auteur en secret d’un canular littéraire couronné de succès au-delà de toute espérance. La fable en morning coat y avait vocation de cruelle parabole. Ce qui vaut aussi pour Gaudriole au Golgotha et, pour se faire, il n’y avait sans doute meilleur sujet que la satire d’un silène. Les différents épisodes qui ponctuent ce chemin de croix ne manquent d’ailleurs pas de sel. Entre les rencontres avec des mères déphasées, l’achat désastreux d’une jaquette, les interventions intempestives et néanmoins réconfortantes d’un voisin désespéré, jusqu’au consternant compte-rendu de l’enterrement de vie de garçon, le récit est enlevé et ne se départit jamais d’une certaine frivolité.
Entre les rencontres avec des mères déphasées, l’achat désastreux d’une jaquette, jusqu’au consternant compte-rendu de l’enterrement de vie de garçon, le récit est enlevé et ne se départit jamais d’une certaine frivolité.
Boulevard du souvenir, impasse des extravagances
Pourtant, le narrateur insiste, citant Diderot, sur le fait que sa fable relève « de la plus haute extravagance et tout à la fois de la philosophie la plus profonde. » A travers la figure du godelureau transparaissent les ravages de la drague compulsive et le constat lancinant d’une perte, celle d’une pratique pure et ingénue de l’amour. Autant que l’opposition systématique des deux protagonistes peine à convaincre, cette dualité, non dénuée de certains aspects de vérité, demeure insuffisamment ébauchée pour être tout à fait opérante. Là où le livre réussit plutôt mieux, c’est dans l’évocation des trajectoires qui divergent, la mélancolie du passage d’une réelle amitié d’enfance virant au désintérêt et même à la répulsion. Les réminiscences, qui suspendent la course des événements, révèlent à rebours leur caractère d’oracles comme ici au seuil des chemins de jeunesse : « malgré notre entente alors parfaite, nous ne partagions pas non plus un tandem, et il y avait toujours un tournant où tu allais trop vite pour moi, où je perdais ta roue, avant de me perdre moi-même dans la brume de novembre ». Une lutte entre fidélité au passé et devoir de sincérité que tranche pour le narrateur ce livre d’amertume, lucide memento mori, qui est aussi un échec parce qu’il vient trop tard pour sauver l’amitié.
Afin de raconter l’âme en peine qui lâche et erre, L-H. L. R. adopte une tournure non pas corsetée mais résolument primesautière. Avec lui, éberlué, on ne glousse ni ne ricane, mais on s’esclaffe, on rit sous cape, ce qui suppose une bonne dose de mauvais esprit. Alors, en roue libre, prélude au sacrifice, il multiplie bons mots et calembours comme le Christ les pains. Au risque de valser dans le décor. Car à trop accumuler les figures de styles, les glissements de sens vers le figuré, l’argot des bistrots ou les allitérations tortueuses, les gants blancs finissent par se tacher d’encre. Par moment, on croirait avoir affaire à un patineur vibrionnant, si enivré de ses virevoltes et cabrioles qu’en bout de piste il prend une gamelle et se fracasse contre le mur du ton. On aurait pourtant souhaité qu’il assume les courbes, les respirations et varie ses effets comme on alterne pleins et déliés. Et l’on regrette que son timbre agréable et singulier, brillant dans l’art du filigrane, soit parfois noyé dans un tintamarre de claquettes.
Faisant vœu d’accommoder la cuisse (soit le débraillement hédoniste) et les pommes (tentations convoitées), il tombe en fin de compte dans son propre panneau : « Et ces cuisses dragueuses reviendront, inlassablement, avec de nouveaux subterfuges pour nous faire gober leurs complexes camouflés en compliments. On pourra rire un temps de ce comique de répétition. Avant de trouver ça aussi ballot que lassant. » A la cuisse manquait sans doute l’aile, pour que l’ensemble puisse véritablement décoller. Mais ce texte pas toujours digeste peut aussi se savourer par fines tranches, comme un bon carpaccio. Surtout, par refus d’un romantisme même déniaisé, l’apostrophe stagne au stade de la vengeance du « polisson à sarbacane », là où, ménageant l’équivoque, elle aurait pu laisser entrouverte la voie du repentir pour Grégoire, ce Don Juan de notre temps. Evoquant l’épisode du bon et du mauvais larrons, scène de la Passion lors de laquelle ce dernier invective le Christ au Calvaire, Léon Bloy parlait d’une « faillite apparente de la rédemption ». Ce qui, d’une certaine manière, a valeur de définition pour la littérature. En substituant aux larrons, deux lurons en foire, Louis-Henri de la Rochefoucauld nous offre une pochade preste et désabusée qui nous laisse essoufflés. On ne devrait jamais quitter le Jardin des Oliviers.
- Gaudriole au Golgotha, Louis-Henri de la Rochefoucauld, Gallimard, coll. L’Arpenteur, 208 pages, 17.90 euros, octobre 2014
Guillaume Pinaut