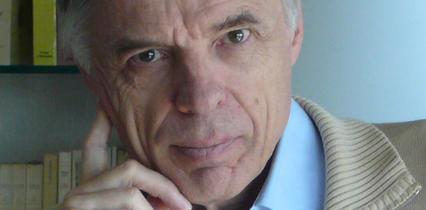Lise Charles signe avec Paranoïa un roman déroutant et halluciné au charme singulier. Sous une plume en apparence légère, se cache une narration dense, saturée de références littéraires, où réalité et fiction s’entrelacent dans une construction complexe.Le récit, scindé en deux parties radicalement différentes, nous immerge d’abord dans le quotidien bourgeois d’une adolescente actrice, avant de se transformer en conte baroque et onirique.
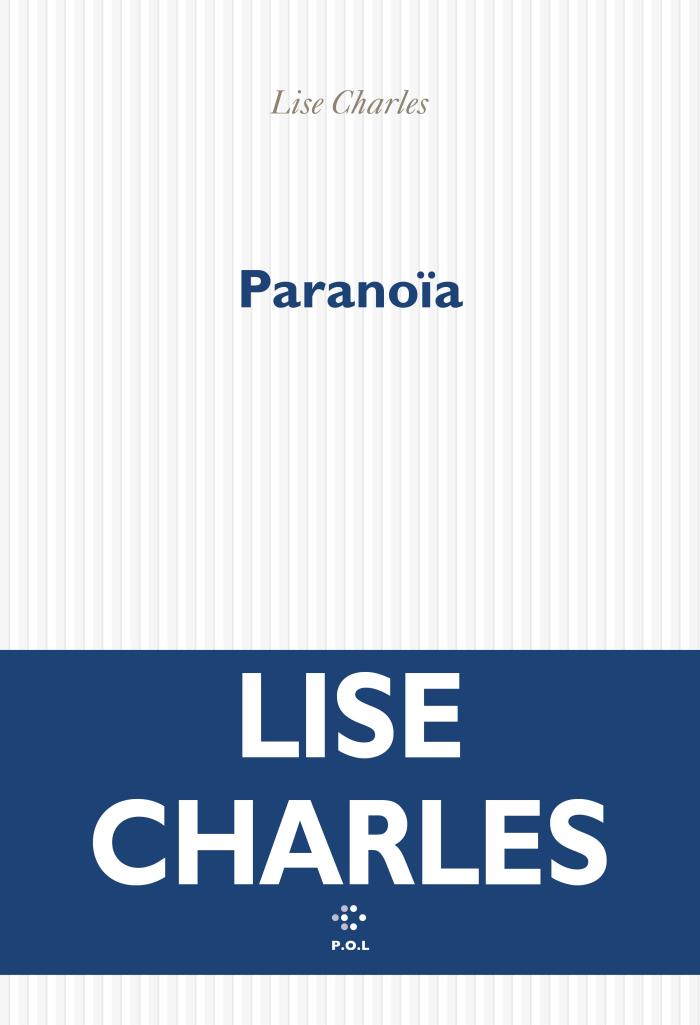
Un roman déstructuré
La lecture de ce roman divise : littéralement puisque la rupture générique entre les deux parties déstabilise par son incohérence narrative. Jeune actrice de retour au lycée Henri IV après le tournage d’une série TV dont elle était le personnage principal (Lou y es-tu), Louise se découvre d’abord par l’intermédiaire d’une narration introspective assez classique. Obsédée par elle-même, en proie à une profonde solitude, elle nous donne à juger ses amitiés, ses amours, sa famille et elle-même. La deuxième partie transgresse l’univers réaliste établi pour nous emmener sur le chemin incongru d’un conte merveilleux où cette même narratrice s’isole et s’éprouve entre les murs d’un château-monastère. À l’occasion de dialogues avec des figures allégoriques, Louise semble revisiter les codes du roman d’apprentissage à l’aune des classiques du XVIIe siècle.
Malgré quelques effets de résonnance et mentions d’une vie antérieure qui semble s’être effacée dans les méandres du traumatisme qu’a été la mort de sa sœur – dont on ne sait par ailleurs rien de plus sinon qu’elle est morte – le lien entre les deux parties reste ténu. Ce qui demeure consistant s’avère paradoxalement être la confusion de cette étrange narratrice, en quête désespérée de repères, fouillant dans les préceptes anciens pour tenter d’élargir les perspectives de son existence contrariée.
La structure est en ce sens dérangeante, éclatée en un accumulis de souvenirs, de contes enchâssés, d’extraits littéraires et de citations, de réflexions ontologiques, de maximes et principes moraux – qui soutiennent autant qu’ils étouffent parfois le récit. Lise Charles, habituée des éditions P.O.L où elle a déjà publié trois romans, est aussi normalienne, agrégée de lettres et maître de conférences à La Sorbonne ; sa connaissance intime et théorique des siècles classiques se perçoit bien dans ses propos érudits, ponctués de multiples références au XVIIe siècle, depuis les pièces de Molière, aux fables de La Fontaine, aux maximes de La Rochefoucauld ou de Mme de Sablé, aux contes de Perrault jusqu’aux oraisons de Bossuet, ou à la théorie des « faces » de Brown et Levinson. Dans la volonté sûrement métalittéraire de réactualiser l’ancien dans le contemporain et de faire de la littérature une grande institution immortelle et universelle, Lise Charles tombe dans l’écueil du superflu et de l’extravagant ; on en vient à se demander si la première partie contemporaine n’est pas seulement le prétexte à publier le conte de la deuxième partie, genre désuet qui lui tenait vraiment d’écrire.
Sous couvert d’une réflexion sur le métier de romancière – puisque sa narratrice nourrit l’ambition de le devenir – l’autrice justifie ses manquements ainsi ; « Ce n’est pas moi si ce récit est parfois mal cousu. Le monde est un tissu de mauvaise qualité, et je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de le recoudre. » Lise Charles dénoue alors les ressorts de la fiction pour confondre les frontières ; la similarité des noms Louise/ Lise Charles devient prétexte à recomposer le réel. La personnalité et certaines expériences de Louise pourraient alors être imprégnées de celles de son autrice.
Une plume désincarnée
Louise n’est pas du type à prendre des initiatives, elle se dit même renfermée voire ennuyante – en contraste avec ce qu’on peut projeter de la personnalité d’une jeune actrice. Il y a la force des autres personnages aux voix et caractères singuliers qui réhaussent heureusement le rythme de la narration (et permettent la progression de l’action) et contrent le côté agaçant de ce personnage principal qui se cache constamment sous ses névroses, ses hontes et ses peurs. Le titre se justifie au regard de ce comportement littéralement paranoïaque, semble-t-il provoqué par sa jeune expérience des caméras. Louise se sent constamment scrutée, jugée, manipulée – parfois à raison mais très souvent à tort. Sa méfiance la paralyse et fait d’elle un personnage passif, dissocié d’elle-même, embourbé dans une humilité qui relève davan...