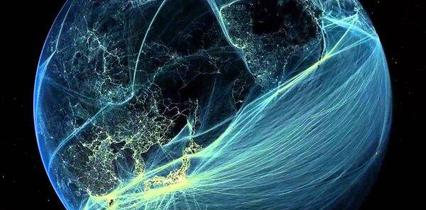Louise, adulte lunaire, se souvient de son enfance à la ferme à la fin des années 1980, lorsque son père laitier luttait en vain contre le déploiement de l’élevage intensif. Dans son troisième long-métrage, le plus tendre, Hubert Viel célèbre et déconstruit simultanément la nostalgie que tout adulte peut porter en lui pour sa propre enfance. Gros plan sur un geste cinématographique désarmant de (fausse) candeur.
Cahiers d’un retour au pays natal

Louloute chante le regret d’une période bien spécifique, qui correspond à la propre enfance du réalisateur : la fin des années 1980, représentées avec fascination mais sans criarde complaisance grâce à quelques accessoires évocateurs et des couleurs sobrement saturées. Bien des figures généreuses rythment le quotidien de Louise : un père héroïsé, tendre et obstiné (Bruno Clairefond) ; une mère aussi explosive qu’aimante (Laure Calamy), vraie Sido d’une Louloute quasi-Colette ; un grand frère et une petite sœur, complices ou opposants aimants des bêtises du quotidien, et le chien Soldat. Les journées passent vite, entre la traite des vaches, la fabrication de la pâte à crêpe, Ken le survivant à la télé, les fugues au petit matin pour vivre des aventures, mais aussi les repas de famille, les engueulades, la détresse économique. Autant d’images d’Épinal tendres et rudes d’une enfance rurale, vécue par une enfant incomprise, sujette au spleen. Elles sont mises en scène par Hubert Viel comme naïvement, avec authenticité et sans trouble apparent face à leur caractère potentiellement éculé. C’est à la fois naturel et kitsch, et c’est divin : c’est le mièvre débarrassé de ses connotations péjoratives et rendu à sa profondeur réelle. Une des réussites de Louloute tient au fait que cette histoire en somme simple (dans le meilleur sens du terme) se déplie délicatement sans que rien ne soit prévu, convenu, attendu. Ce n’est que peu à peu et comme en sourdine qu’apparaît le sujet principal : le chagrin inextinguible d’une adulte pour qui l’enfance fait figure de violent paradis perdu.
Du bienfait des cauchemars
Louloute montre comment un grand récit familial parasite amèrement l’âge adulte
Hubert Viel joue volontiers avec les échos que le passé, qu’il soit lointain ou plus proche, collectif ou individuel, envoie vers le présent. Alors que son deuxième long-métrage, Les Filles au Moyen-Âge (2014), dynamitait les grands récits historiques grâce à leur relecture subversive par une troupe de petites filles décidées, Louloute montre inversement comment un grand récit familial parasite amèrement l’âge adulte. Le film repose sur une succession de flash-backs : vingt-quatre heures de la vie de Louise sont rythmées par des rêves et des souvenirs proliférants, de plus en plus douloureux à mesure qu’avance la narration. Cette structure forme un hommage discret au cinéma classique, notamment à l’un des réalisateurs hollywoodiens qui a le plus touché aux structures du temps : Mankiewicz. Chaînes conjugales (1949), Ève (1950), La Comtesse aux pieds nus (1954) se focalisent en effet sur le poids labyrinthique du souvenir. Si l’on songe parfois à du Desplechin, par exemple à Trois souvenirs de ma jeunesse (2015), au détour d’une ou deux brèves scènes de Louloute (pas les plus réussies, lorsque Louise adulte commente avec un certain narcissisme sa personnalité d’enfant) c’est en tant que ce réalisateur paye lui aussi son tribut à une certaine structure scénaristique portée aux nues par le film noir puis récupérée par la veine intellectualisante de Mankiewicz.
Derrière cette lisibilité apparente, un trouble pointe. Les réminiscences de Louise ne seraient-elles pas trop précises ? Certes, c’est là l’éternelle aporie et la grande convention des films à flash-backs (les scènes sont toujours bien trop cohérentes pour constituer de véritables souvenirs). Dans un film de François Ozon, Louise serait une mythomane dépressive. Chez Viel, le regard demeure bienveillant sur cette femme très poétiquement déséquilibrée, pour qui la vie au présent est un cauchemar, tandis que seul les ombres de l’enfance offrent une certitude. En réalité, le contraste entre le naturel très sobre de la mise en scène et ces souvenirs au parfum de kitsch interroge l’authenticité de ces derniers : ils paraissent trop bien écrits pour être vrais, trop nets pour aider à guérir. Il semble que Louise souffre surtout de ne pas faire assez de cauchemars, de ceux-là qui, incohérents et fragmentés, détruisent les grands récits mais savent aussi panser les plaies. Aussi le seul véritable cauchemar du film est-il vraiment cathartique : par sa violence, c’est sans doute lui qui permet la réconciliation finale, pour que Louise rompe avec l’idée que seul le passé est vraiment vivant.
Le labyrinthe de la vie
Le sujet du film est au service d’un motif qui le dépasse tant il est universel : la nostalgie
La grande réussite de Louloute tient dans une combinaison originale, à valeur de défi : faire du déclin de la petite paysannerie, thème complexe voire écrasant qui intéresse à raison la fiction et le documentaire français depuis une quinzaine d’années, un des sujets du film, pas le principal. En effet, il est perçu depuis le présent, ce qui l’éloigne et le déréalise ; de plus, il est au service d’un motif qui le dépasse tant il est universel : la nostalgie. Certes, l’équilibre ne se fait pas toujours sans heurt entre les principaux axes du film. La mère lunatique de Louloute est très présente sans pour autant habiter le cœur du scénario. Son interprétation réjouissante mais peu discrète par Laure Calamy complique le maintien à l’arrière-plan d’un personnage suffisamment charismatique pour occuper le devant de la scène. De plus, les enjeux agricoles sont présentés de manière bien manichéenne. On dira que c’est parce qu’ils sont perçus par le regard naïf de Louloute, qui érige son père en Saint-Michel terrassé par le dragon des politiques européennes (allégorie explicite dans le film). On aurait aimé plus de profondeur dans le regard que Louise porte sur eux, pour ne pas avoir l’impression dérangeante que l’adulte n’a quasiment rien de changé en lui depuis l’enfance. Toutefois, nul doute que la candide catharsis que constitue Louloute est profondément habitée et réussie. Il y a beaucoup d’amour dans ce film. Et qu’importe si le tissage des fils n’est pas toujours régulier : la vraie vie est-elle bien plus lisible ?
- Louloute, un film de Hubert Viel, avec Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond