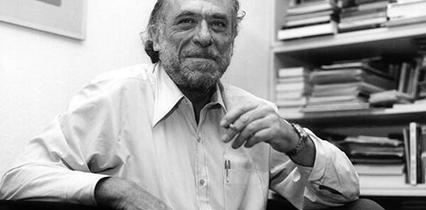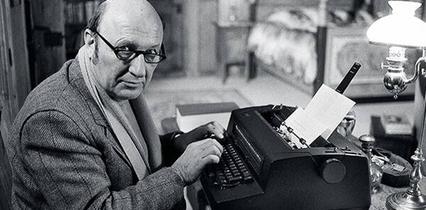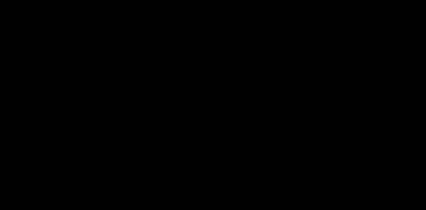En 1933, Paul Morand publie Londres, ouvrage multiple, tout à la fois chronique sociale et historique, récits de voyage mais aussi portrait de sa ville favorite. Mêlant ses propres expériences, son érudition, ses goûts littéraires à une certaine conception du voyage et de l’altérité, Morand propose à ses lecteurs un dépaysement profond et une plongée documentée dans les us-et-coutumes de nos voisins d’outre-manche, avec lesquels il partage un certain anticonformisme teinté de bonnes manières. Ce nouvel épisode de notre série du confinement “Les classiques de la rédaction” propose de suivre les traces de Morand à Londres et de découvrir au fil de ses déambulations, ses émerveillements, ses souvenirs ainsi que le ton inimitable de celui qui affirmait dès Le Voyage en 1927: “Faire l’éloge de son coin de terre : point de vue de cadavre”.
‘’Et merde pour le roi d’Angleterre qui nous a déclaré la guerre !’’
Chanson à boire de la Marine Royale Française
“La vulgarité européenne et la médiocrité plébéienne des idées modernes sont l’œuvre de l’Angleterre’’ écrivait Nietzsche. Et en effet, il faut avoir déjà dîné d’un porridge grumeleux dans la cuisine formica d’un pavillon de Preston pour comprendre à quel point les anglais ont déclaré la guerre à toute forme de grâce ou de sensibilité !

Outre une vielle habitude prise à brûler nos pucelles, couler nos navires et emprisonner nos empereurs, la perfide Albion se distingue encore par ses grands hommes. D’Henri VIII, prince atteint de priapisme profond et d’antipapisme primaire, à Smith, prophète de la ploutocratie contemporaine, en passant par ses philosophies aux doux noms de pragmatisme et d’utilitarisme, l’Angleterre, cette nation si peu accueillante qui a choisi la pluie comme unique saison, la bière en plat de résistance et qui s’est entourée de mal de mer, est aussi la terre où ont poussé précocement toutes les tares du monde moderne – parlementarisme, chômage et cheddar bon marché – ainsi que la source intarissable de toute une cohorte de sectes schismatiques et revêches : unitariens, quakers, calvinistes, réformés et autres presbytériens, étranges derviches mal embouchés.
Enfin, que dire de la légendaire lâcheté de ce peuple rougeaud et neurasthénique, qui des archers d’Azincourt au pick-and-go des terrains de rugby, ne comprend décidément rien à l’esprit chevaleresque et au beau jeu ?
Cependant, l’Angleterre c’est aussi Londres, ses clubs de gentlemen et leurs salons vert sapin et boisés, dans lesquels circulent, dans une saveur de cigare d’Hambourg, des élégants en tailleurs de tweed qui font crisser leurs paires de Church’s ou de John Lobb sur des parquets plein chêne avant de s’affaler nonchalamment sur de vieux fauteuils en cuir qui craquent.
Ses Clubs et leurs dédales de couloirs arborant d’illustres ancêtres encadrés, que l’on commente habituellement avec un fort accent d’Eton Collège en faisant tinter son verre de Brandy, prémices obligatoires avant le passage au fumoir quasi opaque en acajou luisant où marinent quelques gens de bonne compagnie, aristocrates de vieille fratrie du Kent, anciens lords décrépis et bourgeoisie industrielle rondouillarde parlant du cours de la bourse ou de la dernière courses de lévrier…
C’est, selon toute vraisemblance, cette Angleterre qui attira tout d’abord Paul Morand.
Au rythme de 1900
Morand (1888-1976) grandit à Paris près de son père, Eugene Morand, directeur de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, peintre, dramaturge et traducteur, qui l’initie très tôt à la littérature et lui fait rencontrer dès son plus jeune âge Rodin, Sarah Bernhardt, Léon Paul Fargue ou encore Marcel Schwob. Elève particulier de Jean Giraudoux, il intègre après son baccalauréat l’École des Sciences Politiques, avant d’être reçu premier au concours des ambassades du quai d’Orsay, et d’embrasser une longue carrière de diplomate au moment même où il devient l’un des premiers succès commercial de la NRF. Morand fut aussi envoyé spécial pour la presse, journaliste au Figaro, directeur de collection chez Gallimard et membre de l’Académie Française.
Grand mondain, collectionneur d’art raffiné et amateur de fêtes fastueuses, Morand prit tout de même le temps de laisser derrière lui une œuvre littéraire abondante et protéiforme : romans ( Lewis et Irène, Champions du Monde, Hécate et ses chiens), nouvelles (L’Europe Galante, Fermé la nuit, Rococo), poèmes (Lampes à arc, Feuilles de température, U.S.A), correspondances (avec Jacques Chardonne, Michel Déon, Roger Nimier ), préfaces (à Stendhal, Balzac, Barbey d’Aurevilly), essais et chroniques (Papiers d’identités, L’Heure qu’il est, L’Allure de Chanel), carnets de voyage et portraits de villes (New-York, Air Indien, Venises) ; c’est en tout plus de quatre-vingt ouvrages étalés sur soixante années d’écritures, mais aussi de voyages sur les cinq continents, que nous livre avec grâce notre noctambule européen.
Notre noctambule européen nous a livré avec grâce plus de quatre-vingt ouvrages étalés sur soixante années d’écritures, mais aussi de voyages sur les cinq continents.
Morand apprend très tôt la langue de Shakespeare -il sera même un temps journaliste dans des revues anglo-saxonnes comme The Dial– et fait de nombreux séjours à Londres dès ses quatre ans, séjours qui s’intensifieront à son adolescence avant que ne commence sa carrière diplomatique outre-manche, à l’ambassade de Londres avant-guerre, puis au ministère des affaires étrangères où il dirigera la mission économique française en 1939.
Dès son premier recueil de nouvelles Tendres Stocks, salué et préfacé par Marcel Proust en 1921, Morand décrit avec un plaisir non dissimulé ses soirées à Londres, ‘’cette ville qui vous gâte toutes les autres’’, à travers trois courts récits de jeunesse où transparaissent alors ses amours pour de jeunes rouquines de la City, ses batailles de polochons dans les dortoirs d’Oxford et son admiration devant les courses d’avirons annuelles de Purtney-Mortlake.
L’Europe Savante
Londres, parut en 1933 chez Plon est donc l’œuvre d’un anglophile confirmé et d’un cosmopolite dans l’âme mais constitue avant tout une déclaration d’amour à Londres et à ses habitants.
Sorte d’encyclopédie vivante de la ville, monument de savoir et d’érudition mêlant habilement études approfondies, remarques, descriptions, et citations des vers londoniens de Verlaine, l’ouvrage propose une véritable géographie de Londres sous la forme d’un inventaire inspiré des différents parcs, palais, rues, quartiers, square et statues.
L’ouvrage propose une véritable géographie de Londres sous la forme d’un inventaire inspiré des différents parcs, palais, rues, quartiers, square et statues.
Morand conte aussi à grands traits le passé de la capitale : de la peste noire au grand incendie, des Tudors aux Stuarts, des invasions normandes à Cromwell et ses têtes rondes, toute la colossale histoire de Londres défile sous nos yeux en une série de courts récits avançant à vive allure. Cependant, loin de livrer uniquement une Histoire sentencieuse et hagiographique des gouvernements successifs, Morand fait aussi malgré lui l’histoire des idées, des pratiques et l’histoire sociale de la ville. On retrouve en effet quelque chose du Balzac sociologue chez ce Morand attentif aux groupes sociaux et à la division du travail et de l’espace urbain.
Londres-la-doulce
Du Londres romantique embrumé à celui enfumé des industries modernes, tous les lieux de la capitale sont investis, expliqués, mis en récit et magnifiés avec brio. Nous suivons ainsi Morand dans certains des quatre-cent-cinquante clubs de Piccadilly : le Savoir-vivre Club, le White’s club – auquel appartenaient tous les premiers ministres Anglais -, le Royal Automobile Club, le Club Éternel – dont les membres se relayaient afin qu’il ne fût jamais vide -, le Saint James club – réservé aux diplomates étrangers -, le Naval ou le Turf, où nous rencontrons, avec quelques siècles de retard, les grands gardiens des lieux : Lord Petersham et ses 375 tabatières, Lord Egerton qui faisait porter des bottes à ses douze chiens et les faisait dîner à table avec lui.
Nous plongeons par la suite dans ce vieil esprit corporatiste anglais venu du moyen-âge, en visitant les échoppes des bottiers, les syndicats horlogers ; nous apprenons au passage leurs coutumes et dictons, leurs gestes, leur histoire.
Plus loin, nous voilà ébahis devant les intérieurs des grandes fortunes de May Fair où de vieux majordomes à cravate noire gardent avec parcimonie des hôtels particuliers crème, à colonnades de stuc, peuplés de vieilles dames encerclant avec avidité leurs réchaud de cuivre rouge à l’heure du thé.
Arpentant la ville aux hasards de l’aurore, nous croisons alors le défilé des ouvriers loqueteux à casquette, esclaves modernes des industries, miséreux du textile, aux traits tirés par la faim, errant à travers Trafalgar Square sillonné de bus impériaux, dans un brouillard d’hiver couleur de chlore.
Notre vagabondage nous mène vers midi devant les pendaisons de pickpockets des docks, au cœur d’un public hétéroclite : aristocrates ruinés, pléthore de grévistes irlandais et ivres, dandies décadents et ladies à diadèmes, qui s’enfuiront bientôt dans les maisons de jeux de Leicester Square, dans les bordels de Soho ou à l’Abbaye de Westminster, ce «fantôme blanc dressé sur la cité fumeuse”, qui retient en son sein toute l’histoire d’Angleterre et à côté duquel notre Panthéon fait pâle figure.
S’en suit une visite guidée du Tate et de la National Gallery où se succèdent sans discontinuer les esquisses de Blake, les aquarelles d’Hogarth, Whistler et Turner ainsi que de multiples collections particulières dont la fameuse Wallace Collection fourmillant de Watteau, de Greuze, de Boucher…
Plus tard, après les craquements d’os épiques des combats de boxe clandestins, les hurlements des bookmakers de champs de courses, et les soliloques murmurés des prêcheurs à estrades d’Hyde Park, nous retrouvons un peu de silence sur les quais de Chelsea, qui bordent les eaux argentées et sales du fleuve au matin. Silence vite encombré par les familles petite-bourgeoises, sortant de leurs maisons jaunes à cheminées noires pour faire la promenade. Plus tard encore, les réverbères des ponts éclairent alors l’eau sombre de la Tamise où sautent sans un bruit les désespérés que des remorqueurs trapus, sillonnant en permanence le fleuve, remonteront au matin.
Londres nous fait traverser l’espace et le temps au rythme allègre des soirée de Morand
Nous rentrons alors à l’hôtel émerveillés et un peu effrayés, dans le mystère nocturne de ces rues labyrinthiques et de ses faubourgs de romans noirs, peuplées de chimères et d’assassins aux poignards luisants sortis tout droit du théâtre élisabéthain.
Des rayons de l’Hatchard’s Library, ruisselants de livres rares, aux bars bohèmes de Soho avec leur faune, des vernissages de la Royal Academy peuplés de vieilles filles, au marché aux puces de Caledonian Market où le trottoir se métamorphose en arrière-cour de Cracovie, Londres nous fait traverser l’espace et le temps au rythme allègre des soirées de Morand, prenant l’apéritif au Café Royal, l’entrée chez Driver, le plat dans Warwick Streets et le désert à Piccadilly, le tout en taxi, sans oublier de commenter consciencieusement le moindre édifice croisé en chemin.
La prose de l’homme pressé
‘’Il ne faut pas oublier que Paul Morand est le premier de nos écrivains qui ait jazzé la langue française’’ écrivait Louis-Ferdinand Céline dans sa correspondance, et en effet, Morand peint tout de couleurs fraîches, vives et franches. Derrière le tracé de sa phrase nette apparaît alors en germe une modernité brillante et désinvolte : le vin, les autos, les cafés, les amours et les parties de poker se succèdent, sans fausse profondeur, sans littérature, sans besoin de s’appesantir pour l’effet, mais en proposant néanmoins, au détour d’une formule d’apparence gratuite, des réflexions d’une rare acuité.
Quelque part entre le Coté de Guermantes et Dickens, à travers ces suites de fresques, de descriptions et de scènes de genre au gré des âges, Morand nous montre toute la diversité de Londres. Diversité des peuples, des corporations et corps de métier, des classes et des loisirs, le tout rythmé, sanglé, galopant au rythme de ses humeurs. C’est alors pour le lecteur une impression grisante de profusion, portée parfois par de longues phrases dilatoires et pointillistes qui s’étirent en circonvolutions, virgules, et détails utiles, en épithètes précises et précieuses, tout en se laissant aller par moment à la prose pressée chère à Morand, faite de phrases courtes et coupantes, prenant souvent le tour du trait d’esprit, de la formule ou du bon mot.
Morand peint tout de couleurs fraîches, vives et franches
Sorte d’hypotypose permanente glissant avec grâce de quartier en quartier et égrenant dans sa course un foisonnement de détails révélateurs et d’historiettes variées, Londres comme toute l’œuvre de Morand, est placé sous le double impératif du rythme et de l’extravagance, ce qui confère un charme indéniable à ses énumérations baroques, mêlant pêle-mêle les plats et les lieux, les arts et les hommes.
Les rêveries du promeneur insulaire
Morand, promeneur de Londres, transmet ses émerveillements avec brio et offre à ses lecteurs un de ces ouvrages dont il a le secret, un ’’ livre rempli de clinquant, de verroteries et de beaux noms étranges’’ comme le disait si justement Sartre à propos des écrits de son aîné.
L’ouvrage constitue donc à sa façon un panégyrique en clair-obscur de Londres et des manières insulaires. La cité, toute bâtie en bois coloniaux, en vieilles briques rouges, en mobilier Sheraton et en turbulences gothiques, est ainsi peinte en demi-teinte, à travers les errances et les réussites de son histoire, par une intelligence taillée pour le voyage et un cœur épris de géographie.
Morand, ce nomade si passionné d’ ailleurs qu’il souhaitait qu’on fît de sa peau une valise après sa mort, nous dépayse avec talent et vérifie mieux que personne le fameux vers de Charles Palissot de Montenoy : ‘’Le véritable sage est cosmopolite’’.
- Londres, suivi de Le nouveau Londres, Paul Morand, Folio Gallimard, 2012.
Pierre Chardot