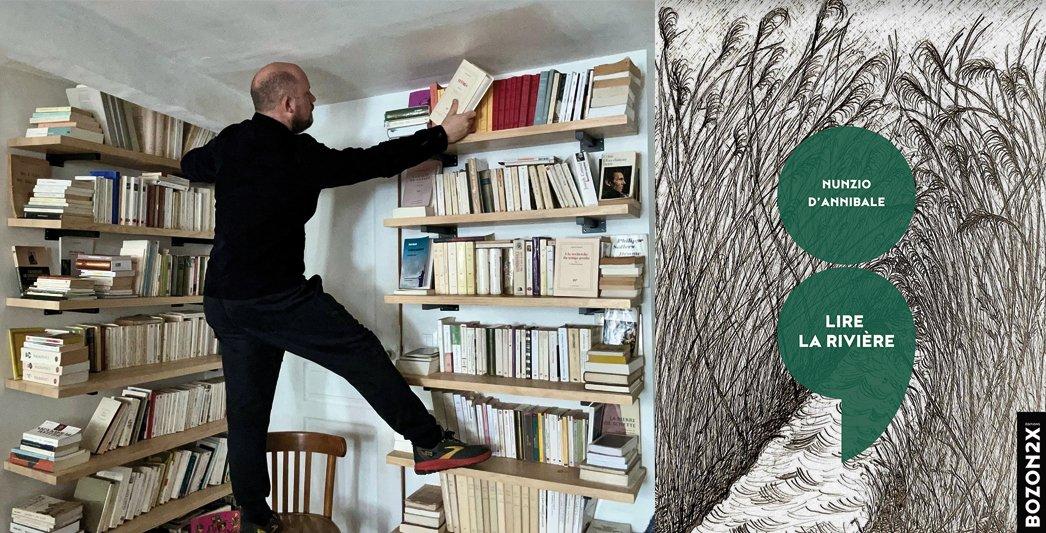Cet entretien, mené par David di Nota, a été réalisé à l’occasion de la sortie de Lire la rivière de Nunzio D’annibale. Il revient sur les personnages de ce roman, dignes d’une comédie romantique : tout les pousse au rapprochement, mais ils ne peuvent jamais être ensemble. Le roman s’inscrit également dans la lignée des romans philosophiques comme Jacques le fataliste et possède une véritable force comique, notamment dans son traitement du manque.
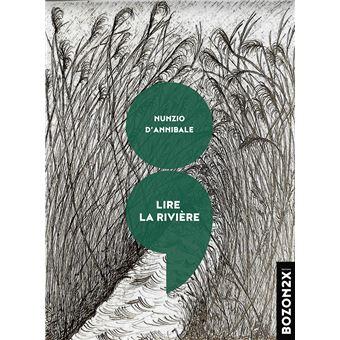
David di Nota : «Les écrivains français veulent savoir ce qu’ils font », disait Borgès. À l’évidence, toi aussi. Mais commençons par le commencement. Parle-nous, si tu veux bien, de Nora et Vadim.
Nunzio D’Annibale : Nora et Vadim, si tu veux, sont les personnages d’une drôle de comédie romantique. Tout devrait les séparer mais le temps et l’espace les ont réunis pour le plus grand plaisir des amateurs de comédie, romantique ou pas, d’ailleurs. Dès qu’ils sont réunis, on dirait que quelque chose cherche à les séparer et dès qu’ils sont séparés, autre chose semble pousser au rapprochement. Elle est historienne de l’enfance, il est criminologue. Il se sent mal aimé, elle se sent trompée. Elle est mal à l’aise, il est à l’aise avec le mal. Elle cherche une voie de sortie, il cherche la diagonale d’un exil. Tout au long du roman, leur existence reste incertaine, comme dans un rêve. L’amour, c’est drôle et beau « comme la rencontre de la tomate et de la mozzarella » dit le narrateur à propos des amants. Ce sont deux amants, en somme, qui cherche à fabriquer une mythologie à deux, afin d’échapper à la banalité de l’amour… je ne sais pas si tu me comprends… en gros, ils tentent d’introduire une fantaisie antisociale, des morceaux de hors-la-loi dans l’amour. Ils font l’hypothèse que l’amour constitue un crime contre la société. À quoi parviennent-ils ? Chaque lecteur en jugera… Une dernière chose : mes personnages sont comme des extractions à froid d’une chair existentielle… tu vois… un peu comme l’huile d’olive… mais aussi comme si j’avais découpé des êtres dans des tableaux et donné vie à ces corps découpés… mes personnages, si tu veux, ont surgi de tableaux… je regarde la peinture en permanence… pour s’amuser, on pourrait dire que Vadim est une sorte de Mousquetaire de Picasso et Nora serait une superposition entre Berthe Morisot étendue de Manet (1873) et la Judith du Caravage. J’aime avec passion l’expression du visage de Judith dans le tableau du Caravage. Cette expression est à l’origine du personnage de Nora.
DDN : Tes personnages s’aiment sans le savoir. L’espace se joue de Nora et Vadim, lesquels passent leur temps à se manquer – dans le double sens du terme. On pourrait reprendre le mot de Diderot pour qualifier cette conception de l’amour : « vous y étiez avant que d’y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez ».
NDA:J’ai essayé en effet de poétiser la question du manque dans cet évènement si futile et sérieux qu’on appelle l’amour… et comment – la citation du Diderot aurait pu être en exergue du livre – une rencontre potentielle précède la rencontre réelle. Vadim se pose directement la question dans le roman : « J’ai aimé mes enfants avant qu’ils naissent, pourquoi n’en serait-il pas de même pour Nora ? » La Nora dont parle Vadim est d’abord en lui et le Vadim dont parle Nora est, avant tout, en elle. L’amour est une sorte d’accouchement hybride : on rencontre et on invente celui qu’on vise avec notre flèche érotique. C’est la formulation d’un compromis entre dedans et dehors. Mais cela entraîne une série de quiproquo(s) et désenchantements dignes d’un vaudeville ou d’un roman de Diderot, justement. Le manque était là avant, il sera là après, basta ! Vadim est subjugué par Nora, trompé par les scintillements du manque et les ruses clignotantes du désir… mais David, soyons honnêtes… nous nous laissons tromper avec un plaisir non dissimulé, non ? La comédie est sans entracte… la duperie… constante. Ça m’enchante, personnellement… ce n’est pas un hasard si le mot manque conclut le livre… tu avais remarqué ? Pour démontrer combien cette question du manque m’obsède, notons qu’on trouve cette affirmation dans mon premier roman, Le Manuscrit de Tchernobyl, à mes yeux la plus belle phrase de ce livre-fou : « Je n’oublitère jamè le mank ». Tout est dit, si on me permet ce manque de modestie, avec une économie rare : je, haine, négation, l’oubli qui erre, taire à terre, « mank » avec son manque de l’êtr-E, en mode semi-muette. Lire la rivière s’est écrit dans cette dynamique du manque insatiable et avec ma passion irrépressible pour la littérature : je t’assure que dans chaque phrase, une citation est cachée par une sorte de recouvrement baroque, une saturation proche d’une guitare rock… sans parler des ellipses constantes qui créent du manque dans le désir de savoir du lecteur…
DDN: Tu parviens à faire danser la phrase sans recourir à des adjectifs – par le simple déplacement de la pensée. Nous sommes clairement en présence d’un roman philosophique au sens de Jacques le Fataliste ou de Tristram Shandy, une tradition fort peu représentée de nos jours. Le résultat est que le manque est saisi dans son aspect comique au lieu de donner lieu à une mélopée sentimentale. C’est ce que j’aime le plus dans ton écriture : tu ne te plains jamais.
NDA :Oui, en effet… je crois que dans ce style que j’essaye de bricoler, la jubilation verbale et onirique vient recouvrir la plainte… et la pensée trace une sorte de danse conflictuelle… on y danse dans des labyrinthes où se perdre est un délice… pour moi, du moins… il y a donc en effet une écriture qui tente de slalomer dans la pensée… dans la polyphonie des monologues intérieurs inlassablement interrompus par la trivialité du corps… Et oui, je m’inscris exactement dans la filiation (relativement délaissée) que tu cites : Rabelais, Sterne, Joyce, Céline, Nabokov… les grands épiphaniques… les rois de la comédie… ces accélérateurs de particules… j’essaye de prolonger naïvement, avec désinvolture, encore et encore, encore et toujours… cette fantaisie si vitale à mes yeux… alors, oui, c’est une danse de la pensée… entrechats, sauts de cabri, pas de côté, retournés, jetés, etc. J’ai été très impressionné vers 20 ans par l’écriture de la danse, notamment la notation Laban… avec son cube des directions, sa cinétographie… et tu sais quoi ? Mon livre doit beaucoup à cette pièce de Pina Bausch, Café Müller, de 1977… (et dire que je n’étais pas né !). Si vous croisez une chaise dans mon roman… vous savez que je l’ai volée chez Pina Bausch… Café Müller est un chef-d’œuvre quasi indépassable sur la fameuse guerre des sexes… l’impossible rencontre des corps… Alors, si c’est cela que tu appelles « philosophique », c’est-à-dire de la pensée qui danse et pense avec des fantaisies poétiques saturées de sens et non avec des concepts, alors oui… tu as entièrement raison…
DDN : Je m’en voudrais de révéler l’intrigue. Disons simplement ceci. Du genou gauche de Nora, nous apprenons qu’il « tourne autour de ce qu’elle ne dit pas ». Vadim, lui, a un problème avec son badge. Il n’aime pas la sensation du collier lorsqu’il assiste à un séminaire – de sorte qu’il le tient à la main, « depuis toujours ». Tous ces détails sont, suivant une expression du narrateur que l’on pourrait aussi bien appliquer à l’amour, « futiles et décisifs ».
NDA :Je vois que tu as repéré dans mon texte des passages où je mets en place une sorte de « détaillisme », avec des resserrements optiques sur des parties du corps et des habitudes futiles… d’abord car cela permet pour moi de maintenir le lecteur dans un étonnement et un mouvement permanents, et ensuite car je m’étais mis en tête de produire une approche paranoïaque de la rencontre où le hasard serait aboli par l’encastrement des détails…. Futiles et décisifs… Alors oui ! mille fois oui ! L’amour se tricote et se détricote dans des pointillés futiles et décisifs… ça pourrait être une devise… une sorte de philosophie pratique tirée des récits absurdes du Zen, dont je raffole. L’amour est truffé de malentendus… rien n’est plus futile et décisif qu’un malentendu… et entre Vadim et Nora, malentendus il y a, à foison. Il est persécuté par les conventions sociales, elle est gênée dans leur application. Ce rapport aux conventions sociales les ont aimantés vers une sorte de zone grise commune… mais pas du tout pour les mêmes raisons. L’état de « petit délire » amoureux, si jouissif et irremplaçable, tend justement à enfumer les malentendus dans un nuage lénifiant. L’amour commence par une sorte de brouillard délicieux et confusionnant… et quand le brouillard se lève… que les malentendus reprennent formes… deux inconnus se font face. À partir de là, comment fait-on ? On ruse… exagérons un peu… L’Odyssée, écrit par un poète dont la légende veut qu’il soit aussi aveugle que l’amour, ne parle-t-elle pas de l’homme aux mille ruses, Ulysse ? L’amour n’échappe pas à ce voyage semé d’embûches. On navigue comme on peut entre la guerre et l’amour… avec la mort comme horizon… alors nous aussi, on se cache sous un mouton, on s’attache à un mât, on dit qu’on est personne (c’est-à-dire « comme tout le monde »)… on ruse jusqu’au point de bascule… on défend sa forme… on se leurre… on s’aperçoit à peine en passant… on se marre si possible… puis on bascule dans le néant… sous les applaudissements des amateurs de comédies…
DDN : Merci infiniment pour tes réponses. Évitons de conclure. Laissons plutôt la parole aux deux amants : « C’est fou comme il ne nous est rien arrivé ou presque, à part : essayer de se donner rendez-vous et d’arriver de nouveau l’un vers l’autre sans fin et comme depuis le début à chaque fois. On n’a pas réussi. On a essayé. Parfois, c’était presque réussi, non ? »
- Nunzio D’annibale, Lire la Rivière, Bozon2X, avril 2024.