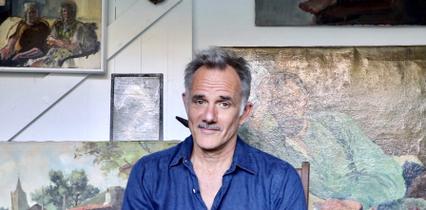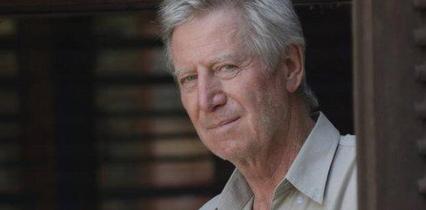Dans Physiquement, Sasha Georges s’intéresse à Dorian et Paula, deux frère et sœur. Leur trajectoire heurtée cache une vérité qui sera difficile à surmonter.
Les premières pages de Physiquement font sourire. En général, il y a deux types de livres difficiles à critiquer : les très bons et les très mauvais. Dans les deux cas, la question est la même, par quoi commencer ? Qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire quand il n’y a rien à ajouter (Reüssit) ou rien à sauver (Katastrof) ?
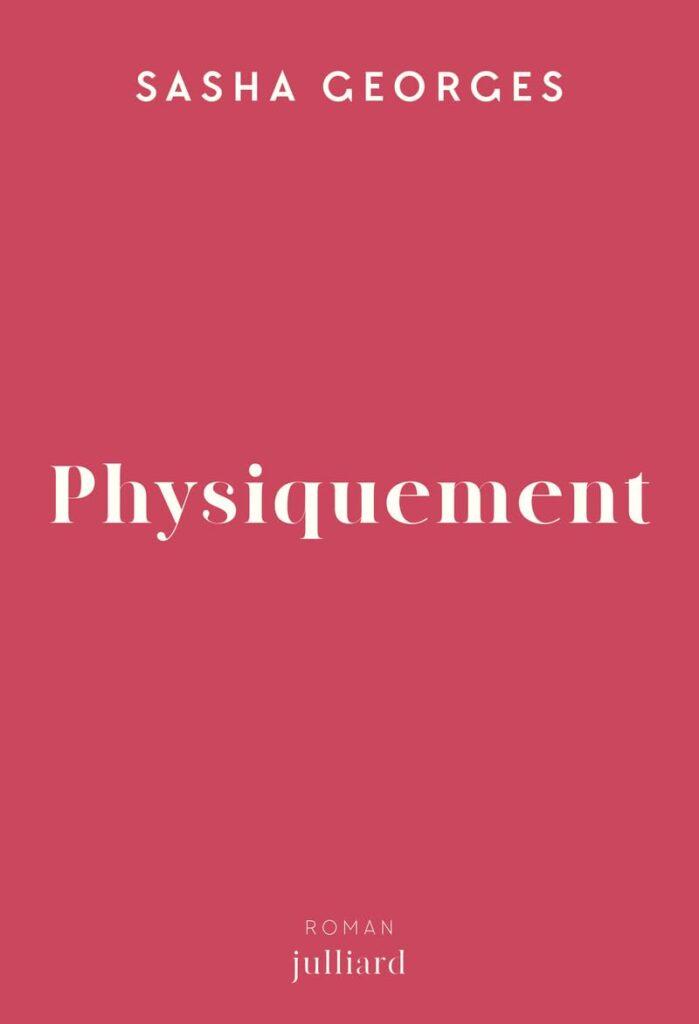
D., jeune homme paumé, veut tout quitter pour aller à Paris. Hélas, il possède une chienne. Il va donc balancer l’animal du haut d’une falaise. Puis appeler les pompiers pour qu’ils lui viennent en aide.
Balancer son chien du haut d’une falaise est dangereux pour la santé mentale
« Serrant encore les dents (mais ce n’était plus de froid), après avoir regroupé les pattes de Fréro, qui continuait à ne pas comprendre, D. jeta de toutes ses forces sa chienne devant lui, dans le vide. » La description de la mort de Fréro est aussi laborieuse que son agonie, et chaque étape fera formuler par D. son intention. La désorganisation et l’incohérence d’un personnage auraient pu être passionnantes si elles avaient été traitées avec inventivité, mais ici, D. semble commenter en temps réel son action, s’étonner de son incongruité (oh mince, mon chien est mort, que faire). On regrette aussi que la culpabilité et la sincérité dans le mensonge aient été écrites noir sur blanc : « Il pleura alors sur son épaule, désespéré, oubliant lui-même la vérité, sentant sincèrement en lui la stupeur, la tristesse et la culpabilité qu’il avait inventées. » Règle numéro 1 du grand Bernard Werber, homme d’affaires et vendeur de formations : show don’t tell.
Mais que le lecteur comprenne très vite de quel bois est fait son personnage paraît être une préoccupation majeure de l’auteur : concernant ce début, S. Georges admet dans l’émission La Relève avoir choisi une « scène de violence » très forte « pour camper le personnage ». Ce désir d’incarnation dès les premières pages a très certainement engendré le manque de subtilité auquel nous avons affaire. La scène manque de réalisme ? L’auteur s’en défend, et puis de toute manière, « on n’écrit pas non plus des romans pour faire du documentaire ».
Quoi qu’il en soit, le ton est donné, le livre aura pour sujet la réparation, la culpabilité. Selon S. Georges, les personnages sont dans « un désir de changer, de s’amender ». Dans l’émission de radio que nous venons de mentionner, il explique avoir voulu « ouvrir une conversation », en évitant de tomber dans quelque chose de « centre mou ». Il fait part de son désir de produire des situations, de créer un « qu’est-ce qui se passe quand on fait ça ». Forcément, ça met l’eau à la bouche.
D. est un personnage en fuite. Le choix du nom de la chienne n’est pas anodin. Fréro lui tend un miroir, miroir que D. ne supporte plus, d’où élimination, sans sommation. Car D. et Lala, l’autre protagoniste du roman, ont une relation particulière. Frère et sœur aux surnoms improbables (comme si, dès le départ, il avait fallu renommer, réinventer), les deux se cherchent, s’évitent. D. redevient Dorian quand son rôle d’agresseur n’est plus tu, et la question sera de savoir s’il sera accepté parmi les s...