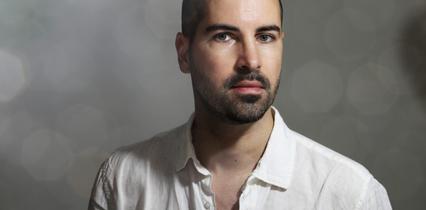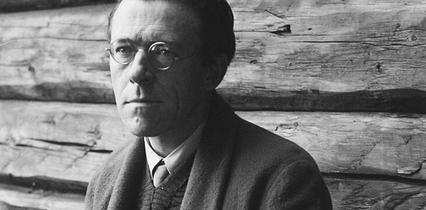«Je suis sensible aux gens qui m’environnent. Une image toute simple, dépouillée, mais qui montre la joie, le malheur ou l’hésitation d’un individu, c’est ce que j’aime. » dit Sabine Weiss. La photographe travaille la lumière et la matière fugace de l’atmosphère citadine pour nous offrir un témoignage sobre, principalement du Paris des années 1950. Ces clichés du quotidien, en noir et blanc, appellent la contemplation et la connivence, mais aussi une réflexion sur le statut de la photographie. L’exposition a lieu au Centre Pompidou, à la galerie des photographies niveau -1, jusqu’au 15 octobre 2018.

En ce moment devant le Centre Pompidou, et probablement de manière éphémère, on peut se faire photographier en noir et blanc : un quart d’heure le temps de développer la photographie argentique, et vous aurez votre portrait vintage. La reproductibilité à outrance grâce aux technologies numériques finit par lasser, la mode revient à l’objet particulier, chargé d’histoire, personnalisé. On déplore la perte d’une aura liée à l’unicité de l’image : la photographique numérique, banalisée puisque tout le monde peut tout prendre en photo avec son téléphone portable, participe de cette surabondance lassante de clichés sans beauté, sans technique, sans âme. Ainsi ce stand argentique vient à point nous questionner sur notre rapport à l’image, juste avant de visiter l’exposition « Les villes, la rue, l’autre » présentant le travail de la photographe Sabine Weiss, né en 1924.
Témoigner du quotidien.
La photographie humaniste témoigne de la France d’après-guerre à travers un regard sobre sur le quotidien des citadins : c’est une photographie proche des petits détails sans envergure de la vie des passants. Ainsi Sabine Weiss se veut témoin plutôt qu’artiste : cette démarche humble nous donne accès à des images sans prétention, souvent émouvantes par leur simplicité. On voit les habitants dans leur cadre de vie, qui n’est pas un simple décor mais autant que les personnages le sujet des photographies. Mais nous ne sommes pas dans l’ordre du seul reportage, les photos ont bien une valeur artistique propre : elles captent la lumière hivernale, les brumes, les ombres, les flous, les reflets, les fumées de la ville.
Cette captation d’atmosphères volatiles crée un sens du mystère : les photographies racontent de petites histoires, anecdotiques mais intéressantes parce qu’on voudrait en deviner la suite.
Cette captation d’atmosphères volatiles crée un sens du mystère : les photographies racontent de petites histoires, anecdotiques mais intéressantes parce qu’on voudrait en deviner la suite. Où va cet homme qui court ? Et cette marchande de frites, quel geste va suivre celui fixé par l’œil de la photographe ? A qui appartiennent ces ombres démesurées sur l’asphalte ? Intéressantes aussi parce qu’émouvantes : le photographe humaniste ne juge pas, son regard est celui de la compassion, il est moins à distance de la ville et ses habitants que partie prenante. La virtuosité technique du cadrage est au service d’une tendresse pour tous ces petits événements. Ce rapport intime au sujet permet paradoxalement de tendre à une certaine universalité, les gestes les plus anodins étant les plus communs à tous. Sabine Weiss photographie Paris mais aussi le Moscou de l’URSS et son folklore, ainsi que New York en mouvement.
« L’esprit noir et blanc de la ville » comme sens de la mémoire.

Se détacher des stéréotypes
Enfin, le spectateur contemporain ne peut regarder ces images sans avoir en tête la multitude de photos en noir et blanc vendues comme cartes postales pittoresques d’un Paris romantique et disparu. Le Baiser de l’Hôtel de Ville, ou encore les multiples photos d’écoliers des années 50 de Robert Doisneau, qui appartient lui aussi à la photographie humaniste, sont devenus des clichés. En cela, c’est bien un art populaire, qui atteint les masses. La photographie humaniste est facilement accessible de part cette tendresse du photographe pour son sujet. On en revient aussi au paradoxe de la reproductibilité : on a tellement vu ces images, que le noir et blanc et les vêtements des années 50 sont forcément liés à un passé fantasmé. Dès lors, rentrer en véritable dialogue avec ce genre de photos, y trouver ce qui me trouble, « me point » comme dirait Barthes est une nouvelle gageure. Pour le citer encore : « on dirait que la Photographie emporte toujours son référent avec elle, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein même du monde en mouvement ». C’est d’autant plus vrai pour les images que l’on a trop vu, qui sont devenues des emblèmes d’une époque.
On en revient donc à Sabine Weiss, qui nous dit quelque chose de nous et du quotidien émouvant d’une ville disparue, mais interroge aussi notre rapport au support photographique.
Mais c’est justement la captation du mouvement qui rend vivant le travail de Sabine Weiss, mouvement qu’elle saisit juste avant sa disparition. L’exposition elle-même tente un regard renouvelé en mettant en perspective le travail de Sabine Weiss avec celui de photographes contemporains : Lise Sarfati, Paul Graham, Viktoria Binshtok, Paola Yacoub. Cependant cet alliage paraît superficiel, le lien fait avec Sabine Weiss n’est que thématique, et ces épreuves contemporaines me paraissent assez anecdotiques, leur originalité technique parfois sans nécessité, ou déjà éculée. On en revient donc à Sabine Weiss, qui nous dit quelque chose de nous et du quotidien émouvant d’une ville disparue, mais interroge aussi notre rapport au support photographique.