Sœurs de plainte d’Alizée Vincent nous contraint à pousser la porte d’un commissariat et à entendre la voix des victimes s’accumuler, une voix souvent écrasée par le poids de la justice et des médias, mais qui trouve aussi un espace de résonance parmi celles qui ont vécu le même traumatisme. Ces voix ne se réclament ni de l’amitié ni de la solidarité militante, mais se construisent grâce à un lien brut, viscéral, entre co-victimes. Il ne s’agit pas ici d’une simple enquête journalistique, car Alizée Vincent met à nu des réalités bien plus complexes et nuancées, en dressant le portrait d’une communauté à la fois déchirée par la souffrance et unie par la reconnaissance d’une histoire et de douleurs communes.
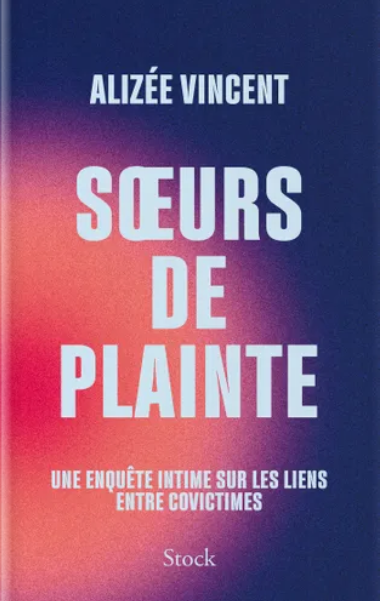
Vincent nous expose, dès le début, à la dure réalité des affaires médiatisées, comme celle de Patrick Poivre d’Arvor (PPDA). L’ouvrage commence sur ce terrain explosif où les plaignantes deviennent des pions dans une guerre d’opinions et de batailles médiatiques. Face à cette violente relatée, l’auteur interroge la manière dont les récits des victimes sont manipulés, diffusés et souvent vidés de leur sens au profit du scandale. C’est là une vérité glaçante qu’Alizée Vincent montre sans détour : les femmes qui dénoncent sont souvent reléguées au second plan, leur témoignage devient outil de débat public.
« Certaines – pas toutes – sont outrées. Effondrées même. L’une me confie plus tard qu’elle n’aurait pas porté plainte si elle avait su qu’il y avait le moindre risque que des journalistes publient le récit qu’elle a livré aux autorités ». Ce moment expose crûment la dissociation entre la parole intime des victimes et son instrumentalisation par des forces extérieures. La plainte, qui devait être une voie vers la réparation, devient au contraire une arme retournée contre celles qui l’ont déposée. La force de ce passage réside dans sa simplicité glaçante : une décision de justice, un reportage, et la vie d’une femme qui s’écroule sous le poids de cette médiatisation.
Les institutions face à la sororité de la plainte
L’injustice systémique liée à la pluralité des victimes est soulignée avec une force particulière : qu’il y ait une ou cinquante victimes, la loi française reste aveugle à la sérialité des crimes sexuels. Comme l’explique Alice Géraud dans son thread du 8 mars 2023 sur X : « Aujourd’hui, la peine maximale de prison pour un violeur est indifférente au nombre de ses victimes. Qu’un homme ait violé deux, trois ou cinquante personnes, il encourra la même peine. Vingt ans pour des viols aggravés. » Cette absurdité reflète un « impensé juridique », une absence de prise en compte qui transforme la justice en « machine à fabriquer de l’impunité. » Un homme qui multiplie les agressions « ne risquera pas plus devant la justice », et les vies détruites se fondent dans une abstraction, n’existant plus qu’à travers une peine unique. En sœurs de plainte, elles ne deviennent qu’une seule entité, leur bourreau ne pouvant être condamné pour l’intégralité et la sérialité de ses actes.
La quête de justice transparaît, accompagnée de toutes ses difficultés : en réalité, les femmes se heurtent à des institutions froides et souvent indifférentes. « Ce n’est pas vous qui êtes classée sans suite. C’est le dossier qui l’est. » La justice, telle qu’elle est décrite ici, est une machine qui broie les récits en les recevant, les réduisant alors à de simples numéros de dossiers.
Le livre se veut alors exploration de cette déshumanisation constante, de cette douleur qui découle non seulement des crimes eux-mêmes, mais aussi du processus judiciaire qui suit, dans ce qui apparaît alors comme une double peine.
La naissance d’une sororité de survivance
Au cœur de l’ouvrage, Vincent s’attarde sur la dynamique profondément humaine des co-victimes. Cette sororité étrange, née de la douleur partagée, devient un moteur puissant pour la survie émotionnelle des victimes. Mais cette sororité est partagée, et loin de n’être qu’une alliance bienveillante. Elle est traversée par la culpabilité, la colère, parfois même la jalousie. Ces femmes, unies dans leur dénonciation d’un même agresseur, se trouvent confrontées à la douleur des autres et, en reflet, à leur propre douleur.
Clara, l’une des voix importantes du livre, raconte à Vincent son propre traumatisme, avec cette distance qui semble être le résultat d’années de refoulement. Ce moment, où une victime reconnaît sa douleur à travers le témoignage d’une autre, marque une rupture : « Grâce aux co-victimes, “j’ai compris que je n’étais pas folle”. » C’est là une forme de réappropriation de soi, une reconnaissance du vécu que la société avait tenté d’effacer.
Mais ce lien entre co-victimes est aussi teinté d’une culpabilité presque tacite, sournoise, souvent à pein...

















