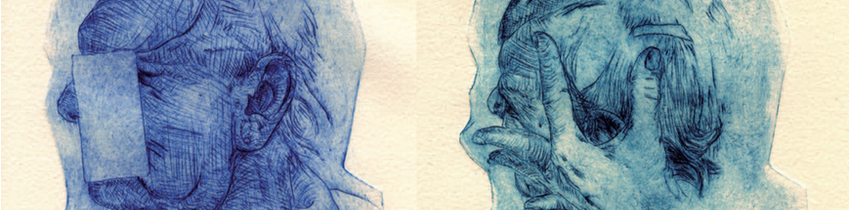” C’est un lecteur déçu par vos idées, mais admiratif de la beauté de votre premier livre, qui vous parle. À dire vrai, c’est même la seule raison de cette lettre ouverte. Comment l’auteur de Sous l’œil des barbares a-t-il pu se perdre en si bon chemin ? “. Lettre ouverte à Maurice Barrès par Tarik Otmani.

Monsieur Barrès,
La convention ancestrale, qui voudrait que l’on nomme cher le destinataire d’une lettre personnellement adressée à lui, ne me sied pas. Notamment, lorsqu’il s’agit de vous. Si vous pouviez me lire du fond du purgatoire, dont l’existence est désormais plus qu’extravagante aux yeux de quelqu’un qui a tourné le dos à la foi, sans doute seriez-vous surpris que l’on vous adresse une lettre ouverte depuis le monde d’ici-bas. Ou, d’au-dessus : l’inconvénient, dès les lisières de l’éternité, est que l’on ne sait plus où l’on est et cela au moment même où l’on commence à s’en approcher.
Pour tout vous dire, et malgré votre incapacité à m’entendre : on ne vous regrette pas. Lorsque je dis on, je parle de ceux qui suivent des façons de vivre et de penser qui demeurent aux antipodes de la votre depuis toujours et qui malgré tout bâtissent des cultures, des civilisations. Vous n’y comprendriez rien, et cela serait tout à fait attendu, compte tenu de votre dogmatisme légendaire. Puisque l’on est toujours, pour reprendre l’adage populaire, l’idiot de quelqu’un : un barbare s’adresse ici à un autre barbare.
Malheureusement pour nous, sachez que vous avez engendrez des émules, des disciples à vos errances métaphysiques qui continuent à faire mariner la France dans la fange, dans la boue que vous lui avez minutieusement préparée depuis votre laboratoire de vieux maître jaloux de la gloire idéale à laquelle il aspire. Le moins que l’on puisse dire est que vous vous y êtes attelé avec acharnement. Quant à votre progéniture, vous seriez fier de l’ardeur avec laquelle elle s’évertue à suivre la moindre subtilité intrinsèque à vos aberrations. Seulement, à l’instar des élèves de terminale de Paul Bouteiller dans vos Déracinés qui, sous l’influence de leur professeur, élèvent la dynamique intellectuelle de Kant au rang de manière d’être, la vanité de vos petits monstres d’aujourd’hui va jusqu’à faire de la France bonapartiste un âge d’or et de Charles Péguy un moderne. Ce début de XXIème siècle est décérébré, certes : mais, il ne faut pas en rajouter non plus. C’est un signe de civilité que de savoir imposer des limites à la sottise. Surtout lorsqu’elle provient des autoproclamées élites intellectuelles : l’obsession des âmes trop exaltées est de faire, de leur propre terre, un exutoire à leurs folies.
Dans l’enceinte de votre œuvre littéraire, nous évoluons page après page comme des spectateurs abasourdis qui assistent à la démence d’un enfant qui construirait encore et toujours une infinité de châteaux, à partir de branches d’arbres et de voiles, dans sa propre chambre verrouillée. Une aberration, vous disais-je, un ratiocinement à l’infini qui se recroqueville sur lui-même à partir d’une obsession initiale qui promettait, au contraire, tout le long de ses réalisations différenciées, une ouverture illimitée à chaque instant de vie ; la liberté : malgré votre tempérament despotique, vous la convoitiez indéfiniment. Avec la même frénésie que celle d’un soit-disant maître de vertu qui ne peut s’empêcher de s’enflammer de désir devant des petits garçons pêcheurs rendus en confesse. L’image vous ferez horreur : je sais qu’il est déplaisant de voir le reflet de soi sous un jour que l’on ne désirait pas. Seulement, au même titre que les curés, les prêtres ou autres imposteurs encore qui ne comprennent rien à la sexualité décomplexée, vous ne compreniez rien à la liberté. Ce qui, effectivement, pour vous, l’auteur du Culte du moi, est un grand inconvénient. Votre liberté n’est que phraseuse, péremptoire : du verbiage naïf. Et, en aucun cas innocente, non : elle est tout simplement d’une puérilité affligeante. Comme je goûte peu les conventions, et spécialement à votre égard, je commencerai par le dernier tome du Culte du moi.
Le Jardin de Bérénice me tombe des mains. Encore aujourd’hui. Vous me diriez qu’il est intellectuellement malhonnête de parler d’un livre que l’on n’a pas lu intégralement : je vous répondrais que la bêtise de sa proposition suffit à en interrompre la lecture sur le champ. Pour le lecteur intéressé de l’Examen de conscience philosophique que je fus, je puis vous dire que la voix que vous prêtez à Ernest Renan au début de votre ouvrage est d’une insipidité inouïe, doublée d’une lâcheté de votre part désarmante, puisque vous vous êtes manifestement beaucoup amusé à mettre dans la bouche de Renan des connexions logiques, ce qui n’est le propre que de votre seul esprit cloisonné (du reste, suivant ce nouvel adage populaire selon lequel « on apprend à tout âge » et même de la part d’individus plus jeunes que vous, vous apprendriez vraisemblablement que différents chemins intellectuels, employant différents mécanismes logiques à différents moments de nos réflexions, peuvent conduire également aux mêmes points.) Mais, pour l’essentialiste atomiste que vous étiez, vous m’auriez vraisemblablement vu comme une sorcière à brûler immédiatement. À tel point que la moindre menace d’une contradiction à votre égard offensait votre sentiment de pouvoir intellectuel sur la France. Permettez-moi de rajouter ceci : il suffit au pouvoir d’avoir le sentiment de la perte pour qu’il s’autodétruise lui-même malgré tout ses efforts désespérés pour maintenir l’illusion de sa pérennité. Il n’est plus qu’une vieille relique devant laquelle des idiots nous obligent à nous prosterner. Jusqu’à se rendre compte de l’angoisse à laquelle ils étaient aveuglément restreints. Ingrats, ils dissimulent leurs torts derrière d’autres idoles à vénérer encore, bêtement ; mais, ils nous épargnent du moins un temps de leurs passions dissipées. Au rythme balbutiant qu’adopte le début de notre ère démocratique, cela nous offre une dizaine d’années de répit. Guère plus. Au-delà, pour emprunter à Kant, dans son Projet de paix perpétuel, l’un des plus grands maux politiques qui soit : dès l’élaboration de nos traités de paix imparfaits, nous préparons déjà des motifs de guerres futures.
Au-delà, pour emprunter à Kant, dans son Projet de paix perpétuel, l’un des plus grands maux politiques qui soit : dès l’élaboration de nos traités de paix imparfaits, nous préparons déjà des motifs de guerres futures.
Revenons au Culte du moi (puisque, tel est le titre que vous avez choisi d’inscrire au frontispice du premier volet de vos œuvres littéraires). Son second tome, Un homme libre, qui narre la pseudo éducation sentimentale et intellectuelle de deux jeunes hommes exaltés est, à nouveau, d’une stupidité inqualifiable. Comment des jeunes gens instruits, désirant parfaire leurs humanités de savoirs pratiques, peuvent-ils demander une simple consultation à un médecin pour développer leurs connaissances du corps humain ? Pourquoi le souci moral, chez vos personnages, se décline-t-il seulement sous le joug de l’orgueil ? Quelle liberté d’esprit trouviez-vous dans vos éloges niais de Benjamin Constant et Sainte-Beuve ?
« Moi, c’est d’instinct que j’adore Benjamin Constant. S’il était possible et utile de causer sans hypocrisie, je me serais entendu, sur divers points qui me passionnent, avec cet homme assez distingué pour être tout à la fois dilettante et fanatique. » (Un homme libre)
Vous vouliez en faire des cultivés en herbe : vous avez fait d’eux des décérébrés naissants. Vos personnages, qui veulent se présenter comme des modèles, ne dépassent jamais la bêtise des capricieux bougons qui, du haut de leur idiotie, se croient être au sommet de l’humanité.
Pourtant, votre premier ouvrage, le premier tome de votre Culte du moi, intitulé Sous l’œil des barbares, était plus que prometteur. C’est un lecteur déçu par vos idées, mais admiratif de la beauté de votre premier livre, qui vous parle. À dire vrai, c’est même la seule raison de cette lettre ouverte. Comment l’auteur de Sous l’œil des barbares a-t-il pu se perdre en si bon chemin ? Et par ailleurs, s’entêter à suivre alors une route si détestable ? La célébrité, la gloire, la considération de vos contemporains ? Vous, qui condamniez cette complaisance indésirable, vous êtes tombé bien bas. Cela reste votre pêché originel : vous aviez confectionné les armes pour vous en affranchir, et ne vous en êtes jamais servi ; au contraire, vous les astiquiez délicieusement puis les jetiez au feu pour demeurer seul, impuissant, en la compagnie de vos propres démons. Vous les adoriez et vous ne pouvez le niez. Nécessairement, du fond du silence de votre trépas où vous êtes devenu poussière, il n’y a rien à répondre à cela : seulement subir les dégâts que vous avez provoqués.
Comme tout post-romantique grossier qui sacralisait infiniment la mélancolie, elle suffisait à vos yeux pour justifier les sentiments de supériorité et de mépris à l’égard des autres : vous avez longtemps gardé les sentiments d’un adolescent de quinze ans. Plût-il à votre sagacité que vous eusse compris à la suite d’Aristote que la mélancolie est une porte ouverte aux choses de l’esprit, et qu’elle devinsse alors le véhicule de « l’amor fati » cher aux Stoïciens qui faisaient de « l’acceptation des faits » à la fois une règle cardinale et une thérapie vertueuse à appliquer perpétuellement à soi-même. Mais, vous en étiez bien loin. Et, malgré les souffrances idéalistes de Philippe, dans Sous l’œil des barbares, vous jubiliez aussi de vos propres maux : ce n’était pas la peine de les répandre en-dehors de votre crâne enfiévré pour nous les faire subir. Comment l’auteur de ses premières phrases sublimes a pu se perdre dans les vertiges de l’ordre autoritaire que nous subissons encore aujourd’hui ?
« Le jeune homme et la toute jeune femme dont l’heureuse parure et les charmes embaument cette aurore fleurie, la main dans la main s’acheminent et le soleil les conduit.
— Prenez garde, ami, n’êtes-vous pas sur le point de vous ennuyer ?
Sur ses lèvres, son âme exquise souriait au jeune homme, et les jonquilles s’inclinaient à son souffle léger.
— N’espérons plus, dit-il avec lassitude, que ma pâleur soit la caresse livide du petit jour; je me trouble de ce départ. Jadis, en d’autres poitrines, mon cœur épuisa cette énergie dont le suprême parfum, qui m’enfièvre vers des buts inconnus, s’évapora dans la brume de ces sentiers incertains.
De ses doigts blancs, sur la tige verte d’un nénuphar, la jeune fille saisit une libellule dont l’émail vibre, et, jetant vers le soleil l’insecte qui miroite et se brise de caprice en caprice, ingénument elle souriait. — Mais lui contemple sa pensée qui frissonne en son âme chagrine. » (Sous l’œil des barbares)
Vous avez fait, de l’expérience esthétique, un mal inguérissable. C’est votre principale faute : elle porte, au contraire, les sensations jusqu’au dédoublement de soi, où l’on s’objectivise. Acteur de notre propre existence, elle nous permet en même temps d’en être le spectateur critique, et d’alors perfectionner notre propre partition. Mais, vous n’avez cessé de vous détourner de cette voie pour explorer avec gourmandise les errances de l’âme et les déposer alors sur un piédestal devant lequel des milliards de personnes, au détriment de vous lire, continuent d’adorer les enfantillages intellectualistes auxquels vous vous êtes voués, et que votre héritage perpétue. À tort. Le Maître, dans votre premier livre, tient des propos qui condamnent ce que vous êtes précisément vous-même évertuer à devenir ; le comble d’une ironie macabre, qui ne cesse de nous étouffer, sous sa grandiloquence pathétique.
« J’en sais qui aiment leurs tortures et leur deuil, qui n’ont que faire des charités de leurs frères et de la paix des religions ; leur orgueil se réjouit de reconnaître un monde sans couleurs, sans parfums, sans formes dans les idoles du vulgaire, de repousser comme vaines toutes les dilections qui séduisent les enthousiastes et les faibles ; car ils ont la magnificence de leur âme, ce vaste charnier de l’univers. » (Sous l’œil des barbares)
Fallait-il, pour autant, faire de l’âme une déchetterie sans cesse grandissante, envahissante ? De la mélancolie, vous vous êtes abaissé au nihilisme, et vous fîtes ainsi de la perpétuité de la vie une déclinaison du néant
Fallait-il, pour autant, faire de l’âme une déchetterie sans cesse grandissante, envahissante ? De la mélancolie, vous vous êtes abaissé au nihilisme, et vous fîtes ainsi de la perpétuité de la vie une déclinaison du néant. Dieu lui-même, chez vous, est un destructeur qui dissout sa soit-disante pureté et sa soi-disante perfection, dans son exigence de la création de l’Univers. Plutôt que de vous perdre dans vos labyrinthes morbides, il valait mieux devenir athée, voir le monde tel qu’il est, et penser l’humain autrement que comme une dégénérescence barbare qu’il fallait instruire à force de fatuité. À Paris, à quoi s’adonne Philippe ? Au dilettantisme, aux mondanités, à l’art, à l’amour. Vous auriez dû en rester là. Et sans doute, au fur et à mesure, auriez-vous compris que l’expérience esthétique ouvre elle-même aux promesses de grandeur, de bonheur, d’émancipation de soi-même. Le Moi ? L’Identité ? La Nation ? Ne vous fatiguiez-vous pas, vous-mêmes, de toutes ces puérilités ? L’Autre, l’Ailleurs, le Monde : ce projet est tout de même bien plus estimable ; jusqu’à ce que l’on prenne conscience, qu’à travers notre quête de l’autre et de l’ailleurs, on ne rencontre finalement que différentes figures de l’ici et du moi. Les possibles vous angoissaient : plutôt que de vous confronter courageusement à cette angoisse, vous vous êtes vous-mêmes momifié derrière le masque pâle d’une sacralité ancestrale, que vous avez non seulement échouer à ressusciter, mais aussi à parfaitement identifier. Votre échec est retentissant.
Malgré tout, Barrès, sauvons de votre naufrage votre premier ouvrage et à l’image des vanités qui, derrière la beauté des fruits et des fleurs, dissimulent la mort à l’œuvre, contemplons encore, inlassablement, ce que Sous l’œil des barbares contient de plus beau et de plus vrai.
« Je sais que ce fut mon tort et le commencement de mon impuissance de laisser vaguer mon intelligence, comme une petite bête qui flaire et vagabonde. Ainsi je souffris dans ma tendresse, ayant jeté mon sentiment à celle qui passait sans que ma psychologie l’eût élue. Le secret des forts est de se contraindre sans répit.
Je sais aussi, — puisque le décor où je vis m’est attristé par mille souvenirs, par des sensations confuses incarnées dans les tables du boulevard, dans les souillures de ce tapis d’escalier, dans l’odeur fade de ce fiacre roulant, — je sais des endroits intacts où veillent mille chef-d’oeuvres, et quoique j’ai toujours éprouvé que les choses très belles me remplissaient d’une âcre mélancolie par le retour qu’elles m’imposent sur ma petitesse, je pense qu’une syllabe dite doucement les passionnerait.
Je sais, mais qui me donnera la grâce ? qui fera que je veuille! O maître, dissipe la torpeur douloureuse, pour que je me livre avec confiance à la seule recherche de mon absolu.
Cette légende alexandrine, qui m’engendra autrefois à la vie personnelle, m’enseigne que mon âme, étant remontée dans sa tour d’ivoire qu’assiègent les Barbares, sous l’assaut de tant d’influences vulgaires se transformera pour se tourner vers quel avenir ? » (Sous l’œil des barbares)
Vers le notre, au détriment de celui que vous avez connu et qui nous assiège encore. – Adieu, Barrès : mon projet est à présent, armé de votre premier livre, d’aller verser du mauvais vin sur votre tombe ; je garde pour ma part les meilleurs pour encore me consacrer, savoureusement, à la lecture de Sous l’œil des barbares.