Tant qu’il reste quelque chose à détruire est un recueil de poèmes de Mag Lévèque qui aborde la question du viol, du statut de victime et de ses répercussions. L’autrice, qui s’inspire d’une phrase un jour partagée par sa sœur, se sert ainsi de la littérature comme un moyen d’attester sa vérité et de revenir à elle-même. Ce recueil mêle intime et politique, difficultés et récupération de soi. Mag Lévèque y explore les symptômes de stress post-traumatique, le rapport à soi, tout comme les conséquences sociales de ce crime destructeur – où les mots sont les armes d’une bataille d’une survivante combattante.
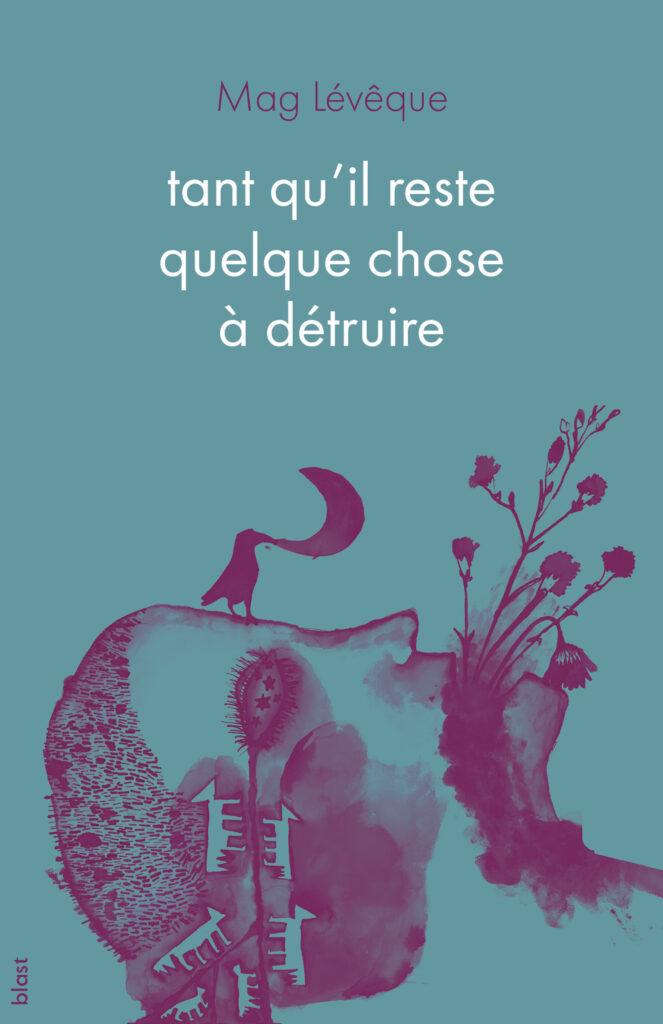
Le livre est avant tout la construction progressive d’un témoignage des violences rendues vivantes grâce à l’écriture thérapeutique. Cette écriture, difficile car elle entraîne la réminiscence de souvenirs enfouis, permet de survivre à l’horreur et de récupérer une partie de ce qui a été perdu, presque cambriolé par l’horreur. Si elle se sent « vidée du dedans », « vidée » de sa « substance », l’autrice se reconstruit néanmoins grâce à la force des mots du dehors qui viennent vider les maux du dedans.
Perceptions troublées
Les conséquences psychologiques d’un tel acte occupent une majeure partie du récit, car l’autrice rend compte des répercussions ressenties sur son corps et son esprit : « ça s’appelle le stress post-traumatique », écrit-elle. Elle rend ainsi compte de l’impression d’être « ravagée par un séisme », étant constamment rattrapée par les horreurs subies qui se substituent à sa réalité. « Je me réveille enfermée dans une cage de verre mais personne ne la voit » : les autres, veulent-ils donc plutôt fermer les yeux ?
Les interactions sont, elles aussi, bousculées par la réalité du viol insérée dans la vie quotidienne. Le déni n’est ainsi pas uniquement celui de la victime, mais également des personnes qui l’entourent. Par exemple, sa mère pense toujours que l’agresseur est un être « exceptionnel », cette horreur commise n’empêchant rien à la qualification et à la valorisation du bourreau. Elle questionne ainsi l’incapacité des proches, et de la société entière, à réellement écouter les récits de victimes de violences sexuelles.
Face à cette réalité en décalage avec la sienne, l’autrice développe une nouvelle identité pour remplacer celle que personne ne veut voir, tout comme elle-même ressent le besoin de s’échapper de ces symptômes paralysants. En raison du viol subi, elle devient une « zone occupée », vivant à l’extérieur d’elle-même, en même temps qu’elle ressent le besoin de construire « un monde » autour « de son lit » pour que son agresseur ne puisse plus l’atteindre.
Réalité et fantasme finissent ainsi par se confondre et perturber le rapport de la protagoniste, double de l’autrice, à l’existence. Dans ces projections, elle devient capable de « frapper » son bourreau, tandis que, dans la réalité, « une grenade explose sous [ses] pieds ». La narratrice rend ainsi compte de la rupture présente entre son monde intérieur et ses perceptions réelles ; elle, qui voudrait tant pouvoir se venger pour se retrouver, combattre le passé pour revenir dans le présent. Malgré tout, le « fantôme » de son bourreau continue à la poursuivre, car elle a « peur » de « trouver [son] fantôme dans [son] lit ». Silencieusement, le traumatisme devient une toile de fond de sa réalité en ouvrant la voie au fantasme et à l’irréalité, l’un permettant de survivre à l’autre et l’autre étant un obstacle récurrent face à la récupération de soi.
Les perceptions intérieures et extérieures se troublent ainsi et rendent compte de la réalité des victimes de viol qui sont engagées malgré elles dans un combat perpétuel qui, injuste, finit par s’imposer et les dépasser.
Les perceptions intérieures et extérieures se troublent ainsi et rendent compte de la réalité des victimes de viol qui sont engagées malgré elles dans un combat perpétuel qui, injuste, finit par s’imposer et les dépasser.
Répétition et destruction
La cage de verre devient un refuge perpétuel pour l’autrice qui, ne trouvant pas de place pour sa réalité dans son univers social, finit par s’abriter dans cet endroit intérieur que personne ne voit. Cela entraîne des conséquences douloureuses : seule face à elle-même, elle devient seule aussi face à son traumatisme. Car « l’automne, c’est chaque année la saison du viol » : chaque année est ainsi marquée par l’événement traumatique qui semble se répéter à l’infini, comme la douleur et la peur, jointes au silence, finissent par se frayer un chemin et s’imposer. La répétition, notamment engendrée par les symptômes de stress post-traumatique, devient celle d’une douleur constamment retrouvée, le temps réparateur se transformant en un temps destructeur – pourtant, il reste toujours quelque chose à détruire.
De la reconstitution à la reconstruction
Les mots d’abord qui, dans la course effrénée d’un retour à soi désormais possible par l’écriture, montrent que l’écriture est une arme de révolte. « Je parle en écrivant pour détruire ceux qui nous détruisent », écrit-elle alors, conduite à l’écriture pour redevenir actrice de son histoire et, par extension, pour permettre à d’autres de retrouver la leur, de combler les vides créés par la douleur avec des mots salvateurs. Le récit devient alors celui d’une multitude, s’adressant à l’autrice elle-même, mais également à toutes les personnes en quête de leur propre voix. Elle invite ainsi chaque victime à prendre part à la bataille menée sur ces pages : « je ne mourrai avant de me venger et de venger le peuple de celles et ceux qui ne s’appartiennent pas ». Ces poèmes se transforment ainsi en armes réclamant réparation et finissent par représenter tant d’autres voix – ils tendent vers l’expression d’une universalité classée sans suite.
En effet, le récit s’adresse aussi à une autre foule : la société tout entière. Cette société est appelée à se regarder en face, invitée à être déconstruite pour peut-être se reconstruire sur des bases plus saines.
- Tant qu’il reste quelque chose à détruire, Mag Lévèque, éditions Blast, 2022


















