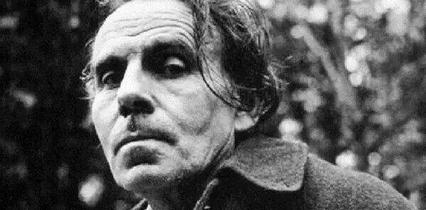Inépuisables sujets de contemplations, toutes les périodes de Vincent van Gogh ont été fouillées jusqu’à l’os. Il est donc surprenant que le séjour à Auvers-sur-Oise ne fusse jamais prétexte à une exposition d’une telle ampleur. À travers les œuvres présentées, le spectateur opère la dissection des dernières semaines de l’artiste, où, malgré les lenteurs de la campagne qu’il représente, l’on voit son destin s’accélérer. Le Musée d’Orsay accueille jusqu’au 4 février un ensemble exceptionnel de 45 tableaux et d’une vingtaine de dessins de la main du peintre ; une exposition d’une grande richesse qui condense les deux derniers mois de sa vie jusqu’à son suicide, le 27 juillet 1890.

Devant la cohue ardente de smartphones et de bouches ouvertes se joue le dernier acte d’un curieux personnage, pleurant de grasses larmes saturées de couleurs.
Après le séjour d’une année entière à l’asile de Saint-Rémy de Provence et plusieurs crises de démence, Vincent van Gogh, jugé « guéri », quitte le midi pour Auvers-sur-Oise. Le docteur Paul Gachet, que Pissarro lui a présenté quelques temps plus tôt, l’y accueille. Il trouve en lui une sorte de double dont il perçoit la profonde affliction. Son portrait, présenté dans la première salle de l’exposition, accueille les visiteurs en gardien relâché, flanqué d’un autoportrait du peintre et d’une Pietà d’après Delacroix. Vincent lui donne l’attitude d’un homme triste, les yeux pâles et lactescents, appuyant sa joue contre son poing pour supporter la pesanteur des bleus qui le poussent vers l’avant, comme des vagues de spleen. Intelligemment placé en comité de bienvenue, le docteur Gachet incarne l’une des dernières étapes du chemin de Van Gogh vers l’abandon définitif — son dernier souffle.
Pourtant, désormais hors de l’asile, Vincent espère encore par éclaircies. C’est d’ailleurs le pan négligé de sa peinture, au profit de l’idée très romantique qu’il peint pour se soulager de l’insupportable ; Vincent dessine, croque, ébauche, tout simplement parce qu’il veut aimer cette vie. Contredisant la mélancolie qui le dévore — que d’aucuns qualifieraient aujourd’hui de dépression chronique, schizophrénie, trouble bipolaire — il s’accroche de toutes ses forces à la beauté simple des jours naturels, à ces toits de chaume d’Auvers qui lui rappellent son Brabant natal. Il lutte, jusqu’à peindre soixante-douze huiles en deux mois. On le sent dans les spirales du ciel, les touches plus ou moins épaisses, plus ou moins profondes et plus ou moins rapides qui animent les formes et le mouvement ; et tout l’amour qu’il portait à la peinture ressort dans cette impérieuse frénésie de se saisir de l’espace. C’est proportionnellement à ses souffrances intérieures qu’il lui était nécessaire d’agripper la vie au collet, et de lui dire, d’une voix qu’on imagine légèrement brisée : « Reste ».

Tant de fois il l’a sentie glisser hors de lui, lors de ses crises brutales, terrifié par l’abandon et l’insuffisance. Ses deux derniers mois à Auvers sont marqués par la crainte d’une rechute, pesant sur lui comme un couvercle trop lourd. Malgré tout, selon les recommandations du docteur, il travaille à son art. La naissance de son neveu, tendrement prénommé Vincent, provoque des sentiments contraires chez l’artiste ; il sent que désormais, son frère Théo ne sera plus aussi disponible qu’il le souhaiterait.
Voilà tout ce que l’on retrouve dans cette exposition : la volonté de s’oublier, de se dissoudre par le regard, l’humilité, la solitude, mais aussi l’angoisse, la maladie, la détestation de soi, la mort. On circule dans les salles comme l’artiste dans le village, et les paysages s’allongent, se répondent, se reflètent. Le même langage admiratif de l’herbe, des ruisseaux et des champs évolue au fil de son dernier été vers des contrastes plus doux. Pour Vincent, Auvers est plus évanescente que Saint-Rémy ; plus intense aussi. Il voit dans l’éruption des villas modernes au milieu des « vieux chaumes qui tombent en ruine » une allégorie de son époque qui le fascine. Tout se mélange dans les touches de bleu, de jaune et de vert, jetées rapidement sur la toile pour exprimer l’infernale cadence d’un siècle qui se referme sous ses yeux et dont il veut, à tout prix, s’échapper.
« Gravement beau »
Bien vite, l’endroit qui ressemblait à un avenir se change en mur. La correspondance qu’il entretient avec son frère et la femme de celui-ci montre à quel point l’artiste a tenté de mesurer ses paroles et de filtrer les informations sur son état de santé. Parmi les lettres qu’il n’envoie pas, il détaille l’immense fatigue qui le plie en deux, l’impossibilité qu’il trouve à se projeter ou à ressentir du plaisir. Dans ses mots comme dans ses œuvres, il y a cette sorte de pieux mensonge qui n’inquiète pas, bien caché sous la vitalité de la palette, la fraîcheur des fleurs, la mouvance des impressions qui tournent comme des soleils. Vincent convoque tout ce qu’il se souhaiterait dans ses toiles d’Auvers : le souvenir des maîtres anciens qu’il admire et qu’il aime en pères spirituels, brillants, joyeux, perpétuels ; une femme, des enfants, une famille, les plantes toujours saines, les passages toujours ouverts, les champs toujours féconds, une existence simplifiée dans ses formes, dans ses lignes, dans ses couleurs. Tant qu’il les observe et qu’il les peint, il peut les vivre ; mais il sait qu’ensuite, ils lui glisseront des doigts, et il faudra en faire d’autres.
L’ultime décor qu’il s’est choisi est « gravement beau ». Chez lui, la notion de gravité est profondément reliée à la figure humaine : ses portraits ont des yeux de sphinx, distants, cryptiques, et toutes les silhouettes des champs l’ignorent, complètement absorbées par leurs occupations. Van Gogh ne se sent pas exister dans ce monde. Il est un fantôme qui arpente la vie en spectateur ; l’autre est soit inhumain, soit irréel, soit accablé. Dans cette ambiance taiseuse, il n’y a que des impossibilités, et de ce silence si éloigné de toute charité, Vincent souffre beaucoup. Il voyait sa renaissance dans la nature et ses moirages, mais cette nature même s’assombrit.

Dans ses compositions, les horizons sont souvent surélevés ; au fur et à mesure qu’ils se referment, il devient difficile de penser qu’ils parlent encore d’espoir. On y voit l’oppression, l’infranchissable. Sous ces collines scellées à la voûte, les éléments se répartissent dans un effet d’élongation qui caractérise la fin de sa vie, le format en double carré. Procurant un effet de stabilité, ce type de panorama est utilisé par Van Gogh pour souligner la constance de sa solitude et de sa tristesse. Dans son œuvre Pluie — Auvers-sur-Oise, les effets bleutés des lointains et la grande ouverture que représente la toile sur le champ mouillé donnent au spectateur la sensation de se tenir aux côtés de Vincent, sous un parapluie. On entend le crépitement de l’eau qui s’écrase sur le tissu, éclate dans les flaques et claque contre le champ moissonné ; et l’odeur de pétrichor, de terre et de cheveux humides se fait certaine. Pluie a de la tendresse sans parole, sur fond de laquelle l’averse se répète en écho, réactivée par un regard. Rien ne trouble la pureté de la scène, proche d’un souvenir d’enfance où l’on est surpris par la pluie sur les chemins de la maison — rien, sinon un corbeau aux ailes déployées, au centre de la toile. Il part rejoindre les autres de l’autre côté de la salle, dans l’immense champ de blé au ciel mauvais, virant au bleu sombre.
Racines est la dernière. Le ciel est annulé. Il n’y a plus d’horizon quand on regarde vers la terre. Aux limites de l’abstraction, le point de rupture est atteint : le monde réel achève sa décomposition pour n’être que rubans et lacérations de couleur, comme la vision qui se trouble au cours d’un malaise. La tête penchée vers le sol, Vincent a à tout jamais abandonné l’amour qu’il recherchait, pourtant si sensible dans ses paysages onctueux, pulsant sous la chair en nervures éclatantes.
Dans la substantifique douleur de vivre qu’il ressentait, Vincent van Gogh, que l’on a envie de n’appeler que Vincent, a poussé la brillance jusqu’à la combustion. Il se savait condamné à vivre ; il n’aurait pas pu deviner, pourtant, que cela commencerait après sa mort.
Celui qui voyait « la possibilité d’une nouvelle peinture » s’est arrêté au seuil d’un nouveau cycle. Après une carrière éclair, dix ans environ, cet artiste à l’évolution phénoménale, lancé à vingt-huit ans et suicidé à trente-neuf réunit encore sous l’égide consolatrice des humbles lumineux. L’exposition du Musée d’Orsay permet un regard complet sur son œuvre, qui pourrait être comprise entièrement seulement sur ces deux derniers mois à Auvers. Il a tout compressé, densifié, augmenté, comme s’il avait eu le désir de se répéter une dernière fois pour bien se faire comprendre.
Dans la substantifique douleur de vivre qu’il ressentait, Vincent van Gogh, que l’on a envie de n’appeler que Vincent, a poussé la brillance jusqu’à la combustion. Il se savait condamné à vivre ; il n’aurait pas pu deviner, pourtant, que cela commencerait après sa mort.
Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise : les derniers mois au Musée d’Orsay, jusqu’au 4 février 2024
Illustration : Vincent van Gogh, Racines, 27 juillet 1890, huile sur toile, 50x100cm, Van Gogh Museum, Amsterdam.