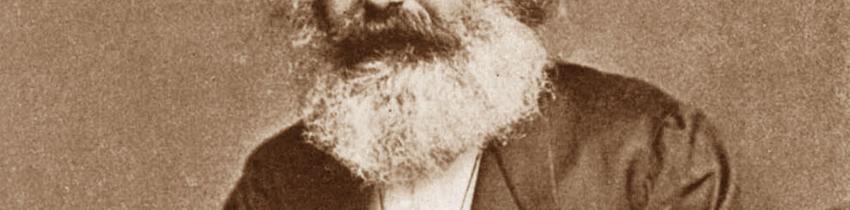Les nuits de novembre 2005 ont laissé dans l’air une odeur de cendres et de métal brûlé. Pendant trois semaines, la France a vu ses banlieues s’embraser, non d’un feu de fête, mais d’un incendie de colère. Tout un pays a découvert, stupéfait ou effrayé, que sa jeunesse reléguée savait parler par le feu. À Clichy-sous-Bois, à Aulnay, à Villiers-le-Bel, la révolte a jailli comme une langue sans grammaire, brutale et claire, qui n’avait pas besoin de discours pour dire l’humiliation accumulée.
Ce soulèvement a pris racine dans une tragédie : la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, deux adolescents de Clichy-sous-Bois, électrocutés alors qu’ils fuyaient un contrôle de police. Leur disparition a agi comme une étincelle sur un baril de poudre déjà saturé : chômage massif, discriminations quotidiennes, contrôles policiers répétés, promesses trahies d’égalité républicaine. Les flammes n’étaient pas le fruit du hasard, mais l’expression condensée de décennies d’humiliation. Elles disaient la fatigue d’être surveillé sans être entendu, français sans être reconnu, vivant sur un territoire qu’on appelle périphérique pour mieux le tenir à distance.
Et pourtant, à mesure que les flammes s’éteignaient, un autre silence s’est imposé : celui de la littérature. Aucune grande œuvre romanesque n’a surgi pour inscrire ces nuits dans la mémoire écrite du pays. Ni fresque, ni chronique, ni poème ample n’a pris en charge l’incendie. La révolte de 2005 a fait trembler la République, mais elle n’a pas traversé ses lettres. Comme si l’événement, trop vif, trop brûlant, avait laissé les écrivains sidérés. Comme si le feu s’était consumé sans jamais passer dans la phrase.
C’est ce paradoxe que nous voulons interroger : pourquoi, alors que la France a toujours trouvé des mots pour ses secousses, de la Commune à Mai 68, de la Résistance à la guerre d’Algérie, l’une de ses plus grandes insurrections contemporaines est restée presque sans voix littéraire ? Est-ce un oubli ? Une incapacité ? Ou la marque d’un décalage plus profond entre le champ littéraire et les marges qui, cette nuit-là, ont pris la parole en incendiant le ciel ?
Quand la révolte trouve ses poètes
L’histoire française a toujours trouvé dans la littérature un miroir, parfois brisé, mais présent. La Commune de 1871 a laissé derrière elle les poèmes de Rimbaud, les pages incendiaires de Vallès, la mémoire blessée des journaux ouvriers. Mai 68 a été absorbé presque aussitôt par une génération d’écrivains et de penseurs : des manifestes, des récits, des fresques où l’utopie, la colère et la jubilation trouvaient un prolongement écrit. La guerre d’Algérie, malgré la censure, a engendré une multitude de textes, de Camus à Kateb Yacine, de Fanon à Daeninckx, où la violence coloniale s’inscrivait dans la langue.
Chaque fois, les écrivains ont accompagné, voire prolongé, le tumulte de la rue. Chaque fois, la littérature a su se saisir de la fracture politique et sociale pour en faire une matière esthétique et critique. Mais en 2005, rien, ou presque. Comme si les flammes des banlieues n’avaient pas trouvé d’écho dans la page, comme si la langue s’était dérobée devant la brutalité du réel. Là où d’autres révoltes avaient enfanté des œuvres, celle-ci n’a enfanté que des silences.
Ce contraste est saisissant. Il ne dit pas seulement une absence accidentelle, mais révèle un déplacement : le soulèvement, cette fois, n’a pas traversé le champ littéraire. Il a circulé ailleurs, dans d’autres formes d’art, dans d’autres voix. Et c’est peut-être ce décalage qu’il faut lire comme un symptôme : non pas seulement l’histoire d’un silence, mais celle d’une fracture entre le feu des marges et la plume des écrivains reconnus.
Les voix venues du dedans
Si 2005 n’a pas donné naissance à une grande fresque romanesque, il serait injuste de dire que la littérature est restée muette. Car depuis longtemps déjà, certains écrivains parlaient de l’intérieur, avec une langue taillée dans la rumeur des couloirs, dans la vibration des places, dans la patience ardente des visages. Leur force tient à ce qu’ils n’ont pas eu besoin d’attendre la révolte pour écrire : leurs livres en portaient déjà la sève.
Rachid Djaïdani, avec Boumkœur en 1999, a ouvert une brèche. Dans une prose brute, haletante, traversée par l’oralité, il racontait l’exil intérieur de ceux que la République maintenait à distance. Ses phrases n’obéissent qu’à leur souffle : elles éclatent, débordent, imposent une intensité qui défie toute mesure. On y entend déjà la colère qui, quelques années plus tard, se traduira dans les flammes.
Faïza Guène, en 2004, a donné avec Kiffe kiffe demain la voix d’une adolescente de Seine-Saint-Denis, lucide et drôle, fragile et tenace. Le succès du livre, inattendu, a imposé une langue singulière, à la fois drôle, acérée et vibrante du quotidien des cités, une langue qui a élargi le champ de la littérature française bien au-delà de ses frontières habituelles. Ce n’était pas un récit de soulèvement, mais c’était déjà une littérature de la révolte, une façon d’imposer des existences que l’on voulait invisibles.
Puis sont venus Mabrouck Rachedi (Le poids d’une âme, 2006) et Wilfried N’Sondé (Le cœur des enfants léopards, 2007). Leurs romans, ancrés dans l’errance, le désarroi et la rage, prolongent ce geste : écrire pour que ces vies marginalisées cessent d’être hors-champ. Eux aussi parlent depuis les marges, non comme chroniqueurs mais comme témoins intérieurs.
Ces écrivains ne commentent pas la révolte : ils en prolongent le souffle, ils en traduisent la matière, parce qu’ils écrivent dep...