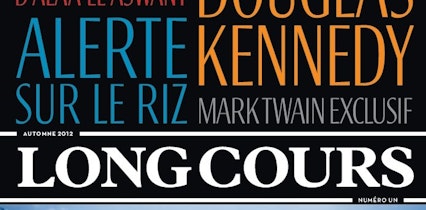Le mal n’existe pas semble rompre avec l’art de la fugue que pratiquait jusqu’ici le très rohmérien Ryūsuke Hamaguchi. Ni romantique, ni romanesque, le film explore la question du mal en détruisant méthodiquement la fable d’une harmonie perdue entre l’homme et la nature pour mettre en scène, dans un registre presque fantastique, la catastrophe écologique vers laquelle nous nous précipitons.

Connaissez-vous le glamping ? Le terme provient d’une contraction des mots glamour et camping, c’est en fait un camping de riches. Le concept fait fureur. Vivez l’expérience du grand air et de la vie sauvage tout confort : yourtes luxueuses, barbecues dernier cri et gardiennage garanti 24h/24. Les habitants de la petite commune rurale de Mizubiki, près de Tokyo, n’en ont jamais entendu parler non plus. Ils accueillent avec circonspection les promoteurs immobiliers qui viennent leur présenter le projet de construction du complexe dans le parc naturel voisin. Si le mal n’existe pas, comme l’affirme ironiquement le titre du film, on suppute néanmoins qu’il a pour origine une ignorance crasse, doublée d’une arrogance dont les requins capitalistes ont le secret. L’affaire, qui sert de point de départ au film, est locale, puisque la politique se pratique d’abord à petite échelle, comme si Hamaguchi réinterprétait la leçon tocquevillienne sur l’esprit de la démocratie. C’est toutefois une expérience plus ancienne qui a motivé la fabrication du long-métrage comme il l’explique lui-même. Hamaguchi a travaillé avec la compositrice Eiko Ishibashiet à l’occasion d’un concert live accompagné de la projection d’images muettes. Après leur collaboration acclamée sur Drive my Car et ledit concert intitulé Gift, Ishibashiet et Hamaguchi poursuivent ici une exploration des rapports entre l’image et le son pour renouveler l’écriture narrative en multipliant les décrochages et en libérant la musique de sa fonction diégétique. Tous ces préambules semblent suggérer que Le Mal n’existe pas est un projet très théorique, un film à dispositif. Dès les premiers plans du film sur un lumineux ciel bleu-gris, Hamaguchi formule une question : d’où vient le mal ? Mais, en deçà du dispositif, le cinéaste pose un cadre à la fois sublime et hypnotisant, celui de la forêt, et introduit des personnages qui demeureront mystérieux.
Le grand partage
Tout concourt à accorder naturellement notre sympathie aux villageois envahis par les citadins brutaux dans cette déclinaison tragique d’une opposition très occidentale entre nature et culture. La longue séquence de négociation avec les locaux prend la forme d’un champ contrechamp dans lequel les promoteurs immobiliers font défiler les vignettes de leur présentation powerpoint devant une foule atterrée. Les questions de bon sens se succèdent : où seront déversées les eaux usées ? Qui financera le projet ? Comment s’assurer que les visiteurs ne profitent pas de leur échappée belle pour saccager le parc ? Et le couple de promoteurs se contente de répéter qu’ils feront remonter les doléances à leur hiérarchie en usant de la novlangue insupportable du marketing immobilier (feedback, optimisation, projet d’avenir, investissement durable). L’ironie de ce premier face à face est d’une cruauté inouïe, puisque nous savons d’avance qui seront les perdants. Hamaguchi nous a fait pénétrer dans la forêt sacrée de la province de Mizubiki aux côtés de Takumi et de sa fille Hana, qui arpentent les bois en propriétaires respectueux. La dépossession aura bien lieu, la spoliation des terres est une fatalité rendue possible par un financement exceptionnel que le gouvernement japonais accorde aux entreprises innovantes après la crise du Covid-19, comme si l’épidémie avait été un prélude au drame écologique.
Paradis bouleversé
Le film aurait pu raconter cette catastrophe et nous placer dans la position confortable de celui qui prend le parti des petites gens. Il n’en est rien. Hamaguchi, dont les finesses d’écriture ont déjà été remarquées dans le très sophistiqué Contes du hasard et autres fantaisies, brise les linéarités narratives et déçoit notre horizon d’attente. Nous sommes brusquement chassés du Paradis et passons de longs et pénibles moments aux côtés des promoteurs, au beau milieu des gratte-ciels tokyoïtes, dans des espaces froids et anonymes, puis à l’arrière d’une voiture, sommés d’écouter leur bavardage insipide. Ce violent contraste empêche peut-être la fétichisation de la vie simple des campagnards à laquelle on aurait succombée. Les oppositions binaires sont habilement défaites et nous voici réintroduits dans la forêt avec les promoteurs immobiliers. Dans ce dernier volet pour un film qui en compte trois, Hamaguchi flirte avec le genre fantastique. Le silence de la nature comme avant un orage métaphorise la distance spirituelle, politique et affective qui sépare les promoteurs de Takumi, qui s’improvise guide touristique contre son gré. La colère est rentrée, les rapports presque cordiaux, mais la rage du vieux sage accompagne la montée d’une tension dramatique insoutenable, que des collages sonores évoquant la musique concrète viennent souligner.
Le mal n’existe pas glisse vers l’anthropologie négative dans un final apocalyptique.
L’ultime bifurcation, par rapport au schéma narratif initial, ne peut pas être dévoilée ici. Elle est spectaculaire et sa signification aussi trouble que les rêves éveillés. Hamaguchi n’a donc eu de cesse de déplacer le problème qu’il avait introduit. Du discours accusateur sur le sacrifice de la nature, Le mal n’existe pas glisse vers l’anthropologie négative dans un final apocalyptique. Il n’y a rien à sauver ici-bas, il est déjà trop tard pour le jugement dernier.
- Le mal n’existe pas, un film de Ryusuke Hamaguchi, avec Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa et Ayaka Shibutani. En salles le 10 avril.