Habiller les plus indifférentes existences de mots afin de leur tisser un vêtement éternel et miraculeusement vivant, c’est le projet de Pierre Michon lorsqu’il publie son premier ouvrage, Vies minuscules, à quelques trente-neuf ans. Si c’est la magie qui dans la littérature vous transporte, il ne tient qu’à vous de plonger dans les dessous de cet enchantement, avec un auteur qui semble les connaître plus que tout autre.
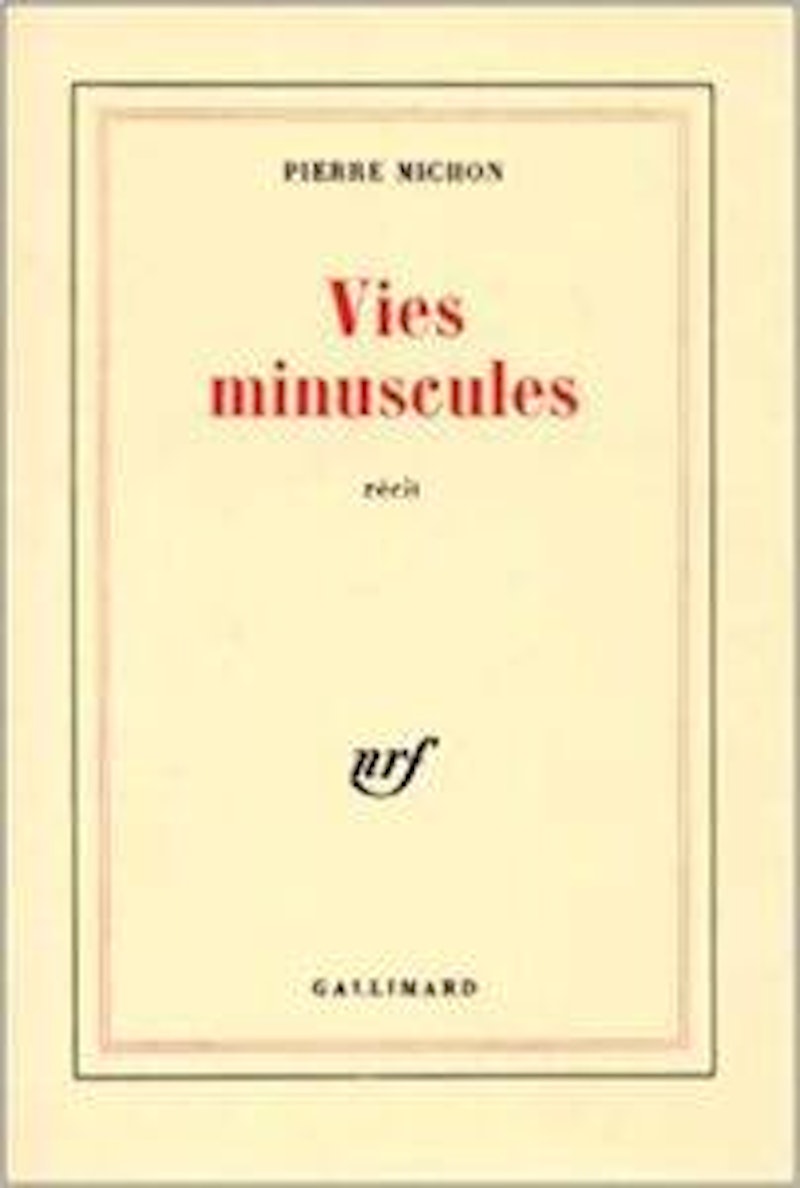
Pas pour Pierre Michon, dont on ne sait trop bien si la consommation d’encre excédera un jour celle de la gnôle, et celle des filles, couchées dans le lit et au fond des granges ancestrales, à défaut de coucher la langue sur le papier. Notre auteur a en effet longtemps erré, au cours d’une existence anarchique, avant d’embrasser pleinement une écriture vouée au récit de la vie des autres : les figures marquantes de son enfance dans les Vies minuscules, aussi bien que ses compagnons de galère – Rimbaud dans Rimbaud le fils, Faulkner, Beckett, Flaubert dans Corps du roi. Le portrait littéraire de la vie humaine ne s’accomplit pas sans peine ; et les livres de Michon, qui exhibent la bête Littérature à peau retournée, s’ils mentent à bien des égards pour se donner des airs de contes légendaires, ne sont jamais plus sincères que lorsqu’ils avouent la fascination rituelle et obsédante – dévorante – de l’alchimie du Verbe. L’écriture doit être un corps de mots, se substituant à celui de la chair, autrement plus mortel. Mais comment rendre compte de ces ineffables présences ? Afin de le découvrir, nous proposons dans cet article de vous introduire à une écriture en perpétuelle quête de miracle et de magie – puisqu’il faut bien un peu des deux pour créer des récits dans lesquels importe, plus que l’histoire, l’apparition des personnages dans leur vérité aussi fragile que fugace.
« Nul, dit Paul Celan, ne témoigne pour le témoin. »
Si Michon déclare vouloir rendre justice à ces existences broyées par l’oubli et l’indifférence, il ne s’agit pas pour autant de faire de ces êtres des suppliciés ou des martyrs de la société.
Ce dernier vers du poème « Gloire de cendres », cité par Michon lors de l’un des entretiens recueillis dans Le Roi vient quand il veut, illustre en grande partie la visée de son œuvre. En parlant des autres, en faisant le portrait de ceux qui ont assisté, muets, à de grandes choses, aussi bien en eux qu’autour d’eux, notre auteur entend restituer au monde la présence d’êtres dont la trace aurait très bien pu disparaître à jamais avec leur mort. On lit et entend souvent, à tort, que ce texte cherche à réhabiliter les humbles, à montrer leur noblesse et la beauté du misérable ; or, les tenants et aboutissants de la représentation de ces couches sociales semblent plus complexe que cela pour Pierre Michon. Si à de nombreuses reprises, dans les entretiens accordés à divers magazines et quotidiens, il déclare vouloir rendre justice à ces existences broyées par l’oubli et l’indifférence, il ne s’agit pas pour autant de faire de ces êtres des suppliciés ou des martyrs de la société.
Comme Michon l’explique lui-même, il ne cherche qu’à « donner un coup de pouce » à ceux qui « ratent leur coup » : mais, affirme-t-il, « ce ne sont pas des humbles ! ». C’est, sans doute, ce qui proprement distingue l’œuvre de Michon de celle de la plupart de ses contemporains : avoir été capable de nous rendre accessible cet excédent de force vitale, mythologique, sommeillant en chacun, seigneur ou paysan, tous plus bouffis d’orgueil les uns que les autres, aspirant tous avec une voracité certaine à la Légende, à l’éternité d’une présence poétique et chantée. Le fameux facteur de Van Gogh, peint à plusieurs reprises par lui dans La vie de Joseph Roulin est ainsi dévoilé dans la pleine ambivalence de sa condition humble :
« Car ce qu’il aimait dans cette idée [la République] et qu’il ne pouvait pas avouer, c’est que nanti d’elle il bondissait hors la loi et, lorsque de son pas lourd il marchait vers le wagon postal, lourdement en ouvrait la porte et la faisait tourner sur ses gonds, docilement courbé recevait sur l’épaule tout le poids des sacs postaux et cheminait là-dessous, il y avait près de lui et le regardant faire un autre Roulin folâtrant, léger, clandestin et oisif, un prince Roulin dont la barbe était parfumée et la jeunesse éternelle, avec un dolman bleu de ciel à brandebourgs et la simple casquette d’officier de marine que les princes, par modestie ou décontraction, coiffent. »
C’est pour ces échecs trahissant une dignité, une hauteur rêvée et spoliée par la contingence des destins, que Michon témoigne.
Ainsi, ce qui émeut, en ces insignifiants personnages, c’est la grandeur qu’ils se fantasment lorsqu’ils se débattent dans la médiocrité de leur existence : nous n’avons qu’à prendre pour exemple les « Vies des frères Bakroot ». L’un d’eux, Roland, épris de littérature – à l’instar de l’auteur à la même époque, qui ne manque pas d’ironiser sur lui-même – se démène tristement dans des lectures qu’il ne comprend pas, contre lesquelles il se heurte tel à un mur, et dont il ne découvrira jamais la substance vraie :
« Il ne perçait pas le secret des auteurs, la belle robe qu’ils ont mise à l’écriture était trop agrafée pour que Roland Bakroot, de Saint-Priest-Palus, non seulement pût la trousser, mais sût même s’il y avait dessous une chair ou du vent : comme je pensais le comprendre, le renfrogné, le bachelier à la Triste Figure, moi dont la crétinerie lyrique prenait vers ce même temps son irréparable tournant, sa voix crénelée de plomb, son chemin de ronde ou mon tournis m’emporte, où avec les Bakroot une fois encore je valse, vers je ne sais quel dernière phrase que sur elle même il me faudra boucler, Gros-Jean comme devant. »
C’est pour ces échecs trahissant une dignité, une hauteur rêvée et spoliée par la contingence des destins, que Michon témoigne. Et si, par moment, le récit des Vies semble se concentrer sur celle de l’auteur, il ne s’agit jamais que de dire une impuissance à écrire, révéler et être attentif à ce qu’il s’est enfin décidé de prendre en charge en s’assumant écrivain : la minuscule mais bien réelle présence d’une altérité qui a manqué son inscription dans l’Histoire.
https://zone-critique.com/critiques/les-deux-beune-de-pierre-michon/
C’est également au portrait d’illustres personnages que s’essaie l’auteur, objectera-t-on ; or, ceux qu’il peint que nous connaissons déjà, nous apparaissent dépouillés de leurs traditionnels oripeaux, pris dans l’étroitesse de leur existence. S’attaquant souvent à des artistes canoniques, Michon ne nous les livre pas à la façon de somptueuses statues de marbre ; bien davantage, il nous les montre dans la fabrique de leur légende, de leur vie. Ainsi dans Rimbaud le fils est-on introduit au poète par le biais de toutes les figures qui ont tournoyé autour de lui – notamment sa mère, Vitalie Cuif – qui ont été les témoins de cette comète dont le génie n’est pas glosé ni loué, mais représenté dans le mouvement et les effets qu’il met en branle. Ce sont pour ces témoins là également qu’il s’agit de témoigner : il faut, inlassablement, s’attacher à faire bruisser les contours d’êtres, de périodes mythifiées, pour apercevoir qu’ils sont imbriqués dans une myriade d’autres contes et légendes oubliés.
« Seules m’emportent les apparitions » : pour une écriture de la présence
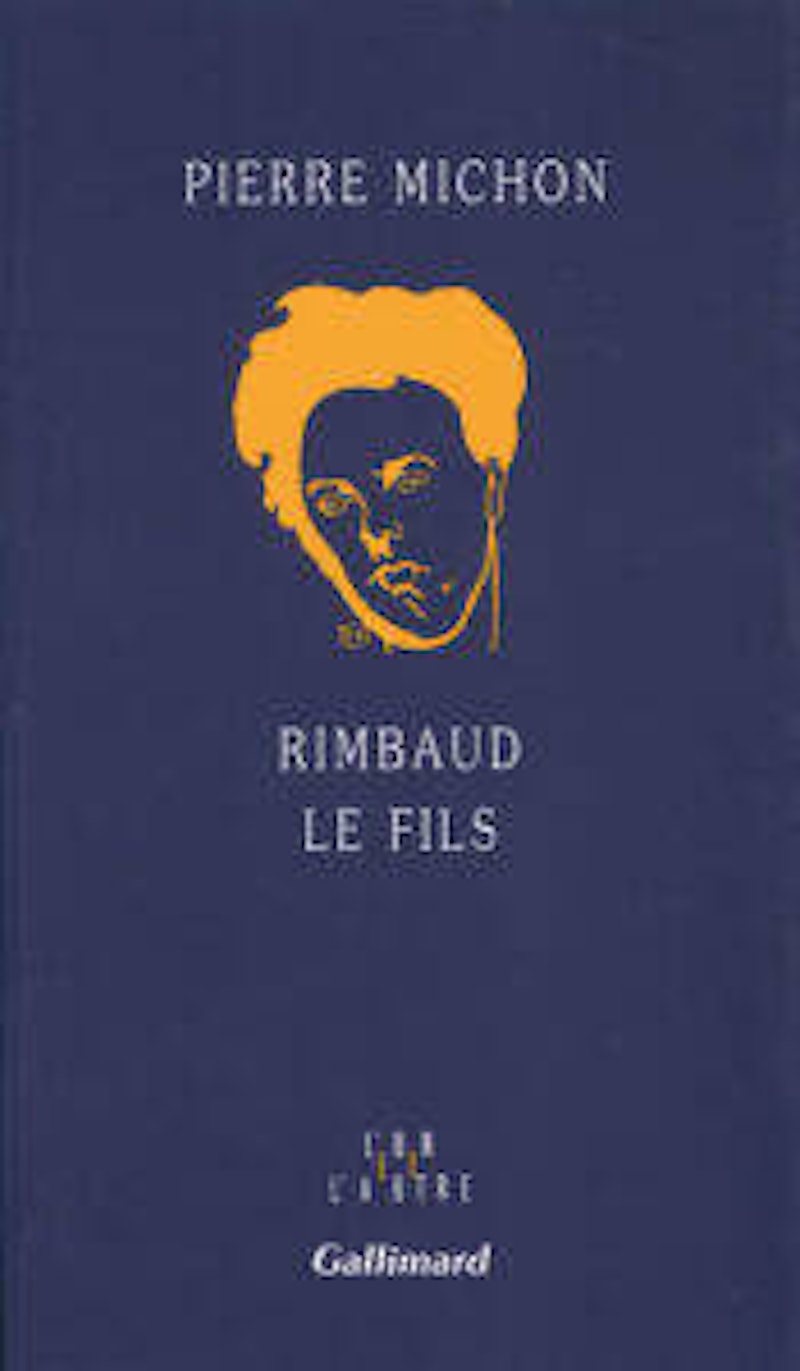
De fait, l’écriture de la vie, chez notre auteur, passe par la compréhension première et fondamentale de cette chose : ce ne sont pas des biographies que l’on écrit, ce ne sont pas des êtres sociaux, des êtres familiaux : ce sont des individus traversés et mus par des puissances qui les dépassent, aussi minuscules, imperceptibles soient-ils. Ce n’est donc pas la fidélité biographique qui anime notre auteur : et Proli, l’un des commanditaires du tableau des Onze, dans le court récit éponyme, s’adresse après tout en ces termes au peintre fictif François-Elie Corentin : « Peins-les [les onze membre du Comité de salut public de 1794] comme des dieux ou des monstres, ou même comme des hommes, si le cœur t’en dit ». La représentation est au service de la présence ; et à partir de là, tout – ou presque, est permis. On a ainsi de drôles d’anecdotes au sujet de la réception des œuvres de Pierre Michon : ce sont des lecteurs croyant réellement pouvoir admirer le tableau des Onze en se rendant au Louvre en achevant le récit, ou bien des organisateurs d’une exposition sur Van Gogh en Amérique, dans laquelle l’un des portraits de Joseph Roulin fut présenté comme celui figurant dans la cuisine du facteur – alors que ce détail est une pure invention de l’auteur. Cette naïveté prête certes à rire, mais confirme en réalité ce qu’a tenté d’illustrer l’écrivain : notre représentation du réel est un vaste tissu de mensonges, de légendes que l’on se raconte, et la consécration d’une œuvre advient lorsqu’elle parvient à faire croire à ses mythologies.
Le rythme de la langue de Michon évoque la récitation, le rituel ; ce sont des mots, des expressions sans cesse ressassés jusqu’à ce qu’ils naissent à nos yeux.
Mais comment cela peut-il bien s’élaborer, un mythe ? En fondant une langue neuve pour le soutenir d’une part ; en organisant d’autre part un réseau fluide et foisonnant de puissances, de forces, au principe des actions des personnages. Et, de fait, la langue de Michon est une langue dont le rythme évoque la récitation, le rituel ; ce sont des mots, des expressions sans cesse ressassés jusqu’à ce qu’ils naissent à nos yeux. Ce sont les noms des Onze, toujours assenés dans le même ordre, peu à peu changés en une ritournelle presque inquiétante, opaque ; c’est l’apostrophe continuelle, « Monsieur », qui appelle le lecteur à une pleine implication de sa personne. Ce sont ces chutes à la fin de chaque récit, qui du même coup qu’elles achèvent l’œuvre, mettent le point d’orgue par le rappel d’un mouvement qui dépasse et déracine les êtres pour les resituer dans le grand élan déroutant de l’Histoire : de l’Histoire qui se relance sans fin, et troue de sa puissance des êtres ballottés, parfois monstrueux, parfois angéliques – bien peu humains, en somme. Dans les Onze, la violence de la Terreur qui suivit la Révolution est la même violence que celle, ancestrale, des grottes de Lascaux ; dans Rimbaud le fils, ce qui fait écrire au jeune poète son chef d’œuvre, Une Saison en enfer, est peut-être « les étoiles, ou les vieilles choses énormes, Dieu, la langue »… Enfin, ce sont ces « puissances » essaimées dans toutes ses œuvres, qui « seules le savent »(8), et emportent l’humanité dans leur course.
Et c’est, sans nul doute, la raison pour laquelle l’écriture n’a jamais pu être pour Michon une affaire de simple autobiographie, un banal récit de sa vie. « Écrire n’est pas raconter ses souvenirs, ses voyages, ses amours et ses deuils, ses rêves et ses fantasmes », nous rappelle Deleuze. Le travail de l’écrivain est tout autre, plus laborieux, dangereux peut-être aussi : c’est ce que nous apprend Michon lorsqu’il parle.
Crédit photo : © A. MEYER
















