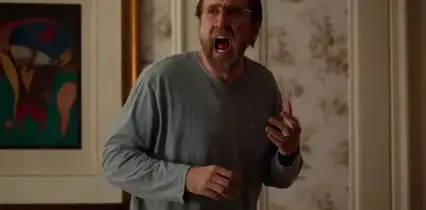Autrice d’une oeuvre plurielle – près de soixante-dix textes de fiction, essais et pièces de théâtre écrites pour le Théâtre du Soleil où sa collaboration avec Ariane Mnouchkine débute dès les années 1980 – Hélène Cixous, née à Oran (Algérie) en 1937, est elle-même multiple, insaisissable. En 1968, elle participe à la fondation de l’université de Vincennes (Paris VIII), où elle crée en 1974 le premier centre d’études féminines dans une université européenne. En 2020 paraissent deux textes inédits : une fiction, Ruines bien rangées, ainsi qu’un recueil de ses séminaires, publiés sous le titre Lettres de fuite.
« La langue a toujours signifié : liberté. »
Une autobiographie allemande
Multiples, les pays intérieurs
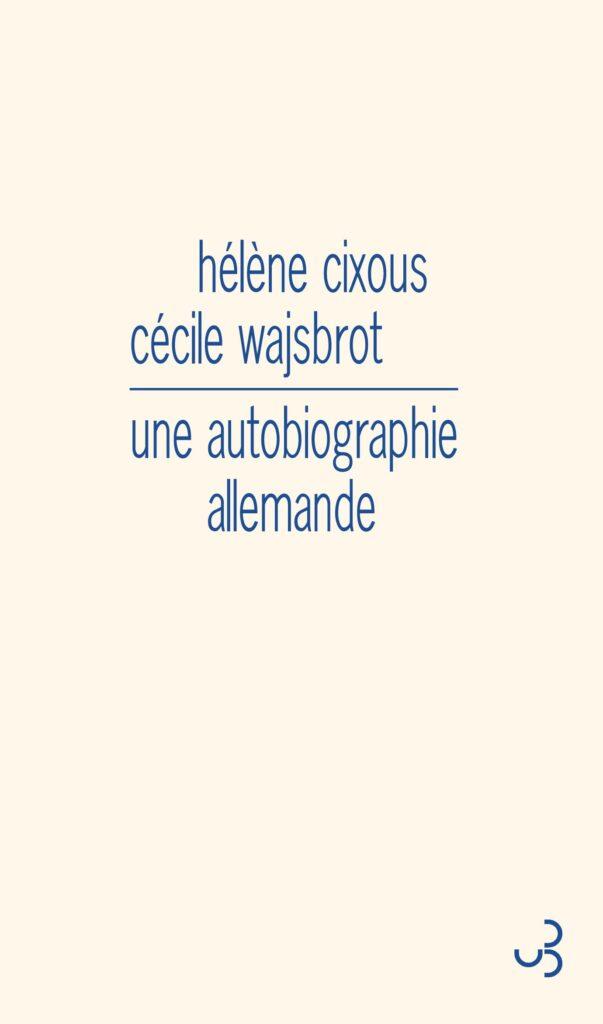
Dans les lieux de la mémoire où l’œuvre fait son chemin avec patience, ardeur, depuis Le Prénom de Dieu (1967), l’accès à l’identité personnelle semble se donner par jumelages : Algérie, Allemagne, pays siamois où vient se tresser le double lignage paternel et maternel.
« Chaque fois que je vais dire : Al –
Algérie et Allemagne, mes deux pays se lèvent. Ils sont si dissemblables si associés, ils se mêlent de moi et ne s’entendent que par leurs expériences de la souffrance et de la haine vaincues par l’amour. »
(Une autobiographie allemande)
Hélène Cixous, née le 5 juin 1937 à Oran, a la naissance multiple. – Un versant Algérie, où la famille du père, Georges Cixous (1908-1948), médecin, séfarade, athée, a de longue date épousé la nationalité française – jusqu’au drame de Vichy et la douleur indicible de « ne-plus-être-français », éprouvée comme une mort du sujet. – Un versant Allemagne par la mère, Ève Klein (1910-2013), sage-femme de famille ashkénaze originaire d’Osnabrück, en Basse-Saxe – petit fragment de l’odyssée judéo-allemande que l’évasion d’Ève, sa mère Omi et sa soeur Éri, hors d’Allemagne, jusqu’à parvenir à gagner Oran : à la veille des déferlements de l’Histoire, la halte africaine est salutaire.
Je suis archisurdéterminée par les événements politiques-personnels de mon enfance.
(Ibid.)
Sur les traces de la mémoire familiale et collective, l’écriture se fait archéologie, paléontologie, entreprend une fouille des vécus afin d’insuffler vie aux chers fantômes disparus.
Arkhè : origine, commencement, principe fondateur. Sur les traces de la mémoire familiale et collective, l’écriture se fait archéologie, paléontologie, entreprend une fouille des vécus afin d’insuffler vie aux chers fantômes disparus. L’œuvre dessine une double arborescence, suivant la lignée paternelle d’abord (OR, les lettres de mon père, 1997), dans la mesure où c’est autour de la coupure franche née de la disparition du père que s’édifie la mythologie personnelle – l’écriture vient prolonger le souffle d’une présence ravie. Suivant la lignée maternelle aussi, comme dans le dernier récit en date (Ruines bien rangées, 2020), à la poursuite d’Ève dans les ruelles de la vieille ville d’Osnabrück, cœur battant de l’Europe dont les monuments et les pierres commémorent la chasse de ses sorcières et l’assassinat de ses Juifs : lente, opiniâtre, la mémoire revient à deux temps de persécutions féroces, la lointaine Renaissance, le tout proche XXe siècle, le lointain XXe siècle, la toute proche Renaissance, afin de conjoindre la barbarie de leurs résonances voisines.
Multiple, le don des langues
La double ascendance, dans laquelle viennent bruire dès l’enfance les échos de langues multiples, exige de la conscience une acuité qui ne cessera plus de s’aiguiser. En Algérie coloniale, défigurée par la méconnaissance et la haine de l’autre, le paradis-pas-encore-perdu est ce « polylinguisme » autour duquel se greffent les accents et les voix familiales : le français du père, qui parle également l’arabe et l’hébreu, l’allemand traversé de yiddish, et plus tard l’anglais de la mère. Dans l’Oran captive de l’Histoire où parviennent les échos de la guerre, cette conjonction inaugurale est une chance éthique : face aux fermetures identitaires et aux hideurs nationalistes, c’est dans la pratique différentielle de langues plurielles que le goût de la liberté se laisse appréhender.
« Or, ma vie a commencé dans une grande joie de langues. Un festin et force plaisirs et plaisanteries, c’étaient les langues qui m’enchantaient, rue Philippe à Oran. Je pourrais dire, sans exagérer, que les êtres chers de ma famille étaient porteurs de langues, chacun les siennes et que j’adorais le vol des accents dans la maison et les salves d’idiomes. Je crois qu’enfant j’ai pu prendre le monde promis comme un réservoir de langues désirables. J’en garde quelque chose. J’ai passion, gourmandise, dès que je lis, pour les mots, les tournures, en toutes les langues. Je suis profondément plurilingue, et j’écris accompagnée d’une brigade de dictionnaires. »
(Une autobiographie allemande)
À rebours de la douleur de séparation induite par l’inhospitalité de la langue maternelle, la venue à un monde polylingue est une jouissance de la dissémination.
À rebours de la douleur de séparation induite par l’inhospitalité de la langue maternelle dont l’ami intime, Jacques Derrida, fait le constat désolé – « Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne », Le Monolinguisme de l’autre, 1996 –, la venue à un monde polylingue est une jouissance de la dissémination. C’est peut-être la résistance intuitive à toute pulsion d’appropriation qui fonde ce rapport à la langue placé sous le signe du désir et du plaisir : nulle langue ne saurait être possédée. Chaque langue participe plutôt à circonscrire le champ – incommensurable – d’un jeu libre où le métissage seul fait loi.
« Pour moi (…) il n’y a qu’une langue et elle parle parfois anglais, ou tantôt chante allemand, c’est un fleuve sonore où se jettent tant d’affluents, où la pensée s’avance, sillon sensuel, s’aidant ou se parant dans son effort et son élan des forces et des charmes d’une langue ou d’une autre. »
(Ibid.)
Chez Hélène Cixous, la constance de la réflexion menée autour des langues (particulièrement vive dans Une Autobiographie allemande) est le signe d’une ferme lucidité à l’égard des régimes d’oppression et de clôture qui menacent les littératures. Croisant à cet endroit les méditations de Gilles Deleuze et de Félix Guattari sur le rhizome, racine-multiple (Mille Plateaux, 1980), sa pensée – et son oeuvre – attestent de cette liberté en langue née de la conscience de l’impureté – salutaire – des langues. De même que la langue française est hospitalière à de multiples fragments d’idiomes autres, la littérature n’est à proprement parler… pas française, toute frémissante qu’elle est de langues étrangères qui la portent à son plus haut degré d’incarnation. On entr’aperçoit un peu ici à quelles joies l’exploration de ce plurilinguisme joyeux est susceptible de mener.
Multiple, le devenir féminin
Prêter attention au multiple en se gardant bien de réductions inquiétantes et de partages arbitraires : ce double geste éthique et politique fonde la réflexion menée dans Le Rire de la Méduse, texte vibrant qui tient une place particulière dans l’œuvre d’Hélène Cixous. Comme le rappelle la belle préface de Frédéric Regard à l’occasion de la réédition du texte (Galilée, 2010), cet essai-manifeste publié pour la première fois en 1975 dans un numéro de L’Arc consacré à « Simone de Beauvoir et la lutte des femmes » vient au jour dans un contexte où la pensée féministe, en attente de reformulation depuis Le Deuxième Sexe (1949), croise celle de la différence sexuelle. C’est tout l’attrait du Rire de la Méduse que de permettre aux questions théoriques et politiques de se cristalliser autour d’une conception et d’une pratique renouvelées de l’écriture féminine, dont les ambitions sont résolument visionnaires – retrouvant des accents rimbaldiens, la voix du texte annonce les progrès à venir.
« Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera. »
(Le Rire de la Méduse)
La lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny, rebaptisée Lettre du Voyant, envisageait en effet déjà, avec une hauteur de vue quelque peu surplombante, la question de l’écriture féminine.
« Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme, jusqu’ici abominable, – lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l’inconnu ! Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres ? – Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les comprendrons. »
(Arthur Rimbaud, Lettre du Voyant)
Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera.
Si l’écriture féminine est multiplicatrice de progrès, c’est par le « don d’altérabilité » qu’elle manifeste : la capacité à accueillir les visages infinis d’un devenir pluriel, humain et extra-humain. Selon le sens bien particulier qu’elle reçoit dans Le Rire de la Méduse, l’écriture dite féminine ne désigne pas autre chose que les ressources en souplesse et fluidité d’une langue travaillée à même son pouvoir de métamorphoses, pas autre chose qu’une pensée sensible à la continuité des formes du vivant – aux points de passage entre les sexes, entre les règnes. Cette pensée sans coupure célébrant la vie comme faim et soif de l’autre, osant les traversées vertigineuses de l’altérité, se garde bien de toute essentialisation. Si en réalité bien peu d’autrices parviennent à « inscrire de la féminité » dans leurs textes, l’exemple de Jean Genet – auquel Hélène Cixous, dans la lignée de Jacques Derrida (Glas, 1974) consacre un essai publié en 2011, Entretien de la blessure – témoigne d’une capacité également partagée entre les sexes à s’émanciper d’une histoire littéraire « homogène à la tradition phallocentrique ».
« Presque toute l’histoire de l’écriture se confond avec l’histoire de la raison dont elle est à la fois l’effet, le soutien, et un des alibis privilégiés. Elle a été homogène à la tradition phallocentrique. Elle est même le phallocentrisme qui se regarde, qui jouit de lui-même et se félicite. »
(Le Rire de la Méduse)
Multiples, les potentialités d’être
C’est peut-être toutefois chez une romancière brésilienne, Clarice Lispector, encore trop peu célébrée en France, que se donne à voir avec le plus d’intensité le devenir-autre de la langue, dont Gilles Deleuze assure qu’il est le propre des plus grands écrivains.
« Écrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. C’est un processus, c’est-à-dire un passage de Vie qui traverse le vivable ou le vécu. L’écriture est inséparable du devenir : en écrivant on devient-femme, on devient-animal ou végétal, on devient-molécule jusqu’à devenir-imperceptible. »
(Gilles Deleuze, Critique et clinique)
Dans Vivre l’orange, texte qu’Hélène Cixous consacre en 1979 à Clarice Lispector (1920-1977), nouvelliste et essayiste brésilienne d’origine juive ukrainienne, se révèlent les voisinages hybrides auxquels parvient l’écriture lorsqu’elle réussit à s’émanciper des frontières qui séparent les êtres pour toucher au plus près de l’altérité animale, végétale, moléculaire. On pense tout particulièrement à La Passion selon G.H. (A Paixão Segundo G.H., 1964), récit, ou plutôt longue méditation au sein de laquelle la narratrice – double lispectorien – se voit confrontée à l’abjection d’un cafard dont elle finira par goûter les entrailles, expérience de communion écoeurante avec les sources antélinguistiques d’un monde où la conscience humaine ne survit qu’au prix d’une aliénation certaine.
« Elle est allée hors frontières, où le moi n’est moi que comme pensée du monde et le monde n’est monde qu’à l’exception brillante du moi. »
(Vivre l’orange)
Si les explorations menées par Clarice Lispector suscitent l’admiration d’Hélène Cixous, c’est que l’acuité de son regard est à même de livrer un accès inédit au vivant, à travers un ébranlement en profondeur des identités.
Comment faire venir claricement ; c’est un long et passionné travail de tous les sens. Aller, approcher, effleurer, demeurer, toucher, faire-entrer, présenter, – donner, – prendre.
(Ibid.)
Travail salutaire de l’écriture, en des temps de repli et d’enfermement de la conscience en elle-même.
« Mais en ces temps faibles et oublieux, où nous sommes loin des choses, si loin les unes des autres, très loin de nous-mêmes, en ces temps tristes et oublieux, de regards faibles, trop courts, tombant à côté des choses, loin des choses vivantes, où nous ne savons pas lire, laisser rayonner les sens, et nous avons froid, il souffle un air glacial autour des âmes, autour des mots, autour des moments, nos oreilles sont gelées, les années ont quatre hivers et nos oreilles hibernent, nous avons besoin de traduction. »
(Ibid.)
Défier l’augure : c’est le cri vertical d’Hamlet (« We defy augury ! ») qui donne son titre à l’un des essais les plus récents d’Hélène Cixous (Défions l’augure, 2018). Face aux cycles sans cesse revécus de nos passions tristes, c’est aussi l’injonction qui commande l’oubli des sentences de fatalité, le goût vital de la mémoire et de l’altérité, le renoncement aux pulsions mortifères, la passion de la renaissance.
« Tout a une fin ; c’est le commencement qui est rare. »
(Le Prénom de Dieu)
Multiple, mythique, l’écriture
Travail salutaire de l’écriture, en des temps de repli et d’enfermement de la conscience en elle-même.
Écrire suppose toujours un certain déséquilibre, une certaine précarité, instabilité, inquiétude. Pour nul.le auteur.rice, bien dire n’aura été une préoccupation sérieuse. L’enjeu de l’écriture n’étant pas d’ordre strictement grammatical, la quête se loge ailleurs, et dans la mesure où écrire est une affaire de devenir, ce qui est impossible à dire, c’est précisément ce qu’il faut tenter d’écrire. Devenir-autre, devenir-mythologique… À esquisser les formes et les figures dans lesquelles la pensée-création d’Hélène Cixous semble le mieux vouloir se réfléchir, voici que vient tout à coup l’envie d’invoquer ici le patronage mythologique de quelques –possibles – ombres tutélaires de l’autrice. – Le prénom d’abord, Hélène, pourquoi n’appellerait-il pas une évocation plus lointaine : l’étrangère, la captive, l’arrachée à son origine dans le double ravissement de la passion et de l’horreur, la veilleuse-témoin silencieuse du génocide de son peuple ? – Sur les rives de l’Égée, pourquoi ne pas penser aussi à la tisseuse, la rusée, l’emmurée fidèle, celle qui couche avec l’absence de l’être aimé, celle dont la ruse invente le double mouvement du faire et du défaire, dans l’ambivalent partage des jours et des nuits. – Et encore : autre fileuse, autre astucieuse, celle qui était aussi la fille de Minos et de Pasiphaé, celle dont les ressources d’intelligence se conjuguent à la force du héros grec pour venir à bout du cœur monstrueux du labyrinthe. – Hélène la Troyenne, Pénélope, Ariadne… Méduse, aussi, dont le rire de santé est une revanche sur la barbarie de ceux qui lui en voulaient à mort… toutes celles enfin qui soumettent la langue à l’entre-deux de la raison et de la folie. Dans le voisinage du délire, le texte vacille : l’historique et le mythologique, l’ici-bas et l’au-delà, la veille et le sommeil, le même et l’autre, l’humain et l’animal – l’écriture file sur une ligne de sorcière, bifurque, dévie, suivant l’incessante modulation de ses voix intérieures.
Crédit photo : © Lea Crespi / Pasco
Bibliographie
- Ruines bien rangées, Gallimard, « Blanche », 2020.
- Défions l’augure, Galilée, « Lignes fictives », 2018.
- Une autobiographie allemande, Christian Bourgois, 2016.
- Entretien de la blessure : sur Jean Genet, Galilée, « Lignes fictives », 2011.
- Le Rire de la Méduse : et autres ironies, Galilée, « Lignes fictives », 2010.
- Or : les lettres de mon père, Des femmes, 1997.
- L’heure de Clarice Lispector ; précédé de Vivre l’orange, Des femmes, 1989.
- Le Prénom de Dieu, Grasset, 1967.
- Critique et clinique, DELEUZE Gilles, Minuit, « Paradoxe », 1993.
- Capitalisme et schizophrénie. 2, Mille plateaux, DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Minuit, « Critique », 1980.
- Le monolinguisme de l’autre : ou la prothèse d’origine, DERRIDA, Jacques, Galilée, 1996.
- Glas, DERRIDA Jacques, Galilée, « Digraphe », 1974.
- La Passion selon G.H., LISPECTOR Clarice, Des femmes, 1998.
- Oeuvres complètes, RIMBAUD Arthur, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2013.