
Graphomane infatigable, Stephen King a vendu plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde. Ses romans, souvent captivants, mettent en scène des personnages en proie à une éternelle solitude, dans un style décousu et singulier. Mais la critique universitaire le tient pourtant à l’écart du débat littéraire. Alors, que vaut vraiment Stephen King ?
Je peine devant Stephen King comme naguère Gracq peinait devant Jules Verne. Je ne cesse de nourrir à son égard un sentiment ambivalent d’attirance que tempère immédiatement une sorte de répulsion. Ses livres ne manquent pas de faiblesses : une écriture, certes particulière, mais que l’on hésite à qualifier de style — le mot est plus grand que la chose, avouons-le ; les histoires sont toutes plus ou moins découpées sur le même patron. Et pourtant. Dès les premières pages, quelque chose opère : on est entraîné par une puissance d’imagination hors du commun ; on dirait les décors et les personnages tout droit sortis d’un ailleurs qui emprunte à notre monde sa cohérence, mais dont seul l’auteur possède les clés.
Et il faut avouer que la figure de King en impose : graphomane infatigable, ses romans, essais et nouvelles s’abattent au rythme d’un ou deux volumes par an depuis le milieu des années 1970. Et son aisance à produire semble s’être décuplée à mesure que la vieillesse s’installe… Rien que pour 2021, on attend deux romans et un recueil de nouvelles.
Mais à quoi bon une étude critique sur Stephen King ? Son œuvre s’en passerait presque, si le but de tout auteur est le succès commercial. Plus de 500 millions d’exemplaires vendus vous bâtissent une citadelle imprenable qui vous place au-dessus du commun des mortels. De notre côté, il fait partie de ceux dont on croit tout connaître. Avec facilité — et dédain, on a catalogué son œuvre : « FANTASTIQUE» ; « HORREUR ». De la paralittérature donc. Une foi étiqueté, c’est oublié. D’ailleurs, la critique universitaire le tient à l’écart du débat littéraire. Cela arrive chaque fois que le succès est présent. Le succès est suspect, car il impose l’assentiment du plus grand nombre. Or, ce qui s’offre aux plus nombreux, croit-on à tort, n’est pas étranger à une forme de faiblesse intrinsèque de production. Car, pour plaire à tous, il faut, au fond, n’avoir aucune singularité.
Ne pourrait-on pas réviser notre jugement pour un moment, mettre de côté nos préjugés et nous demander ce que vaut vraiment l’œuvre de Stephen King ?
Le romancier du réel : l’écriture de Stephen King.
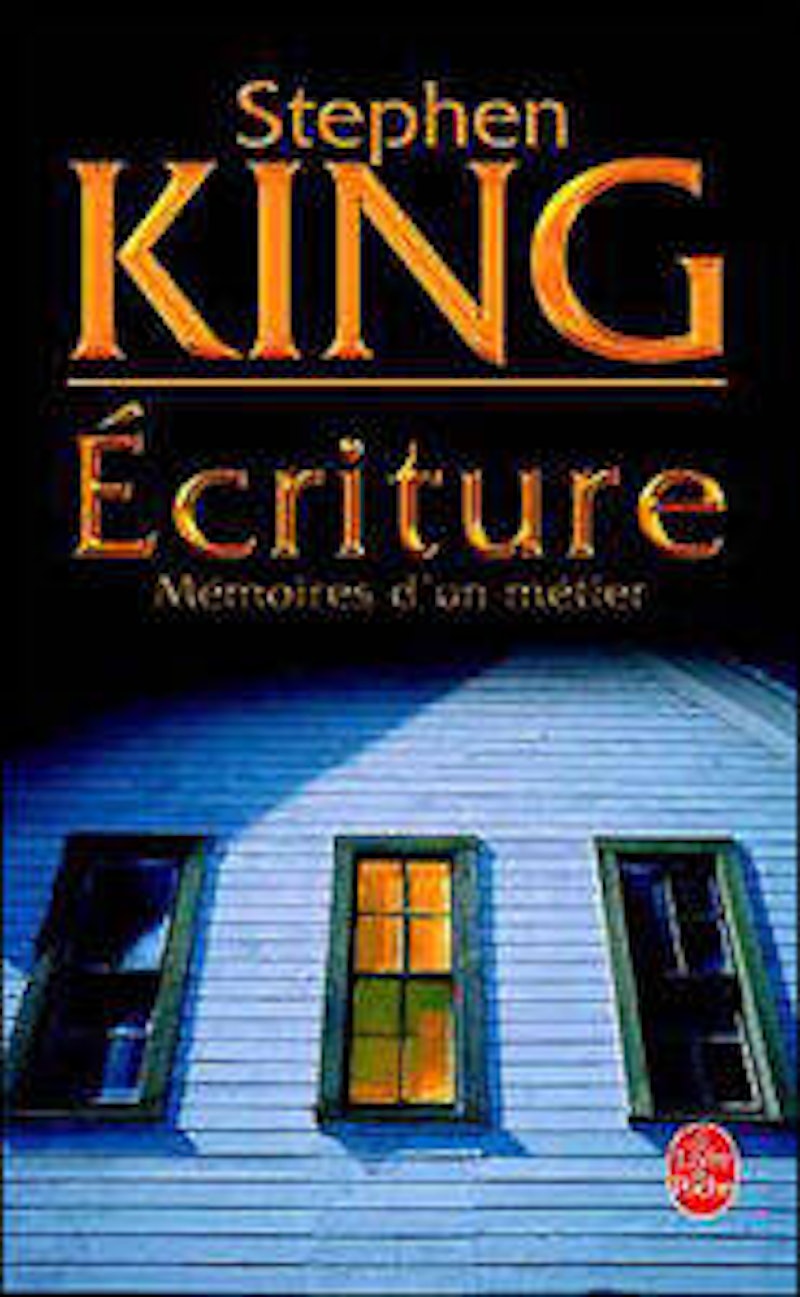
À vrai dire, la question ne manquerait pas de faire sourire l’intéressé car « la plupart des livres qui parlent d’écriture sont pleins de conneries ». King n’a pas théorisé son art à proprement parler, mais a effleuré la question dans deux essais : Anatomie de l’horreur (2010 [1981]), et Ecriture (2001). C’est dans ce dernier livre, mi autobiographie, mi art poétique, que l’auteur, en faisant mine d’accompagner un auteur débutant, se livre à une série de conseils, d’exemples et de contre-exemples tirés de la littérature américaine.
La simplicité et l’honnêteté sont les chemins les plus courts pour atteindre le lecteur. Ils opèrent sur deux axes primordiaux : le vocabulaire et la grammaire, qui composent la syntaxe. C’est sur un usage singulier de ces deux « outils » que le style décousu de King se forge. Tous les filtres qui peuvent instaurer une prose élégante, riche en ornements, sont écartés pour faire tomber le plus grand nombre de barrières entre le lecteur et le texte.
D’une certaine manière, le style de King rappelle celui de Céline, claudicant, oscillant entre écriture et oralité. Baroques, certains romans, comme Ça, s’ouvrent sur une facture des plus classiques ; puis, brusquement, le ton évolue, le familier fait une intrusion.
Au fil du temps, King a su se composer un style à hauteur d’homme, dont il emprunte le vocabulaire, familier voire grossier, qu’il accouple à des phrases tronquées, inachevées. D’une certaine manière, le style de King rappelle celui de Céline, claudicant, oscillant entre écriture et oralité. Baroques, certains romans, comme Ça, s’ouvrent sur une facture des plus classiques ; puis, brusquement, le ton évolue, le familier fait une intrusion.
« …car [George] redoutait qu’une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres au milieu des odeurs d’humidité et de légumes légèrement décomposés.
Stupide ! Des choses griffues et velues, bavant du venin, ça n’existait pas. » (Ca, I, p.17)
Dans cet extrait, la rupture opère avec le saut de ligne, introduisant, à travers la première phrase nominale, une voix nouvelle, entre style indirect libre et commentaire, quitte à brouiller l’énonciation traditionnelle. Car qui s’exclame : « Stupide ! » ? Ce ne peut être le narrateur, pour des raisons évidentes de cohérence du propos. Ce ne peut être que l’auteur, s’introduisant directement dans le corps de son texte, réagissant à son histoire qui s’écrit comme malgré lui. Ce ne serait pas un cas inédit dans l’histoire de la littérature. Des auteurs comme Sterne ou Diderot s’y sont essayés mais dans des intentions satiriques. La deuxième phrase est remarquable par sa facture : le groupe nominal est repris en deuxième partie par le pronom démonstratif « ça », dans une parfaite imitation d’une oralité enfantine.
Les exemples sont nombreux, variés et les romans de King n’ont qu’un seul but, ce que Flaubert nommait le « réel écrit », qui passe par une attention accrue à l’homme.
Vision de l’homme et du monde.
En 2009, l’auteur fait un déplacement remarqué en France, à l’occasion de la sortie de DoctorSleep, la suite de Shining. Invité à analyser rétrospectivement l’ensemble de son œuvre, il lance cette réflexion en forme de boutade : « La littérature, c’est de la fiction sur des gens extraordinaires dans des circonstances ordinaires. Ce que j’écris, c’est de la fiction sur des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires » Quoique réducteur, ce propos paradoxal a le mérite de mettre l’accent sur l’objet au centre de chaque livre : l’homme. Et quoique la dimension sociale achève de donner une profondeur à ces hommes et ces femmes d’une apparente banalité, c’est bien l’humain qui seul semble compter pour l’auteur, dont il postule d’emblée l’éternelle solitude.
En effet, la solitude est sans aucun doute le plus grand mal que les personnages de King ont à affronter. Même entourés, mariés, pères ou mères, ils n’en demeurent pas moins intérieurement seuls, et portent un monde, un jardin secret en plus ou moins bon état d’entretien, lorsqu’il n’est pas saccagé, qui se heurte de façon ironique au monde qui les entoure et qui exige d’eux l’attitude de leur étage social. Cette incongruité se concentre et éclate dans le corps du roman à travers l’usage de l’italique, que King est connu pour avoir réinventé. Dernier tour d’écrou au processus d’ancrage du personnage dans la réalité, l’italique à la King rompt le fil de la narration pour livrer la matière brute de la pensée du personnage. Devenu écrivain, Bill Feu-le-Bègue (Ça) est toujours hanté par les souvenirs sanglants de Derry. Avec le temps, ses cauchemars deviennent plus intenses, et sa femme lui fait part de langage désarticulé accompagné de rêves.
« Le visage vide, il la regarda. Il avait un mauvais goût dans la bouche qui lui descendait jusqu’au fond de la gorge comme une traînée d’aspirine mal dissoute. Tu sais maintenant à quoi ressemble la peur. Il était temps, si l’on songe à tout ce que tu as écrit sur la question, se dit-il. »
Pour écrire la peur de son personnage, King a recourt à deux strates d’énonciation : celle d’une narration prise en charge par un narrateur omniscient, que vient interrompre le cours de la pensée. Notons que c’est la sensation qui amène la pensée, comme pour souligner les agissements du monde sur le personnage.
Même en possession de pouvoirs surnaturels : télékinésie (Carrie), don de précognition (Deadzone), etc., les personnages n’en demeurent pas moins humains, et ce, en raison d’une cause principale, un lien qui unit le personnel kingien : la prégnance du passé. Ils n’en ont jamais fini avec leurs fêlures intimes : violence domestique, abus sexuel, alcoolisme les poussent à aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. Du massif de son œuvre, certains titres se détachent pour former un groupe. Jessie, dans le roman éponyme, et Paul Sheldon, dans Misery, suivent le même parcours. Tous deux sont contraints à l’immobilité physique. Incapable de se mouvoir, ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Jessie doit affronter le jour de l’éclipse solaire où son père a abusé d’elle ; Paul, quant à lui, doit sans cesse contenir la vague du manque. Et tous deux vont finir par puiser une force dans ce qui était jusque-là une faiblesse.
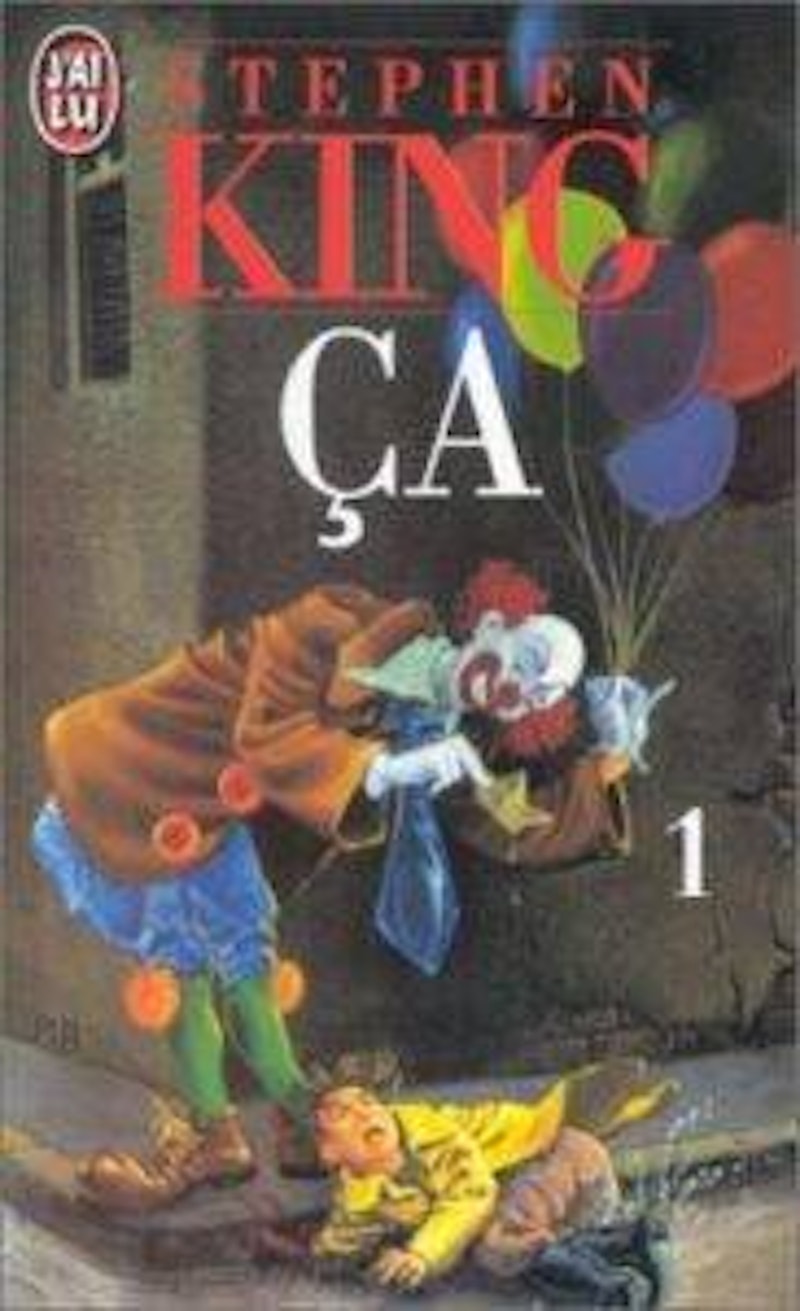
En plongeant dans les profondeurs de la complexité humaine en vue de l’éclaircir, les romans de King ne font qu’accentuer son opacité. Paradoxe qui se résout derrière les apparences, entre intériorité et extériorité humaine, si distinctes l’une de l’autre qu’elles semblent faire monde.
Tel qu’il se présente à nous, l’homme est incomplet, jamais tout à fait lisible, et le roman kingien demeure un laboratoire de recherche sur cette vérité dont l’auteur a fait le « principal devoir de la chose littéraire ». Pour les temps à venir, le dessein du romancier sera de trouver cette lumière qui lui permettra de lire le filigrane.
Bachir Bourras














