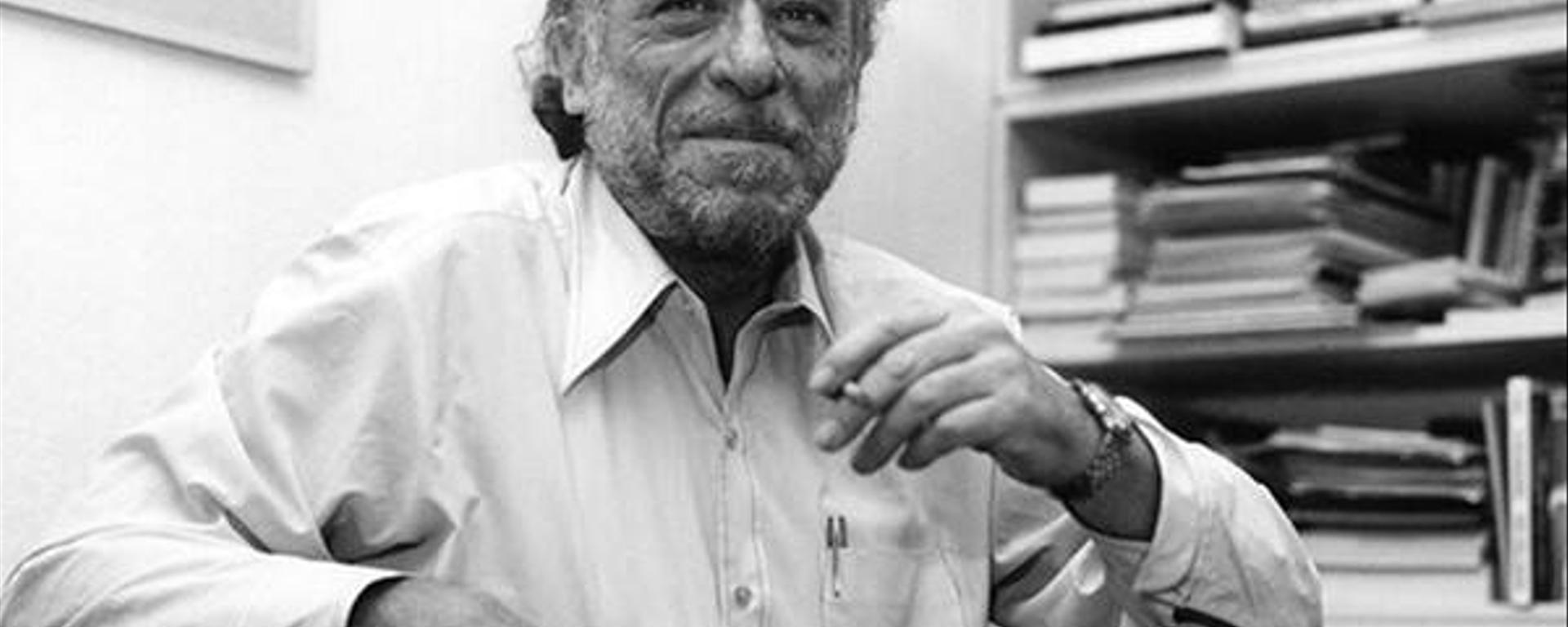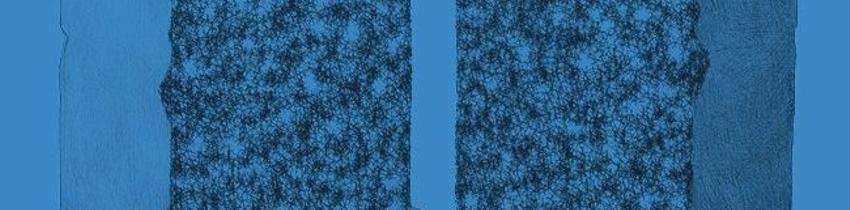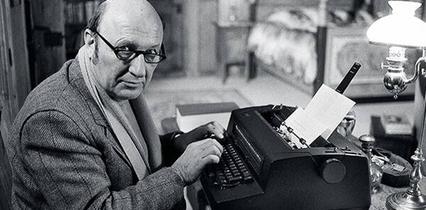Nos confrères américains de la revue littéraire underground Open City de Los Angeles nous ont fait parvenir cette semaine une chronique de Charles Bukowski écrite il y a quelques mois, lors du premier confinement de la Californie.L’un de nos rédacteurs s’est essayé à la traduction de cette nouvelle inédite du sulfureux auteur du Journal d’un vieux dégueulasse.

***
au bout de deux mois, je me suis dit que le départ de Marlène avait pas vraiment arrangé les choses. mon matelas était inondé de bière et plein de traces de vomi, et y’avait aussi de la pisse au pied du lit à cause d’un soir où j’avais bu comme une vache avant de tout lâcher dans mon sommeil. on trouvait également des cadavres de bières disposés un peu partout, des crottes de souris et de vieilles éditions de Thomas Wolfe et de Sinclair Lewis à moitié grignotées. « il faut que je me reprenne en main », je me suis dit. j’en étais là de mes réflexions quand le téléphone a sonné.
― allô, Hank ?
― lui-même, qui est à l’appareil ?
― c’est Billy Joe !
― oh, oh, salut Billy Joe, comment va ?
― j’ai connu mieux ! dis, tu sais où est Ashley ?
― non, j’en sais foutrement rien.
― je crois qu’elle a quitté la ville dans la nuit.
― ah.
― peut-être à Frisco ?
― c’est pas impossible.
― ou à Philly ?
― m’ouais.
― ok. merci du tuyau. bon, eh ben, je passerai te saluer un de ces jours !
― OK.
Billy Joe était un copain garagiste qui s’était lancé dans la poésie en prose et qui tournait à la coke comme un dingue. il écrivait des poèmes modernistes TRÈS mauvais et sortait avec Ashley qui écrivait encore plus mal que lui et passait son temps à donner des lectures dans des librairies hippies à la con. elle s’était récemment convertie au bouddhisme, ce qui n’arrangeait pas les choses. c’était un vrai manche à couilles et elle une conne finie. autant vous dire qu’ils faisaient la paire. au fait, si à tout hasard vous vous demandez à quoi peut ressembler un manche à couilles, rendez-moi visite, je vous en montrerai un ! pour me changer les idées et méditer sur la merditude des choses, je me suis bricolé une attestation et je suis sorti faire un tour. à l’angle de la 4ème rue et d’Ocean Boulevard, j’ai croisé un type qui m’a dit qu’il cherchait des livreurs pour une boite qui vendait des bouquins et plein d’autres trucs. « je suis fait pour ce poste, je connais bien les bouquins, j’en ai même écrit plein ! », je lui ai dit. il avait l’air sympa. moi aussi, apparemment. du coup, ils m’ont embauché.
***
je passais mes journées dans mon van de livraison, un Ford Transit 2T qu’était un vrai veau. aucune accélération, une reprise à chier par terre : c’était pas vraiment ce qu’on peut appeler un cheval de course mais je m’en foutais. j’étais content d’avoir trouvé un boulot et de pouvoir me promener sans risquer de drôles de rencontres avec mes vieux copains de la police fédérale. en général je petit-déjeunais à la bière, j’installais mes packs dans la cabine et puis je roulais toute la journée en pensant à pleins de trucs. c’était quand même un peu bizarre de trouver toutes ces rues complètement vides. on aurait dit que quelque chose de grave s’était passé et que tous les cons avaient foutu le camp dans un grand silence. partout, du bas de Longpre Avenue à chez moi, tout était MORT. chacun était chez soi, cloîtré, barricadé derrière sa porte et ses volets. et tous veillant sur leurs biens & leurs petites femmes & leurs gamins obèses & leurs intestins pleins de merde & leurs mutuelles santé & leurs impôts locaux & leurs Thanksgivings entre amis & les universités où ils enverraient leur sale progéniture & leurs barbecues entre voisins & leurs putains de vins français & leurs sales tronches de papier mâché BREF ils cogitaient certainement à leurs existences d’imbéciles malheureux. la ville s’était vidée de tous ces êtres qu’on appelait communément des hommes mais qui n’ont jamais été que des cadavres ambulants, trépassés intérieurement dès l’âge de 8 ou 9 ans, et qui tirent une grande fierté de leur réussite dans leur monde de morts-vivants. moins je voyais ces gens, plus je leur pardonnais d’exister. certains trouvaient que j’étais morbide. moi pas. je trouvais la situation plutôt bonne à vrai dire et toute cette histoire de virus ne m’intéressait pas. la seule histoire qui m’ait jamais intéressé ayant toujours été la mienne. et qu’on me fasse chier un minimum. pigé ? le seul truc qui me déprimait un poil c’était de voir cette ville si propre. Los Angeles était à coup sûr la ville la plus dégueulasse des États-Unis. peut-être même la ville la plus dégueulasse du monde. c’était le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. BORDEL, J’ADORAIS L.A ! et puis ce boulot me plaisait bien. c’était vachement plus sympa que toutes ces journées que j’avais passé à l’usine ou à l’abattoir à décharger des cageots de poissons assassinés, des biscuits pour chiens aux hormones ou des arbres de Noël en plastique. j’allais partout en ville pour livrer, à Beverly, à Fairfax, à Westlake. je montais toujours plus haut dans les collines, dans les quartiers rupins de L.A. j’étais émerveillé. quand on habitait là où j’habitais, on se persuadait facilement que partout régnait la même merde. je passais par Franklin Avenue attraper quelques bouteilles et puis je filais dans les hauteurs. je roulais comme un fou à cause des routes vides et je visitais toutes les villas d’Hollywood pour livrer mes colis. je garais ma Ford sur le trottoir, je montais les grands escaliers en pierre et c’était comme une formule magique. « j’ai un colis pour vous M’dame ! », je faisais. et toutes les portes s’ouvraient. pas que les portes, d’ailleurs… ce que je préférais c’était les jeunes mariées, dans la trentaine. elles m’ouvraient en nuisette ou en robe de chambre. j’avais 46 berges bien tapées mais je m’entendais toujours avec la jeunesse et bien que je ne sois pas certain de grand-chose dans l’existence, y’avait une chose dont j’étais sûr : je savais plutôt bien me servir de mon chibre ! le problème c’est que tous ces petits moments de bonheur me foutaient en retard. du coup, je roulais comme un dératé. dans l’ensemble je m’en sortais plutôt pas mal. la paie était bonne et puis, quand j’avais déposé mon dernier colis dans les hauteurs, je me mettais au point mort et je me laissais glisser jusqu’en bas de la colline. après les séances de baise express entre deux livraisons, c’était mon moment préféré de la journée.
***
et puis, comme d’habitude, j’ai fini par tout faire foirer. la journée avait été longue. j’avais pris pas mal de retard sur ma tournée parce que j’avais tamponné la Mercedes d’un sale petit richard sur Mean Street et j’avais été forcé de faire un constat avec cet imbécile en costard trois pièces, le genre de gogo à miser le paquet sur un doublet gagnant, si vous voyez ce que je veux dire. il était 20h passées quand je déposais mon dernier colis. j’ai pris Century Boulevard vers l’Est, j’ai descendu Crenshaw, puis j’ai remonté la 8ème jusqu’à Arlington. j’ai garé la Ford au dépôt, et j’ai marché longtemps pour me changer les idées. je me suis dit que la meilleure manière de se détendre serait d’aller me faire une virée vers Alvarado, dans ce quartier un peu louche, de l’autre côté du parc. à ma grande époque, j’avais été le plus grand baiseur de putes d’Alvarado Street. mais là, c’était différent. c’est pas que je cherchais particulièrement de la compagnie. simplement j’ai toujours bien aimé les putes. avec les poivrots, c’est à peu près les seules personnes à ne pas vous prendre de haut en ce bas monde. ça me changeait de tous ces types puants comme Norman Mailer & Truman Capote & m’sieur Green & mon voisin du dessus qui faisait chier avec sa poubelle & tous ces cons qui passent leur vie à raconter des conneries et à me gâcher la mienne. bien sûr tous les bars étaient fermés mais je connaissais un clandé, le Badabing, où j’avais tenu les murs des nuits entières du temps de ma folle jeunesse. j’étais à peu près certain qu’on me laisserait entrer. et je m’étais pas gouré. je m’accoudais donc au comptoir et commandais un Cutty Sark. à ce moment-là, j’ai enfin arrêté de penser à toute cette merde, j’ai regardé les filles danser et puis j’ai recommandé des Cutty Sark. un bon paquet. cinq heures plus tard, j’ai à peine réussi à ouvrir ma porte d’entrée avant de m’écrouler dans le living et puis j’ai rampé jusqu’aux chiottes. d’un coup, la diarrhée de l’alcoolo a sonné la charge. un torrent de merde s’est SOUDAINEMENT déversé sur mes jambes – des selles liquides empestant la vieille bière. je me suis accroché à la cuvette et, tout en me pissant à moitié sur les pieds, j’ai encore largué quelques crottes bien molles. sur ces entrefaites, je me suis évanoui. quand je me suis réveillé, l’étendue du désastre était pas vraiment descriptible. je me suis trainé du mieux que j’ai pu jusqu’à mon fauteuil vert et j’ai cogité à fond. avec cette chiasse d’enfer et ma mine de poète contemporain, je me suis dit qu’il fallait qu’j’appelle un toubib. y’avait qu’une solution. j’ai décidé de contacter Doug Ventimiglia.
***
Doug était un ancien véto du champ de courses de Santa Anita. mais il avait aussi roulé sa bosse à Hollywood Park, Los Alamitos, Del Mar et Pomona. il était spécialiste des ligaments et des fractures, notamment dans le trot attelé. il s’occupait des purs-sangs comme un chef et avait même déposé un brevet d’état pour des fers fabriqués dans un alliage de titanes légers, parfait pour les sabots fragiles et les terrains lourds. Douggy n’avait qu’un problème : il avait une fâcheuse tendance à aimer parier et à détester perdre. il chargeait donc les chevaux comme un malade. certains avaient perdu l’usage de leurs trains avant, d’autres l’usage de la vue et Doug s’était fait interdire de champ de courses dans toute la Californie et dans le sud de l’Arizona. on racontait aussi depuis quelques semaines que Doug avait abattu un jockey au 9mm sur un parking après une soirée poker qui avait dégénéré dans un rade d’East L.A. quoi qu’il en soit, Doug avait perdu son boulot et devait certainement trainer chez lui en s’envoyant des bières à l’heure qu’il était. bref, malgré son caractère soupe au lait, Doug était un mec super ! j’ai donc décroché mon téléphone.
― allô, Doug ?
― c’est du domaine du possible.
― Doug Ventimiglia ?
― ouais, lui-même. qui est le putain d’emmerdeur qui se trouve à l’appareil à ct’heure ?
― c’est ton vieux pote Hank !
― ah, ah Hank ! que se passe-t-il, mon vieux ?
― eh bien, il se trouve que je chie comme un cheval depuis cette nuit. je suis tombé dans les vapes et je me demande si ce serait pas le fameux conoravirus ? ça t’embêterait de passer jeter un œil ?
― tu parles, ça me ferait sacrément chier ! prends un cachet, tire-toi sur le manche et retourne te coucher !
― Doug, mes intestins sont déglingués et mon âme agonise.
― c’est ça ! et mes couilles sur ton front ça fera un dindon ?!! arrête de faire le con ! je prendrai pas une foutue amende pour ta face de rat ! TU M’ENTENDS ??
― par tous les saints, Douggy ! j’ai des furoncles au cul, les pieds glacés, des ulcères, de l’insomnie, des crises d’angoisse et maintenant je me chie dessus ! TOUT FOUT LE CAMP, BORDEL ! je paierai cette putain d’amende ! ramène ton cul, je t’en conjure !
― tu crèches où déjà ?
― dans un meublé au croisement de Santa Maria Street et d’Ocean Boulevard.
― quelle piaule ?
― chambre 103.
― bouge pas, j’arrive !
quand il a raccroché je me suis dit que j’avais raison : Doug était vraiment un mec au poil. à peine entré, Douggy m’a demandé un scotch et m’a dit que je devais me désaper pour qu’il puisse m’examiner. il avait pas croisé de fédéraux sur la route. c’était bien la seule bonne nouvelle de cette sacrée journée, vous croyez pas ? en me tournant pour poser ma chemise sur la table, je me suis regardé dans la glace de l’entrée. avec ma gueule constellée de cicatrices, mes foutus yeux en amande et mon torse velu et flasque, je ressemblais à un vieux gorille sous-développé mourant d’un cancer du cul. j’ai posé ma chemise, attrapé la bouteille à côté de la machine à écrire et Doug m’a examiné.
― ça fait mal quand j’appuie là ?
― euh, non, je crois pas.
― et là ?
― un peu.
― t’as de la fièvre ?
― non. juste une grosse chiasse.
― t’as bu combien depuis hier ?
― depuis hier soir ?
― ouais, ces dernières 24 heures.
― euh… j’dirais un litre de whisky, trois ou quatre bouteilles de vin et une trentaine de canettes.
― bon, ça va, t’es raisonnable mais calme quand même un peu le jeu le temps de te remettre, OK ?
― ok, Douggy, c’est noté. dis, t’aurais pas un petit calmant ?
― non, j’ai seulement un anesthésiant pour cheval mais tu risquerais de pas te réveiller. dors, c’est ce qu’il y a de mieux à faire. et puis, rhabille-toi dare-dare, sinon je vais faire des cauchemars et c’est moi qui vais faire de l’insomnie !
― ok, chef !
ensuite, j’ai proposé à Doug de rester pour qu’on discute. il avait l’air plutôt content d’avoir un peu de compagnie. les heures ont défilé, les canettes aussi. on a causé un bon moment et puis il m’a dit qu’il devait partir pour emmener son fils à l’école. la lumière blanche du matin commençait à percer à travers mes stores vénitiens sales. avant qu’il parte j’ai quand même voulu en avoir le cœur net.
― dis, Doug, c’est vrai cette histoire comme quoi t’aurais flingué Bill Shoemaker ?
― qui ça ?
― tu sais bien, William Lee, SHOEMAKER, putain, ce jockey de Westlake !
― je connais pas ce connard…
― mais si, par Dieu tout puissant, TU SAIS BIEN !!! le gars qui montait Pie-O-My, à Santa Anita !
― ah ouais ! ça me revient !
― alors ?
― alors quoi ?!
― alors, est-ce que t’as vraiment buté ce mec ?
― j’en sais rien, Hank… ils disent quoi les gens ?
― ils disent que c’est vrai.
― alors, c’est que ça doit sûrement être vrai. bon, faut qu’j’me tire. bonne journée Hank !
― ouais, à la prochaine Doug !
j’ai dormi toute la journée et le lendemain j’étais de nouveau sur pied pour reprendre mon service. j’ai bien lâché quelques belles caisses odorantes dans l’habitacle mais dans l’ensemble l’orage était passé. les jours se suivaient et se ressemblaient. toujours pas de bars ouverts, toujours pas de champs de courses accessibles.
***
et puis un jour j’ai sonné au 358 Baxter Street. la porte s’est ouverte et une rouquine avec un cul à se damner m’a ouvert la porte.
― bonjour !
― bonjour m’dame, j’ai un colis pour vous. vous êtes bien Jenny ? Jenny O’Brien ? vous pouvez signer là ?
― bien sûr ! dites, vous prendrez bien un verre, avec cette chaleur ?
― c’est vrai qu’il fait une chaleur à tuer un foutu bœuf. et puis vous êtes ma dernière cliente alors ça se refuse pas !
Jenny avait un accent européen. ça me plaisait bien. comme vous le savez certainement, les américains sont presque tous des débiles congénitaux. il suffit de regarder 3 minutes de Super Bowl ou de se tenir à la sortie de n’importe quelle université d’État pour voir que ce pays est un repaire de demeurés. les européens sont des connards aussi mais eux, au moins, sont plus raffinés. bref, je suis entré dans le vestibule, j’ai retiré ce damné masque et puis j’ai regardé un peu la bibliothèque pendant que cette femme sublime allait ranger son carton en roulant du cul. y’avait beaucoup de merdes. Auster, Updike et Tennessee Williams, l’Atlantic Review, Harper’s et le New Yorker. mais aussi quelques bons trucs comme Ask the Dust, des traductions de Céline et les premiers romans d’Hemingway. ensuite on s’est assis et elle m’a servi une double vodka-7. elle a pris la même chose.
― dites-moi, vous avez pas que des mauvaises choses dans votre bibliothèque…
― c’est celle de mon ex-mari. il était orthodontiste !
― ah… en tout cas il a bon goût : il a une rudement belle baraque et une ex-femme du tonnerre !
― merci… mais, dites, je vous reconnais ! c’est pas vous qui écrivez de la poésie ? des trucs en prose un peu vulgaires ?
― poupée, la littérature n’est JAMAIS vulgaire ! et puis je n’écris pas de la poésie. la poésie est exclusivement produite par des tapettes, des fleurs bleues, des lesbiennes, ou pire, des professeurs de lettres. c’est-à-dire des gens qui ne connaissent rien à l’existence.
― vous n’aimez pas l’université ni les sentimentaux ?
― j’aime pas les gens visqueux. et puis personne d’un peu sensible n’accepterait de mettre un pied à l’université, même s’il en a les moyens.
― mais pour écrire il faut bien lire un peu, vous croyez pas ?
― absolument PAS ! pour que ce soit réussi, écrire un poème devrait être aussi naturel que chier un coup ou changer une ampoule !
pendant que je prenais l’air malin je jetais un œil à son décolleté. c’était vraiment une superbe créature. j’avais dans l’idée de la jouer gentleman mais le problème était toujours le même : je parvenais pas à mettre en veilleuse ma divine queue. j’avais un braquemart comme la statue de la Liberté. on a continué à boire des vodka-7 une bonne partie de l’après-midi. puis de la soirée. et à un moment on est montés au premier étage. quand on est entrés dans la chambre, Jenny a retiré sa robe noire et son soutien-gorge. la lumière blanche de la lune faisait briller sa peau laiteuse et la courbe pleine de ses seins. « approche-toi, n’aie pas peur », elle a dit en chuchotant. je me suis approché, je l’ai déposée sur le plumard et j’ai commencé à lui lécher la cramouille. c’est Marlène qui m’avait appris ça. au début j’étais complètement paumé mais après quelques années de pratique régulière j’étais devenu expert en la matière ! j’ai pris mon temps et Jenny a joui une première fois. et puis elle m’a demandé de la prendre pour de vrai. je me suis levé pour boire un verre d’eau et retirer mes fringues. avec mes 107 kilos et mon bide flasque et luisant, j’ai eu peur de l’écraser. finalement, je suis entré en elle et Jenny s’est mis à onduler sous moi, comme un serpent tout en me tenant serré dans l’étau de ses cuisses. je l’ai d’abord ramonée de toutes mes forces et puis j’ai pris mon rythme de croisière. on suait comme des fous, on avait quand même un peu bu. ça a duré comme ça une demi-heure, peut-être plus, je ne me souviens plus bien. la seule chose dont je me rappelle c’est que c’était bon. à la fin, je me suis retiré et je me suis laissé tomber à côté d’elle. Jenny riait.
― alors la môme ? keski te fait marrer ?
― rien Hank, je suis contente !
― je suis comique quand je tire ma crampe ? tant mieux, héhé ! c’était sympa au moins ?
― oui, c’était bien… bonne nuit Hank !
― bonne nuit poupée.
et puis on a fermé nos gueules. après quelques instants, Jenny dormait paisiblement. elle avait posé sa tête sur mon torse et sa longue crinière rousse me chatouillait les narines. et moi j’arrêtais pas de réfléchir à pleins de choses. je repensais à de vieilles histoires. à la première fois que j’avais sauté Marlène à l’arrière de sa Mustang Shelby, à la dernière fois que j’avais emmené ma fille dans la grande roue de Santa Monica et puis à mon père qui n’aimait pas les gens. et qui ne m’avait pas tellement aimé, moi non plus. mon père, ce monstre dégénéré qui m’avait éjaculé dans cette vallée de larmes et qui, pour se récompenser de cette action méritoire, m’avait foutu des raclées pendant toutes ces années. alors, je me suis senti devenir tout drôle, et subitement j’ai senti monter des larmes. et j’ai chialé. je sentais toute cette merde me remonter doucement dans la gorge et dans les yeux, je reniflais et j’avalais ma morve à pleine bouche en essayant de pas faire trop de bruit. Jenny ronflait paisiblement, avec régularité. et ça nous faisait comme une berceuse, à mon chagrin et moi. au bout d’un moment ça s’est arrêté, j’avais pleuré tout mon soûl. j’avais bien dû perdre trois kilos de foutre et de larmes dans la bataille. je me sentais sacrément léger ! alors je me suis endormi.
***
le lendemain, j’ai ouvert l’œil vers midi. une bonne odeur de toasts grillés et de bacon montait du rez-de-chaussée. je me suis levé, me suis passé un coup de flotte sur la tronche, j’ai enfilé mon caleçon et je l’ai remonté afin d’y ranger mes couilles. quand je suis descendu Jenny était en robe de chambre et touillait quelque chose dans une poêle. je me suis approché d’elle sans rien dire et je lui retiré sa robe de chambre. on est remonté faire 2, 3 trucs. quand on est redescendu les toasts étaient froids et le bacon cramé. mais le petit-déj était au poil. finalement, je suis resté 2 jours chez Jenny. on mangeait, on baisait pas mal, on parlait parfois, on écoutait Stravinsky et je lui expliquais les rudiments de la boxe mi-lourd et de la course de galop sur 1 600 mètres. c’était pas une femme compliquée. et puis le vendredi matin on a reçu un coup de fil.
― allô ? m’dame O’Brien ?
― oui ?
― est-ce que Hank Chinaski est ici ?
― qui ?
― Hank Chinaski, m’dame, un de nos livreurs ?
― oui, oui, il est là ! je vous le passe.
― Hank ?
― affirmatif !
― ça fait trois jours qu’on t’a pas vu au dépôt, bordel de Dieu ! on vient d’appeler tous tes clients un par un pour te mettre le grapin dessus…
― je suis horriblement confus Gary, j’ai eu un problème avec la Ford.
― laisse tomber ton baratin, Hank. t’es viré !
― je comprends.
― tu passeras ramener le van d’ici ce soir ?
― ouais, j’y manquerais pas.
― à tout à l’heure alors !
― à tout à l’heure Gary.
― HEY, attends ! Hank ?
― ouep ?
― sans rancune, hein ?
― ouais, sans rancune.
à 19h j’ai dit au revoir à Jenny et je suis passé rendre le van au dépôt. et puis je suis rentré chez moi. à mon arrivée, je me suis préparé un sandwich au corned-beef, je me suis gratté le cul un bon coup et je me suis assis dans mon fauteuil préféré. y’avait encore du vin séché sur mon tapis, mes chiottes étaient pas vraiment en odeur de sainteté et ces satanés souris avaient quasiment terminé de dévorer Babbitt. ça faisait longtemps que j’avais pas été aussi heureux. les derniers rayons de soleil filtraient à travers mes stores vénitiens toujours sales et les néons du vendeur de tacos d’en face commençaient à clignoter. il faisait une chaleur atroce et la nuit tombait doucement sur la cité des Anges. tout allait pour le mieux. il me restait plus qu’à décapsuler une bière.