
Dans ce qu’il faut à présent considérer comme ses deux derniers textes, Le dernier livre de Madrigaux et La Clarté Notre-Dame, parus aux éditions Gallimard, Philippe Jaccottet témoigne avec pudeur et tendresse de la joie que le simple fait d’être au monde procure encore à une vie qui touche à sa fin.
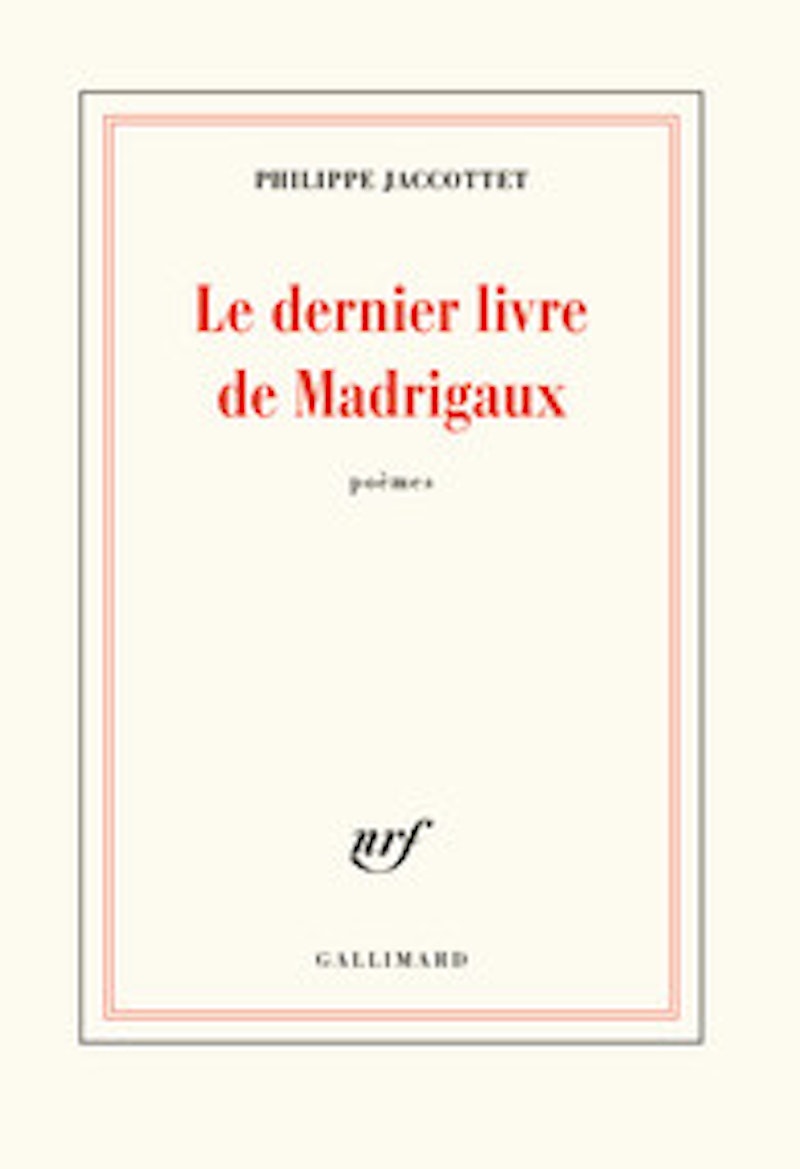
Si la mort menace peut-être ici plus qu’ailleurs, elle n’entame néanmoins pas l’émerveillement d’être au monde qui saisit encore Philippe Jaccottet, suscitant sa surprise à chaque fois. Tel est pourtant le juste tribut payé à celui qui s’efforce de voir et d’entendre les « signes du monde », et dans l’après-coup de les faire voir et de donner à les entendre par le poème. Au fond, n’était-ce pas également cela traduire pour Philippe Jaccottet ? Traduire Hölderlin, Leopardi, Goethe, Ungaretti, Homère et quelques autres qui accompagnent cet ultime retrait dont la lumière le dispute à l’ombre.
À l’écoute

La Clarté Notre-Dame renvoie au monastère des sœurs dominicaines de Salernes, une petite commune du Var, lieu à partir duquel les notes de Philippe Jaccottet s’organisent. Alors que ce dernier marche silencieusement en compagnie de quelques amis dans ce « grand paysage descendant en pente douce vers un lointain vallon », le « tintement » de « la petite cloche des vêpres du couvent de la Clarté Notre » se fait entendre. Rétif au langage, ce son « véritablement cristallin » interpelle cependant Jaccottet. Il l’enjoint à surmonter l’infirmité du verbe par une série de métaphores qui, avec « une grande exactitude » – ce « devoir » de la poésie –, font entendre et sentir l’événement que fut ce tintement. Un « Appel » ou un « rappel » donc qui s’incarne dans un oiseau fendant le ciel, dans la percée d’une éclaircie, dans l’alliance du matin avec la rosée. « Au nombre des surprises », ce tintement est en somme « l’étonnement heureux » suscité par les « signes du monde [qui] atteignent encore » Jaccottet dans son « grand âge » que l’émoussement naturel n’atteint pas.
Le son de cloche relance la vivacité du poète et ravive une attention dont il craignait, l’âge avançant, qu’elle lui fasse défaut. Son retentissement intérieur ramène à la surface du présent les souvenirs joyeux de l’enfance et les voyages en Italie d’antan sur les traces de Rilke. Tout se passe donc comme si l’imminence de la mort, dont Jaccottet ne fait pas mystère, était un tant soit peu différée, comme si finalement la vie surgissait encore à l’oreille du poète : « Ainsi ma vie, si près de s’achever, se découvrirait-elle enfin comme une apparence de sens, aussi fragile mais aussi tenace que tous ces signes dont j’aurais été alors le cueilleur, le ‘‘recueilleur’’, et le trop maladroit interprète ? »
Son étonnement d’être en vie est à situer dans l’écoute attentive du monde dont, en fin « organiste », il nous restitue quelques-unes des manifestations avec son habituelle douceur mélodique.
Nulle imposition en effet dans sa voix, nulle volonté d’agréger le lecteur à son point de vue, juste un simple « recueil des signes qui est presque toute ma poésie », écrit-il.
Ce refus viscéral de la souveraineté et de l’oraculaire est sans nul doute ce qui fait la légèreté de ces deux petits livres en dépit de l’inéluctable dérive vers la mort qui les habite. La vacance de l’égo ne représente pas un prélude au chant de la dernière heure, ni à quelque « cérémonie de la fin » que le poète n’arrive pas à envisager. Elle ouvre plutôt sur les murmures de l’invisible où bataillent la clarté du jour et l’ombre funeste.
Dans la clarté du jour
À l’écoute presque émerveillée de la cloche s’oppose une image, celle d’un journaliste emprisonné en Syrie sous le régime effroyable de Bachard el-Hassad qui enfin libéré traverse les couloirs de son enfer et entend les cris de torture des détenus. Question d’écoute, encore une fois. L’image hante Jaccottet qui s’interroge, presque honteux, sur son existence, « ma belle enclave protégée on ne sait comment ni pourquoi du malheur ». Elle le poursuit et le conduit à mettre en balance sa poésie avec l’affreux épisode du journaliste. Que s’est-il joué, au fond, dans la poésie, dans ce chant « risqué à voix basse ou même quelquefois, rarement certes, clamé à pleine gorge comme une explosion de soleil sous les voûtes de pierre » ? L’acte paraît bien vain mis au-devant de la torture. Et Jaccottet de dire combien a pu le retenir le rêve de « composer, pour écran à la mort, le tissu, le rideau, l’écran de mots poétiquement le plus admirable », ou encore d’« élever là devant toi pour bouclier le chant le plus pur que jamais musicien ait pu produire ».
La portée du poème, Jaccottet le sait, est certes plus modeste, ce qui ne signifie pas pour autant moins importante. Si elle ne vainc pas la mort, elle jette tout de même quelques lumières sur l’existence de « ce voyageur surpris dans le frémissement de l’aube, dans sa fragilité, à la suite des oiseaux, sur l’espace grand ouvert » : « Mais la lumière de ma vie, oiseaux cruels, / laissez-la-moi pour éclairer novembre. » L’éclaircie a beau être de courte durée, elle laisse toutefois apparaître la position depuis laquelle la vie se déclare la plus intense, c’est-à-dire à « la fenêtre » ou sous le boisseau d’un arbre, à la lisière du dehors en tout cas, à proximité de la clarté du jour :
Considérez le ciel solaire
à l’heure de l’extrême incandescence
C’est là qu’il nous faut traverser.
Voilà où se situe la victoire. Non pas dans « la beauté du monde » qui viendrait en effacer « la douleur », mais dans le poème, « ce débordement de lumière » où « chacun n’aurait plus qu’à tendre la main / pour se gorger d’étoiles mures ». Victoire intermittente et fragile de la lumière sur la nuit promise qui s’accompagne, comment ne pas le remarquer, de « cet office protecteur » que sont les plus grands poètes aux yeux de Jaccottet.
En bonne compagnie
Philippe Jaccottet a rarement écrit seul. Au détour d’une formule ou d’un rythme, l’on croit deviner, quand il ne les cite pas explicitement, quelques-uns des écrivains ou des musiciens qui ont tout particulièrement compté pour lui. Ses deux derniers ouvrages n’y font pas exception, peut-être furent-ils écrits « En écoutant Claudio Monteverdi » comme le laisse à penser le titre d’un poème. L’on y trouve partout l’« esprit imprégné de musiques, de paroles, d’images italiennes » du poète. La référence au madrigal, cette composition vocale polyphonique d’origine italienne, ne fait que le confirmer.
La voix du poète se double ou s’adosse à d’autres voix plus ou moins reconnaissables.
Ainsi, le cours d’eau qui borde le couvent de la Clarté Notre-Dame ramène Jaccottet à l’Enfer de Dante où le poète italien accompagné de Virgile suit un sentier menant aux étoiles. L’univers et les quelques figures mythologiques des poèmes convoquent en revanche l’Odyssée d’Homère dont Jaccottet livra une traduction mémorable en 1955. L’image omniprésente de la barque dérivante « dans les parages rocailleux de la mort » emprunte, quant à elle, à la fois à l’auteur de la Divine Comédie et au poète et ami Ungaretti dont Jaccottet se remémore la difficulté qu’il connut lorsqu’il tenta de le traduire.
Et si les poètes bordent le long chemin de la mort, ils sont aussi l’énergie qui n’a cessé d’alimenter et alimente encore les mots de Philippe Jaccottet. Le tintement de la cloche du couvent renvoie dès lors à la « Clochette de l’Élévation » de Giacomo Leopardi et fait songer le poète vaudois à l’expression de Plotin, le « Très-Haut », qui qualifie l’ambition démesurée du poème. Jaccottet ne nie pas la « résonance religieuse » du mot et la référence au « sacré » qu’il contient qui lui rappelle l’objet de la quête poétique d’Hölderlin. Ce frère en poésie – « certainement la rencontre la plus importante de ma vie de lecteur de poésie » – Jaccottet s’est astreint à le lire et à le traduire, ici encore par fragment, notamment lorsqu’il dirigea en 1967 le volume des Œuvres du poète allemand pour la Bibliothèque de la Pléiade.
De ce compagnon d’infortune, Jaccottet n’a pas complètement retenu le projet fou, mais la « sourde joie » que peut offrir le poème. Malgré une incertitude constante, jusqu’au bout la joie de nommer avec justesse et justice n’aura pas quitté Jaccottet dont il fait encore preuve dans ces deux minces ouvrages. Les derniers, donc, où ce qui ne manque pas d’émouvoir, c’est la douceur du retrait dans laquelle ils furent écrits et qui n’a pas cessé de nous requérir ces années durant. Cette fois, Philippe Jaccottet a définitivement pris congé de ce monde dont il s’était déjà retiré pour mieux nous montrer, toujours avec patience et minutie, « l’éclat violent du jour ».

















