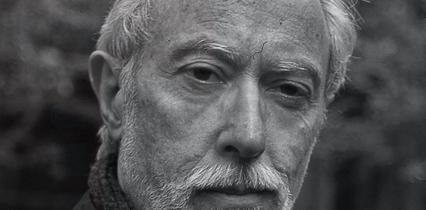*
Vie du poème est un essai qui prend racine dans vos expériences. Vous y évoquez, entre autres, l’influence de vos études, de vos expatriations – Japon, Chine, Singapour – ainsi que de votre vie familiale – l’ouvrage est d’ailleurs dédié à votre compagne ainsi qu’à vos filles – sur l’évolution de votre travail d’écrivain. Au fil des pages, on pressent la volonté de dresser un premier bilan de celle-ci. Pour les lecteurs qui ne seraient pas familiers de votre œuvre, pouvez-vous présenter votre parcours ainsi que les livres que vous avez publiés jusqu’ici ?

Maintenant je remonte le temps.
Entre 2007 et 2015, tous mes efforts se sont concentrés autour de la question de l’épopée, que j’ai essayé d’aborder par des chemins variés
Entre 2007 (date de ma première publication) et 2015, tous mes efforts se sont concentrés autour de la question de l’épopée, que j’ai essayé d’aborder par des chemins variés : poésie (Barbares, Flammarion, 2009 ; Les Gestes impossibles, Flammarion, 2013), traduction (Kojiki, Le corridor bleu, 2011), roman (La Fosse commune, Le corridor bleu, 2016) et même conte (L’Empereur Hon-Seki, Le corridor bleu, 2012). J’ai surtout fait une thèse (De l’épopée et du roman, PUR, 2015) grâce à laquelle j’ai compris que je n’allais pas écrire d’épopée (même si je m’échinais à en reproduire les signes extérieurs), car ce qui comptait pour un texte n’était pas ce à quoi il ressemblait (ou les postures auxquelles ses caractéristiques lui permettaient de prétendre), mais ce qu’il faisait ou essayait de faire, son effort. C’est à la suite de cette réflexion que je me suis engagé, à partir du Cours des choses (Flammarion, 2018) et Sans adresse (Lurlure, 2018), à faire ce que j’avais à faire, tout simplement.
Si je remonte encore, entre 1999 et 2007, j’ai écrit tous azimuts, dans les maigres plages de temps que me laissaient des études chronophages, mais formatrices. J’étais à cette époque très marqué par l’œuvre de Perec, ce qui se sent dans mon premier livre publié (L’Armée des chenilles, Gallimard, 2007), un roman dont l’histoire est née sous la contrainte de déambulations dans Paris, à partir de la rue Georges-Perec dans le XXème arrondissement.
Parmi les influences que j’évoquais plus haut, vous réservez un traitement particulier à vos influences poétiques. Embarqué dans une entreprise de désacralisation de l’activité littéraire – on aura l’occasion d’y revenir – vous faites de vos modèles, Pound plus particulièrement, non des maîtres derrière lesquels se ranger en disciples bien élevés, mais des auteurs avec lesquels dialoguer, contre lesquels se battre. Le modernisme littéraire, notamment dans son incarnation états-unienne, apparaît comme le mouvement autour duquel vous gravitez et dans la tradition duquel vous vous inscrivez – vous citez dans Vie du poème, de nombreux représentants du modernisme (Pound bien sûr, mais aussi William Carlos Williams, T.S. Eliot) et de l’objectivisme (notamment Zukofsky et Oppen). Pourtant, cet impératif, disons, affectif – « écrire ce qui compte à ceux qui comptent » – apparaît éloigné de leurs préoccupations. Est-ce là une nouvelle façon de vous battre avec “vos” auteurs ? d’amener leurs principes sur un terrain nouveau ?
Il serait bien paradoxal qu’« écrire ce qui compte à ceux qui comptent » ne soit qu’une manière de se distinguer, une gesticulation, un coup marketing dans l’histoire littéraire ! À l’évidence, ceux qui sont visés par une telle formule, à qui il s’agit d’essayer de faire quelque chose, par rapport auxquels il s’agit de se positionner, sont ceux qui comptent — non pas tel ou telle poète.
Le modernisme est un projet d’artisanat existentiel, que je définirais ainsi : dresser, par le travail du poème, dans l’extériorité d’une forme, le sens de la vie dans sa vitalité.
Du reste, il ne me semble pas évident qu’une telle perspective soit aussi éloignée que vous le dîtes des préoccupations des auteurs que vous citez : William Carlos Williams n’a-t-il pas écrit, avec Journey to Love (dédié à sa femme) de merveilleux poèmes d’amour ? Et avec Paterson, une déambulation dans des lieux importants pour lui (la rivière, le parc, la bibliothèque de sa propre ville), déambulation dans laquelle s’incrustent des extraits de sa correspondance avec des poètes et des proches ? Louis Zukofsky, quant à lui, n’a-t-il pas explicitement adressé une partie de son œuvre à son fils Paul ? En réalité, le modernisme n’est pas une tradition, une école littéraire ou un courant (par rapport auquel il faudrait se déterminer, pour ou contre), mais un projet d’artisanat existentiel, que je définirais ainsi : dresser, par le travail du poème, dans l’extériorité d’une forme (plutôt que dans l’intériorité de sa conscience), le sens de la vie dans sa vitalité.
Pour ma part, j’ai trouvé que ce projet s’incarnait dans cette formule « dire ce qui compte à ceux qui comptent », dont il faut bien voir que tous les termes sont en fait des questions (qu’est-ce que « dire » ? comment « dire » ? qu’est-ce qu’une parole pleine ? qu’est-ce qui compte ? l’eau, la nourriture, la santé, la paix, la richesse, l’amour, la poésie, la Terre ? ce qui compte précède-t-il le fait de le dire, ou dire doit-il révéler ce qui compte ? et qui sont ceux qui comptent ? ceux qui nous aiment, ceux qu’on aime ? ou tous les êtres humains, tous les vivants ?) : je prends donc cette formule à la fois comme une solution humble, dégonflée et pragmatique (à la question : pourquoi écrire ? elle me semble plus intéressante que la réponse habituelle : « pour faire de la littérature », et ses déclinaisons mythologiques « produire un dérèglement des sens », « subvertir l’ordre du discours », etc.) et comme la définition d’un nouveau champ d’investigation, théorique et pratique. Peut-être les « objectivistes » n’avaient-ils pas entendu ainsi leur propre projet, mais qu’importe ? Le plus terrible, ce serait d’en imiter docilement les formes extérieures, vous ne trouvez pas ?
Vous mentionnez également l’importance de la traduction dans votre approche d’un texte – celle de The Waste Land de T.S. Eliot vous ayant permis de “comprendre” le bouleversement apporté par cette oeuvre. La traduction est-elle un (sport de) combat comme un autre ?

À ce matériau autobiographique et à ce parcours d’une écriture sous influence(s), s’ajoute une réflexion sur la création poétique. Résidus peut-être de votre cursus philosophique, vous l’abordez en méthodiste et détaillez les étapes de la création – votre recette de poème –, d’une prise de notes quasi ethnographique jusqu’au dressage final du poème. Pensez- vous que le poème obéisse à un protocole particulier ?
Ma formation philosophique n’a pas grand rapport avec l’écriture : elle m’aide seulement à styliser a posteriori, à l’aide de concepts, dans des essais, une activité qui, au moment où elle a lieu, est libre et sauvage comme le daim gambadant dans les bois roussis, sous les premiers flocons.
Fort heureusement, le poème n’obéit à rien du tout. Vie du poème propose un regard rétrospectif, et essaie de comprendre a posteriori comment j’ai travaillé, mais il va de soi que lorsque je suis à la tâche, en train de composer, je n’essaie aucunement de suivre une recette : c’est même tout le contraire. Chaque texte, chaque séquence me surprennent par leur manière de trouver peu à peu leur propre voix, leur propre forme, et j’assiste à cette éclosion avec le même ravissement et la même gratitude que lorsque je découvre, en allant faire mes courses, que les premières neiges, d’un blanc fluo, sont tombées au-dessus des vallées dorées par l’automne (comme ce matin). Aucun Grand Horloger n’a réglé le passage des saisons, et l’émerveillement qu’elles peuvent procurer n’obéit à aucune décision : c’est la contingence, et la nécessité nouvelle dont cette contingence semble la promesse, qui font la beauté. D’une année sur l’autre, ce n’est jamais exactement pareil : les vendanges sont plus ou moins tardives, les neiges plus ou moins précoces. Cela n’empêche pas que le climatologue peut venir après coup analyser l’évolution du cycle des saisons. De même, j’ai essayé dans Vie du poème d’observer, de décrire et de comprendre les régularités qui faisaient que ça marchait quand ça marchait, mais je ne dirais certainement pas que le poème en général suit une méthode a priori. Quel intérêt prendrait-on à l’écrire ? Certaines séquences, bien sûr, naissent de protocoles particuliers, mais même quand c’est le cas (comme dans la partie centrale de l’Éducation géographique, où il s’agissait d’aller dans un endroit avec un livre qui n’avait rien à voir, pour m’en servir comme d’un tamis filtrant le paysage) cela ne garantit en rien la valeur des textes, qui tient à bien d’autres choses qu’au caractère reproductible de ses conditions d’écriture. Donc pour vous répondre, ma formation philosophique n’a pas grand rapport avec l’écriture : elle m’aide seulement à styliser a posteriori, à l’aide de concepts, dans des essais, une activité qui, au moment où elle a lieu, est libre et sauvage comme le daim gambadant dans les bois roussis, sous les premiers flocons.
Toujours à propos des conditions d’émergence du poème, vous évoquez dans votre premier chapitre – “Naissance” – le mythe rilkéen selon lequel seule une nécessité intérieure doit pousser le jeune auteur, et qui plus est le jeune poète, à écrire. Vous le résumez en ces termes : « abstenez-vous [d’écrire], si vous n’êtes pas acculé ! ». Outre de réifier la pratique poétique, vous lui reprochez de « décourager le jeune poète ». Vous préférez parler de “projet”. En quoi s’agit-il d’un contre-modèle à l’écriture “nécessaire” ?
Dans ses Lettres à un jeune poète, Rilke postule que pour écrire le poète doit ressentir une nécessité : « Demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit : dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s’il vous est permis d’aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple ‘je dois’, alors construisez votre vie selon cette nécessité. » (c’est Rilke qui souligne). Quelle réponse plus intimidante, pour le jeune destinataire de cette lettre ? Bien sûr que non, il ne ressent pas une telle nécessité, un tel devoir !
La « vocation » se construit plutôt comme le fruit d’une négociation entre ce que propose une société comme possible, et la manière dont des individus pensent pouvoir l’investir pour en faire ce qui les intéresse.
Imaginez qu’au début du XXème siècle, lorsque les Américains introduisent le basketball en France, un joueur de New York expérimenté vienne dire aux jeunes sportifs qui se porteraient candidats pour former la première équipe française : « Si ce n’est pas le sens de votre vie, pas la peine d’essayer de lancer la balle dans le panier ! Que ceux qui ne sentent pas a priori que le basketball est la chose la plus importante, dégagent ! » Il ne restera sur le terrain que les fous et les imposteurs ! Comme le basketball, l’écriture n’est pas une chose « naturelle » (ce sur quoi l’on écrit et la manière dont on le fait, les raisons pour lesquelles on le fait, varient selon les époques et les sociétés) ; le programme génétique de personne n’est a priori câblé pour la poésie contemporaine ! La « vocation » se construit plutôt comme le fruit d’une négociation entre ce que propose une société comme possible, et la manière dont des individus pensent pouvoir l’investir pour en faire ce qui les intéresse. J’appelle «projet» cette part d’investissement subjectif, avec ce triple avantage sur la « nécessité » qu’il ne s’agit d’abord pas d’une force « intérieure » (sur un modèle psychologisant), qu’il permet d’autre part de comprendre l’écriture dans son rapport avec les autres activités sociales, et qu’enfin il n’est pas censé être là d’emblée et une fois pour toutes. On peut en changer, on peut le laisser tomber ; mais au moment où l’on est engagé dans un projet, il détermine autant notre rapport au monde que si l’écriture nous était « nécessaire » au sens de Rilke.
Toujours dans cette même recherche de désacraliser l’objet littéraire, à partir de la moitié de l’ouvrage, vous vous appuyez sur la thèse des trois mondes de Karl Popper. Selon celle- ci, il existerait trois mondes : la réalité matérielle (monde 1), la réalité psychique subjective (monde 2) et la réalité idéelle (monde 3). Si le monde 3 existe pour les théorèmes et autres lois physiques, vous vous attachez à montrer qu’il « n’y a pas de monde 3 “Littérature” ». Cette dernière serait prise entre la réalité de la chose et celle du sujet. Plutôt qu’une substance, elle apparaît dans vos lignes comme une relation entre trois concepts – la chose, la pensée, la parole – tous trois tournés vers le Réel. Vous matérialisez cette relation par une figure géométrique : le tétraèdre. Si la littérature n’existe pas, le poème, lui, est. Comment penser cette ambiguïté ?
La littérature, si elle existe, serait définie comme l’ensemble des textes qui ont une valeur en soi (ainsi que les rapports qui les régissent, comme dans ce genre de pseudo-lois : « le personnage à l’ancienne n’est plus possible », « la poésie est l’expression des sentiments » ou « la poésie doit évacuer le lyrisme », « le vers libre a définitivement remplacé l’alexandrin »), de même que la science physique est constituée de lois qui s’appliquent indépendamment de ce qu’en pensent les chercheuses et les chercheurs. Dans les deux cas, nous avons des constructions humaines (les lois pas plus que les œuvres ne se fabriquent toutes seules, il faut des scientifiques pour les formuler) qui prétendent s’émanciper de la subjectivité et atteindre une forme d’objectivité. La croyance en la littérature s’observe notamment dans des énoncés faisant de « l’histoire littéraire » non pas une reconstruction stylisée a posteriori (c’est-à-dire une sorte de roman utile car simplificateur), mais un ensemble de faits. Tout se passe comme s’il existait un monde (situé on ne sait où, ni matériel ni psychologique, appelons-le comme Popper « monde 3 ») dans lequel ces événements étonnants (car pourquoi diable l’alexandrin ne serait-il plus utilisable ? qu’est-ce donc que cette impressionnante crise de vers ?) avaient eu lieu. Dire qu’il y a ici une méprise ontologique n’empêche pas qu’existent des traces noires sur des pages (dans le monde 1) qui, lorsqu’elles sont dûment interprétées par des personnes, leur procurent des émotions ou les font réfléchir (dans le monde 2). Ce sont des textes. Lorsque ces traces noires se déploient dans des formes qui les rendent rétives à la synthèse conceptuelle, en appellent à une paraphrase qu’elles rejettent pourtant du même geste, et ouvrent par ce fait à une méditation, une rêverie, ou un commentaire jamais destiné à s’arrêter, on peut les appeler « poèmes ». Nous sommes toujours dans le monde 2.
On peut trancher la question de manière simple : regardez les autres cultures, par exemple, celle des « peuples premiers » d’Australie, d’Amazonie, etc. Ils ont bien des textes qui ressemblent beaucoup à ce que nous appelons des « poèmes », et qui fonctionnent sensiblement de la même manière (il suffit de lire les Techniciens du sacré pour s’en convaincre). Pourtant ceux-ci ne relèvent aucunement de cette construction imaginaire aux lois abracadabrantes que nous appelons « littérature ». Si vous dîtes à un aborigène pintupi que nous écrivons des poèmes, il ne tiquera pas ; de même si vous précisez que nous essayons par là de dire ce qui compte à ceux qui comptent (ce n’est pas très éloigné d’une fonction cultuelle), mais il me semble impossible de le faire adhérer aux critères qui permettraient de dire que « l’œuvre de Mallarmé est importante » en soi ! Il ne comprendrait rien non plus à ces histoires de « genres » et de « courants » littéraires par lesquels on simplifie à l’extrême l’histoire des textes et de leurs effets. Or il me semble raisonnable de dire que, si une croyance est partagée par une communauté mais qu’elle est dénuée de sens pour l’ensemble des autres, il y a des chances pour qu’elle soit fausse. Alors que le poème, lui, est une réalité anthropologique.
Si le poème est une “réalité anthropologique”, vous allez jusqu’à lui attribuer un semblant de volonté. Vie du poème a parfois des allures de prosopopée ! Dans le chapitre “Fécondation”, vous notez : « ce que cherche le poème, c’est à ce que nous passions le plus de temps possible avec lui ». Plus loin vous ajoutez : « un texte doit être intéressant, cela veut dire : il est en compétition avec toutes autres sortes de choses pour capter du temps d’attention, et il doit le savoir ». Vous énoncez à ce propos un impératif catégorique singulier : « écris toujours de telle manière que ton poème pourrait se retrouver sans légende particulière sur Instagram ». Aujourd’hui, quels sont les outils du poème pour séduire nos regards sans cesse sollicités ?

Cette autonomie du poème correspond exactement à la possibilité qu’il a d’être « intéressant » : il peut, comme un hapalémur sautant de branche en branche, mobiliser notre attention, sans avoir besoin des justifications théoriques qui “sauvent” les textes indigents. Cela ne veut pas dire qu’il n’appelle pas le commentaire. Mais disons qu’un tel discours vient après : le poème intéressant ne l’illustre pas mais le déclenche, tout simplement parce que décrire ce lémurien et commenter ses actions nous permet de rester plus longtemps encore à le contempler. Se retrouver « sans légende sur Instagram », cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas parler de poésie (d’ailleurs, on ne fait que ça, depuis tout à l’heure !), mais que ce commentaire lui-même est en fait une modalité de l’attention que nous lui portons.
Arrêtez le tourisme : traduisez des poèmes. Les émissions de CO2 chuteront, les températures baisseront, le plastique disparaîtra des océans et les forêts repousseront : les hapalémurs seront sauvés.
J’en viens maintenant à votre question : les outils du poème sont évidemment extrêmement rudimentaires, quelques mots sur une page. C’est misérable ! Mais songez ce que ces constructions peuvent nous faire faire en le comparant avec un blockbuster qui, mobilisant des centaines de techniciens et coûtant des millions de dollars, nous divertit seulement deux heures. Vous citiez Terre inculte, tout à l’heure, le feuilleton que j’ai consacré à traduire et commenter The Waste Land de T. S. Eliot. Ce seul poème m’a occupé pendant 37 semaines. Quel art peut se prévaloir d’un ratio [coût de production / temps d’occupation] plus extraordinaire ? Si un mode de vie reposant sur la surconsommation n’est plus souhaitable, le poème ne s’impose-t-il pas comme l’art du futur dans une société radicalement décroissante ? Ne travaillez pas : écrivez des poèmes. N’allez pas au cinéma : lisez des poèmes. Arrêtez le tourisme : traduisez des poèmes. Les émissions de CO2 chuteront, les températures baisseront, le plastique disparaîtra des océans et les forêts repousseront : les hapalémurs seront sauvés.
Bibliographie :
Vinclair, Pierre, Vie du poème, Labor et fides, 2021.