
Prix de la vocation Cheyne en 2021 avec ce second recueil de poésie, Victor Malzac nous invite à une balade Dans l’herbe. L’anecdote adolescente d’une soûlerie dans un parc devient ici l’occasion d’un voyage de mots et de sensations au cœur d’un univers poétique singulier… à suivre.
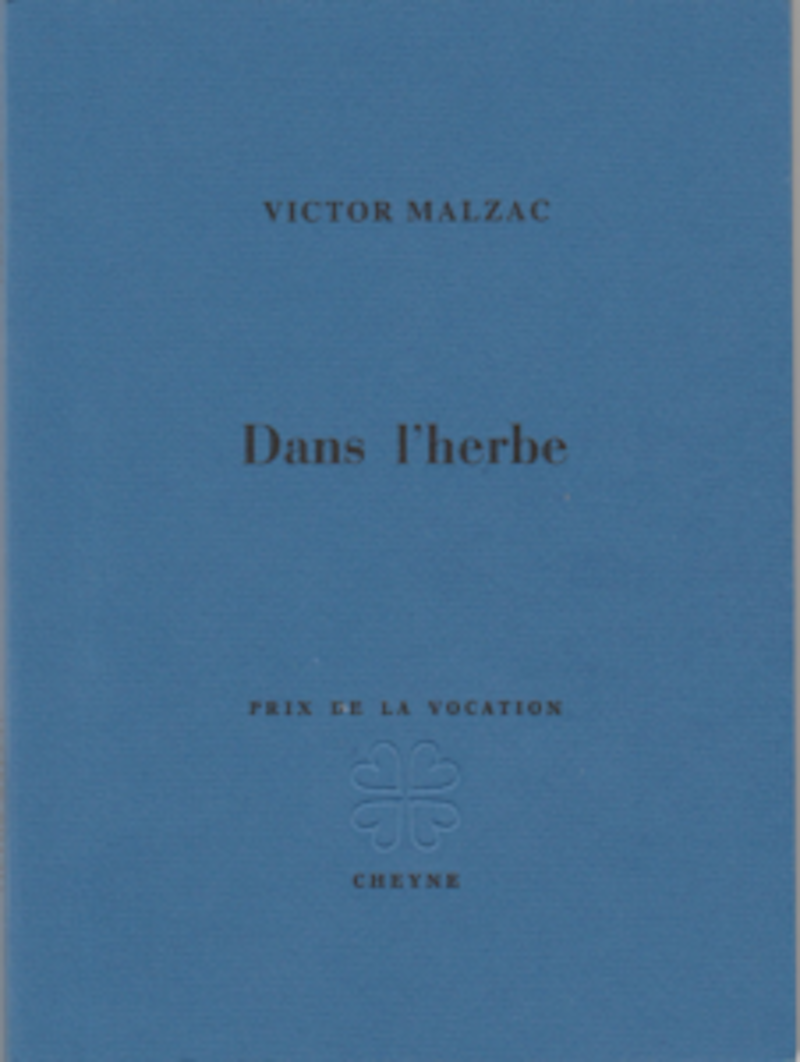
Lourd, lourd les pierres
Un parc, 13 ou 14 ans, une soûlerie accompagnée de cigarettes prises on ne sait où… Le recueil déroule une scénette de l’adolescence, une anecdote dans un chemin vers l’âge adulte. Et tout au long du texte, on s’enfonce avec Victor Malzac dans la lente torpeur de l’adolescence, qui se confond ici avec celle de l’alcool faisant son effet. Le texte est en effet une longue dérivation autour du poids, mot après mot, pierre après pierre :
« buvez beaucoup. buvez
tout ce que vous pouvez,
l’eau des fontaines la vodka, dans ce calice
oui ma canette oui ma gorge, avec, au fond
ma salive ma peur ma drogue, allez, »
Le poète qui écrit, l’enfant prêt pour l’adolescence qui transparaît dans le je poétique, sont autant de versions d’un Molloy. Le personnage éponyme de Beckett transparaît en effet dans le texte, comme un universel de la peur de la mort, ici comme chez l’auteur irlandais métaphorisé par la peur de la pierre. La symbolique de la pierre dans la terre est évidente, mais elle est ici transformée dans une question posée dans un écart de lucidité, et si nous mangions la pierre ? : « j’ai comme des galets dans le ventre. ». C’est Beckett qui resurgit en effet ici, dans les petites pierres sucées et passées d’une poche à l’autre. Molloy les suce, une à une, pour qu’elles y passent toutes, et longuement.
« Maintenant je peux commencer à sucer. Regardez-moi bien. Je prends une pierre dans la poche droite de mon manteau, la suce, ne la suce plus, la mets dans la poche gauche de mon manteau, la vide (de pierres). Je prends une deuxième pierre dans la poche droite de mon manteau, la suce, la met dans la poche gauche de mon manteau. Et ainsi de suite jusqu’à ce que la poche droite de mon manteau soit vide (à part son contenu habituel et de passage) et que les six pierres que je viens de sucer, l’une après l’autre, soient toutes dans la poche gauche de mon manteau. » (Molloy)
Dans l’herbe, c’est bien la lourdeur et le poids de la pierre qui forment un sacerdoce, un inéluctable qui nous tient et nous retient dans notre profonde et certaine matérialité, qu’il prend plaisir à nous détailler : organes, gouttes de transpiration, copulation… Les mots incertains de l’enfant croisent alors les prénotions de l’adolescence. On joue encore mais on joue avec des choses que l’on ne maîtrise pas, et le danger est précisément ici.
« un moindre mal,
bravo les monstres. ayons de la rancune
envers l’école oui.
̶ voici la vérité. puceau »
Le monstre se pare des habits des stupéfiants, sexe ou drogues, mais tout en se maintenant dans les règles de l’âge (« treize ans, quatorze ») : les vacances, le vendredi à venir, et les petites fourmis avec lesquelles on joue, par terre.
Victor Malzac nous met face à cette peur de l’inconnu, cette peur qui peut nous miner à tout âge lorsque le passé s’effondre, et nous entraîne avec lui
Pris dans un corps double, l’enfance d’un côté, finie, l’adulte de l’autre, pas encore là, qui n’a jamais eu envie de tout faire, tout tenter pour s’échapper ? Victor Malzac nous met face à cette peur de l’inconnu, cette peur qui peut nous miner à tout âge lorsque le passé s’effondre, et nous entraîne avec lui. La dimension de la mort
« peur de la mort j’ai trop,
j’ai trop fumé, de relents des regrets
̶ pas de courage, et je crache par terre
pour faire l’homme. pourtant
je me, j’ai peur, arrête non j’ai peur »
Le poète saisit alors avec une justesse rare ce moment de mue, où l’Homme se croit redevenir animal. La peur de la mort devient ainsi peur de la terre, peur de revenir un ver, ou plutôt d’en devenir un, ici, d’en écrire. On pense encore à Beckett, et à son Molloy, roman ici ingurgité et presque régurgité dans ses aphorismes :
« Dans le fossé l’herbe était épaisse et haute, j’enlevai mon chapeau et ramenai les longues tiges feuillues tout autour de mon visage. Alors je sentais la terre, l’odeur de la terre était dans l’herbe, que mes mains tressaient sur mon visage, de sorte que j’en fus aveuglé. J’en mangeai également un peu. » (Molloy)
Le bruissement du vent
Chez Victor Malzac, les mots sont retenus, dans un jeu particulièrement délicat de ponctuations et de blancs, où la répétition formelle est surtout une invitation à entrer avec le poète dans la ronde de mots et de sons que l’on découvre peu à peu. Le poète manipule ainsi avec une aisance rare les ruptures rythmiques, dans un recueil en forme de ballade syncopée.
Chez Victor Malzac, les mots sont retenus, dans un jeu particulièrement délicat de ponctuations et de blancs, où la répétition formelle est surtout une invitation à entrer avec le poète dans la ronde des mots et des sons
La voix de Victor Malzac est en effet une voix qui ne chante pas, mais qui hésite entre le chuchotement et le cri. Les mots sont hésitants, comme s’ils peinaient à sortir, tout en s’assurant avec constance : sans majuscules, le texte s’enfonce dans une palabre au pied de l’arbre, ou plutôt sous lui, dans l’herbe. Les points, comme les tirets, sont autant d’indications de lecture, qui nous proposent une autre vision du texte et de la poésie :
« je ne sais pas non je, mais je,
je voudrais juste
lire.
lire tout seul. Adorer l’herbe ̶ la mâcher »
C’est la musique du rythme qui agit dans le texte, comme une invitation à entrer dans cette transe hallucinée. On tangue avec l’auteur sous les coups de l’alcool inconnu et des cigarettes trop fortes. Il aurait pu tomber dans la tentation facile de la glorification – déjà vue – du poète se consolant dans l’alcool, et y voyant sa plus terrible muse, mais ici, rien de tout cela : Victor Malzac se refuse absolument à toute concession, et l’on plonge dans la détresse davantage que dans une glorification artificielle.
«On est déjà
Trop – trop butés. trop jeunes pour,
pour mourir […]
fumer ce qui se fume, et nous,
et nous mangeons toutes les viandes. […]
et nous gardons les remords les insultes
pour le dessert, »
« Je n’ai pas » et « j’ai trop » sont les deux piliers anaphoriques de l’instabilité langagière du je poétique, qui se repaît de mots comme il cherche à se remplir
« Je n’ai pas » et « j’ai trop » sont les deux piliers anaphoriques de l’instabilité langagière du je poétique, qui se repaît de mots comme il cherche à se remplir. Le texte met en avant une véritable boulimie, super-violente, et auto-destructrice, pour ne pas dire destructrice tout court, car elle emporte tout, et coupe presque la voix. Mais il en ressort justement une langue poétique âpre, tout en pudeur contenue.
«dévorez-moi. Je fais juste partie
du
décor, et je recule, et je recule. »
Bibliographie :
Malzac, Victor, Dans l’herbe, Cheyne, 2021.

















